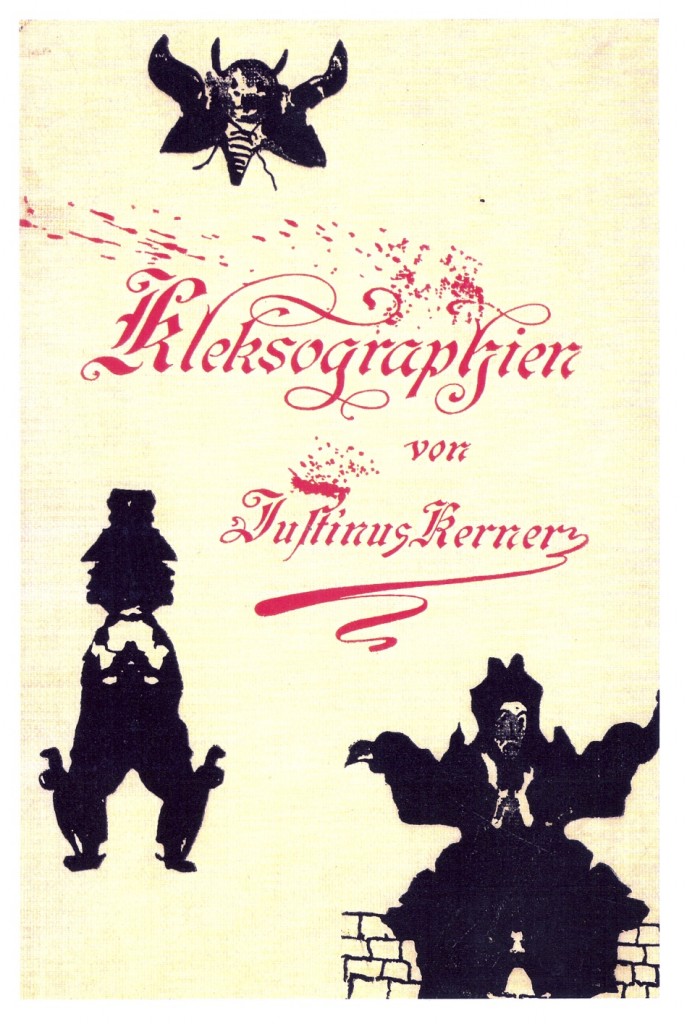Résumé
Français
Cet article explore, à partir de quelques textes-clés, le discours biblio-apocalyptique dans la littérature française contemporaine. Tandis que François Bon salue l’ère « Après le livre » avec un optimisme prudent, Frédéric Beigbeder voit la galaxie Gutenberg s’écrouler dans une « apocalypse d’amnésie et de vulgarité ». Virginie Despentes propose une autre version de l’Apocalypse bébé, reflétant de même la transformation du paysage littéraire à l’âge du numérique. Les livres-jeux et projets multi-supports de Chloé Delaume, s’interrogeant, elle aussi, sur formes et fonctions de l’objet livre, stimulent l’activité co-créatrice des lecteurs. Michel Houellebecq, enfin, médite depuis des années sur le livre entre mythe et marché, sur les conditions matérielles et médiatiques de l’écriture/lecture. Livres sur la fin du livre : ce corpus paradoxal invite à maintes réflexions sur la dé/construction de l’autorité et du rapport auteur-lecteur, sur les métamorphoses sensorielles de l’expérience littéraire ainsi que sur un changement de paradigmes biblio-philosophiques : comment lire le monde à l’âge de l’homme post-typographique ?
English
Based on some key texts, this article explores the biblio-apocalyptic discourse in contemporary French literature. While François Bon welcomes the era “After the Book” with cautious optimism, for Frédéric Beigbeder, the Gutenberg galaxy collapses into an “apocalypse of amnesia and vulgarity”. Virginie Despentes offers another version of Apocalypse bébé, also reflecting the transformation of the literary landscape in the Digital Age. Chloé Delaume questions forms and functions of the object book, too; her game-books and multi-media projects stimulate readers’ co-creative activity. Finally, Michel Houellebecq has been meditating for years on the book between myth and market, on the material conditions and the media of reading/writing. Books about the end of books: this paradoxical corpus invites various reflections on the de/construction of authority and the author-reader relationship, on the changing sensoriality of literary experience as well as on a biblio-philosophical paradigm shift: how do we read the world in the age of post-typographic man?
1. Métamorphoses du livre : introduction
« Que livres, écrits, langage soient destinés à des métamorphoses auxquelles s’ouvrent déjà, à notre insu, nos habitudes, mais se refusent encore nos traditions […] il faudrait être bien peu familier avec soi pour ne pas s’en apercevoir. Lire, écrire, nous ne doutons pas que ces mots ne soient appelés à jouer dans notre esprit un rôle fort différent de celui qu’ils jouaient encore au début de ce siècle […] [1] »… d’un siècle passé désormais. Cette méditation de Maurice Blanchot est pourtant de toute actualité à une époque où le débat autour de la fin du livre est mené d’une façon passionnée, du côté digitalophobe comme digitalophile, et tout particulièrement en France – ceci sur fond des auto- et hétéro-images, solidement établies, de la France en tant que « nation littéraire [2] » (et aussi éminemment bibliophile).
Fin du livre ? Habitons-nous, ainsi que l’affirme François Bon, dans un essai de penser la « mutation numérique […] déjà comme histoire » [3], désormais un monde d’« Après le livre » ? Le discours biblio-apocalyptique, contrastant le « vrai livre » traditionnel (qui, en fait, n’a jamais eu de forme « traditionnelle » [4]) et le « faux livre » numérique, soulève la question de l’essence du livre (voire de l’existence d’une telle essence). L’évolution médiatique nous permet de jeter un regard frais sur des formats invisibilisés par leur présence pluricentenaire : “ […] digital media have given us an opportunity we have not had for the last several hundred years : the chance to see print with new eyes […] ”, observe Nancy Katherine Hayles [5]. Joseph Tabbi souligne de même que “[…] the new media can help us to see the older, printed book in fresh ways ” [6]. Dans ce sens, c’est aussi, après le long « sommeil typographique » [7] de l’époque moderne, « sur l’histoire même du livre que le numérique nous invite à faire retour » [8], nous rappelant que le livre (et surtout « l’idée du livre » [9]) date de bien avant l’entrée de l’invention de Gutenberg sur la scène de l’histoire des médias.
2. Sommes-nous déjà « Après le livre » ?
Le discours sur la (fin de la) galaxie Gutenberg [10] et sur la fin du livre trace des frontières dans un certain degré artificielles ; entre les époques de l’« homme alphabétique » et de l’« homme typographique » d’un côté, entre âge du livre et âge de l’internet, « ère de la littérature » et « ère des algorithmes » [11] de l’autre. Se manifeste un désir de diachroniser au plus vite la « tension synchrone » entre monde analogue et monde digital [12] (chez Frédéric Beigbeder, « Gutenberg » est encore érigé en monument allégorique de tout un âge – toujours d’or, après coup – que notre époque ingrate serait en train de « poignarde[r] […] dans le dos » [13]). Mais tout comme la « gutenbergisation » de la société et de la conscience occidentales a été moins « une rupture totale » qu’une évolution à long terme [14], la transition que nous sommes en train de vivre est caractérisée moins par une coupure nette entre « âge du livre » et « âge d’après le livre » que par la coexistence anachronique (et anisochronique) de divers médias [15]. D’où cet investissement polémique dans une question de changement de paradigmes médiatiques ? Les discours sur la fin du livre doivent leur intensité « apocalyptique » sans doute aussi au fait qu’au-delà des aspects pragmatiques, toute une « ontologie du livre » [16] semble en jeu. Il s’impose donc de les lire comme un symptôme ; comme l’une des formes que prend l’autoréflexion de la société moderne et postmoderne. Un techno-pessimisme affiché sert aussi à donner une cible concrète à un malaise diffus dans la culture capitaliste ; l’instrumentalisation du numérique comme bouc émissaire est évidente lorsque Beigbeder rend la liseuse électronique – métaphoriquement douée d’une subjectivité hostile – responsable de la transformation d’anciens lecteurs, sujets pensants, en des « automates dispersés » [17].
2.1 Ambivalences du discours biblio-apocalyptique : le cas Beigbeder
Entrons donc en la matière avec Frédéric Beigbeder, « écrivain people » [18] catégorisé – peut-être un peu vite – comme « un plaisantin sans envergure littéraire » [19], personnage controversé qui, ces dernières années, s’est imposé comme défenseur du livre contre le « danger numérique » et dont les textes – surtout son Premier bilan après l’apocalypse (2011), faisant écho au Dernier inventaire avant liquidation (2001) – permettent d’élucider quelques aspects cruciaux de l’argumentaire biblio-apocalyptique. Stratégiquement « provocateur et alarmiste », Beigbeder recourt à une rhétorique hyper-dramatisée, annonçant une nouvelle « guerre entre civilisation et barbarie » [20], accusant « Monsieur le bourreau numérique » de précipiter toute une époque « dans une apocalypse d’amnésie et de vulgarité » [21]. Enfant terrible vieillissant ironisant sur son propre rôle ambigu, Beigbeder prétend aussi – de temps en temps – au statut d’écrivain « engagé » (bien qu’avec quelques réticences envers la littérature engagée – trop souvent manichéenne, voire ridicule – en général [22]) ; ce n’est pas pour rien que Michel Houellebecq dresse un portrait parodique d’un Beigbeder fictionnalisé, élevé au rang d’« une sorte de Sartre des années 2010 » [23].
Engagé dans une relation complexe avec un système auquel il est parfaitement intégré en tant que rebelle en titre, Beigbeder semble transférer cette attitude aussi dans sa lutte contre le nouveau mainstream du numérique. Si, dans son Premier bilan post-apocalyptique, il pose en Rambo de bibliothèque, menaçant tout lecteur qui n’aurait pas su résister à la tentation numérique (illégale, en l’occurrence : « Si je vous surprends à lire ceci sur un écran, c’est ma main dans la gueule. Compris ?! » [24]), il est permis de rappeler que le reste de sa production littéraire est bel et bien disponible sous forme électronique. Mais sa croisade contre le livre numérique s’inscrit, de façon fort cohérente, dans un discours (ironiquement) conservateur, anti-digital, anti-internet (Facebook, en particulier, est condamné comme « le nouvel opium du peuple » [25]), que l’écrivain développe depuis plusieurs années déjà. S’auto-dénigrant complaisamment comme « réac », « vieux ronchon » [26], « vieux con » [27] (masque plutôt transparent de tout candidat au rôle de vieux sage), Beigbeder choisit de se placer du côté de la grande histoire littéraire, voire de l’éternité (il insiste sur les avantages du livre papier en termes de résistance temporelle [28]), combattant solitaire contre tous ceux qui lui servent leur « couplet progressiste et scientiste » [29] sur les avantages de la nouvelle culture digitale.
Biblio-écologiste autoproclamé, il prend la défense des livres traditionnels « en danger de mort » [30], ces « tigres de papier », ces « vieux fauves menacés d’extinction » [31] ; cette métaphore filée du livre-fauve qu’il s’agit de sauver au nom de la bio- (ou biblio-) diversité renvoie au topos du livre comme objet ou bien « animal » dangereux, voire mortifère, jamais domestiqué. Beigbeder n’est ni le seul ni le premier à associer livre/texte/écriture et tigritude (papetière) : Vilém Flusser, dans ses réflexions sur la violence d’une écriture « iconoclaste », compare le stylo à une « canine », le sujet de cette inscription à un « tigre féroce » [32] ; Jacques Derrida joue de même avec la métaphore du « tigre de papier » [33].
Soulignant à la fois l’aspect « papier/simulacre » et l’aspect « fauve » du livre, cette métaphore évoque aussi tout un imaginaire organique, profondément éclectique. Les discours – bibliophile comme biblioclaste – autour de la fin du livre semblent marqués par deux tendances contraires (et complices), développant chacune son répertoire métaphorique. D’un côté, une tradition discursive, affirmant la « fin » toujours imminente du livre, inscrit celui-ci, comme un produit technique parmi d’autres, dans une histoire linéaire de la civilisation. D’un autre côté, à ce pragmatisme progressiste s’oppose un discours naturalisant le livre comme objet mythique, éternel. Si, d’un point de vue techno-historique, « livre », en général, veut dire livre imprimé en tant qu’emblème de la modernité occidentale gutenbergienne, dans le discours à visée mythique, le livre est souvent situé dans une perspective plus large – ainsi chez Jorge Luis Borges, se référant à l’idée musulmane de « l’archétype platonique du Coran » comme « mère du livre » [34], « inlibration » (pour varier une expression de Harry Wolfson) du logos divin [35].
Dans ce sens, le recours aux débats du passé – surtout de la fin du XIXe et de la première moitié du XXe siècle, temps de progrès techniques où la question de la fin du livre se pose, comme de nos jours, avec une virulence particulière – illustre à merveille le caractère citationnel, éclectique – et, dans une certaine mesure, autophage – des discours contemporains sur le sujet. Ainsi, Octave Uzanne – dans un texte publié dans Contes pour les bibliophiles en 1895 – esquisse une vision futuriste « de la fin des Livres et de leur complète transformation » [36], témoignant d’un malaise dans la culture assez typique de l’époque : dans un univers hyper-saturé de produits culturels, le livre, n’offrant plus cette « cure d’aérothérapie idéaliste » [37] qui serait la fonction principale de l’art, se voit condamné par ses « excès » mêmes : « Il faut que les livres disparaissent ou qu’ils nous engloutissent […] Jamais l’Hamlet de notre grand Will n’aura mieux dit : Words ! Words ! Words ! Des mots !… des mots qui passent et qu’on ne lira plus » [38], s’écrie « l’humoriste John Pool » [39]. Paradoxalement et significativement, cette phrase finale résume la lassitude face aux « mots » – omniprésents et omnivores – encore par une référence intertextuelle. Le conte d’Uzanne véhicule aussi l’ambivalence fondamentale du discours centenaire sur la « fin des livres », oscillant entre fantasme d’angoisse et fantasme de désir – désir d’une chimérique innocence et immédiateté pré- (ou post-) livresques, version sécularisée des mythes d’un paradis d’avant les livres, d’avant même les mots.
Prophète improvisé de la « fin des livres », « bibliophile » se faisant l’avocat du diable, le narrateur d’Uzanne en appelle aussi à la dimension politique d’une (r)évolution médiatique dirigée contre l’Imprimerie (quasi-allégorisée) qui, « à dater de 1436, régna si despotiquement sur nos esprits » et qui, même « menacée de mort », « gouverne » toujours l’opinion [40]. Dans cette optique, la disparition du livre imprimé constitue une étape fatale dans l’histoire de la civilisation ; argumentation corroborée par plusieurs comparaisons tirées de la vie quotidienne [41]. Et le narrateur de conclure : « Après nous la fin des livres ! » [42]… Fin toujours pas après nous.
Quatre décennies plus tard, Stefan Zweig revient sur la question dans son essai « Le livre comme entrée au monde » [43]. Par contraste à Uzanne, il naturalise le « miracle » du livre [44], phénomène culturel, par une métaphore organique filée à travers tout le texte. Pour « nous, fils et petit-fils de siècles d’écriture », la lecture se serait transformée en une « fonction quasi corporelle », un « automatisme » atavique [45] ; Zweig se montre convaincu de l’absurdité de toute spéculation concernant la fin du livre : celui-ci, « sans âge et indestructible », n’a rien à craindre de la concurrence du gramophone, du cinématographe ou de la radio, étant si organiquement lié à l’humanité qu’il ne saurait tout simplement pas disparaître [46].
Si Sigmund Freud caractérise l’homme comme un « dieu prothétique » (Prothesengott [47]), si Marshall McLuhan définit les médias comme “extensions of man ” [48], Borges commence, lui aussi, par considérer le livre comme « une extension de la mémoire et de l’imagination » [49]. Mais la prothèse livresque – « un instrument […] qui m’est aussi intime que les mains ou les yeux » [50] – finit par s’intégrer au corps même de l’homme. Si d’autres ne peuvent concevoir un monde « sans oiseaux » ou « sans eau », Borges se déclare incapable d’imaginer « un mundo sin libros » [51], assimilant le livre à une nature plus ou moins éternelle : « On parle de la disparition du livre ; je crois que cela est impossible. » [52]
Mais revenons à nos tigres beigbederiens. Si le livre papier est associé, dans ce discours biblio-apocalyptique, à un imaginaire organique, le livre numérique, lui, est systématiquement réduit à son caractère d’anti-nature, de technique abstraite, déshumanisée.
2.2 Les cinq sens et le livre : à la recherche d’une sensualité perdue ?
L’image du livre-animal nous renvoie à une autre question cruciale du discours sur la fin du livre : sa (prétendue ?) « dématérialisation » [53] par la numérisation, équivalant, pour Beigbeder, à sa « destruction » [54]. Dans le cadre d’une dichotomie artificielle, le « vrai livre » papier est opposé au livre-fantôme numérique (« Un e-book, ça n’existe pas » [55]), comme si tout acte de lecture n’était pas aussi un acte physique, comme si l’écriture/lecture digitalisée ne possédait pas – inévitablement – sa sensualité à elle [56]. Autre leitmotiv dont on peut suivre les traces odorantes à travers le discours biblio-apocalyptique : les délices olfactives de la lecture à l’ancienne. Beigbeder, nostalgique, par anticipation, de la « chair du livre » [57], évoque « le parfum de l’encre, le parfum du papier », « magnifique » [58], dépréciant, par un argument idiosyncrasique, le livre électronique à l’odeur de « métal » [59]. En effet, pour l’instant, l’odeur se voit investie, plus encore que le toucher ou le bruit du papier (imité par divers gadgets électroniques), du prestige de la matérialité « authentique » du livre imprimé [60]. Or, François Bon, parodiant cette obsession « de l’odeur du papier et autres fariboles » [61], démonte, par une petite analyse chimique, cette douce fiction parfumée [62].
Au lieu de « dématérialisation », il faudrait parler plutôt de ré- ou trans-matérialisation, le switching entre lecture sur support papier et lecture numérique provoquant même une espèce de surconscience lectrice. La numérisation resensibilise notre regard sur des formes médiatiques anciennes qu’elle varie à son tour : la liseuse électronique, visant un effet de réel livresque, s’inspire de livres « traditionnels » – le comble du grotesque selon Beigbeder (« Un ingénieur chez Apple a pensé à faire en sorte que l’écran tactile émette un bruit de papier froissé quand on glisse son doigt sur sa surface. On vit une époque de malades ou pas ? » [63]), pour qui de telles imitations ne font que trahir « le complexe d’infériorité des partisans du numérique » [64]. Interprétation douteuse, puisque tout au long de l’histoire des médias, s’observe ce principe de la « mimicry » [65] ; le livre numérique, encore sous l’influence du « Paperdigm » [66], ne « cite » d’ailleurs pas seulement le livre papier, mais synthétise plutôt plusieurs modalités de lecture historiques [67].
À la « dématérialisation » du livre, s’associe le reproche de sa « désindividualisation » par la numérisation. Beigbeder rend un hommage appuyé au livre papier en tant qu’objet individuel par contraste à la liseuse « indifférente » [68]. Or, la transition au livre imprimé constituait déjà une « étape vers l’apparition d’une civilisation de masse et de standardisation » [69], tandis que la numérisation apporte aussi de nouvelles perspectives d’individualisation ; côté auteur, l’option d’une « écriture spécifiquement typographique » [70] ; côté lecteur, toute une panoplie de possibilités d’interventions dans la présentation du texte lu [71]. Pour Beigbeder, les nouvelles libertés lectorales menacent une œuvre conçue comme « objet unique » [72] par son auteur, non plus « maître » de son livre (formule récurrente dans le discours beigbederien [73]). Antoine Gallimard regrette à son tour l’affaiblissement du contrôle éditorial sur le livre-objet, affirmant que « [l]a numérisation risque ainsi de dévaloriser le contenu » [74]. Le lecteur est donc perçu comme une force profane, destructrice, la numérisation comme un danger contre lequel il s’agit de défendre non seulement le livre papier, mais aussi la dignité auctoriale et tout un système éditorial. À la mise en question de la forme livre du côté de la réception, correspond celle du côté de la production : Beigbeder l’apocalypticien a sans doute raison de constater que « [l]e remplacement du livre en papier […] va donner naissance à d’autres formes de récits » [75] et qu’« [u]n roman de papier ne s’écrivait pas comme un script sur Word » [76].
2.3 Fin du livre, fin du roman ? Galaxie Gutenberg et genres littéraires
Avec la biblio-culture traditionnelle, Beigbeder défend aussi le roman moderne comme manifestation paradigmatique du livre dans toute sa splendeur, produit de la galaxie Gutenberg et condamné à disparaître avec elle [77]. Au-delà de la polémique, il soulève la question pertinente de la correspondance entre l’évolution des genres littéraires et celle des supports techniques de la littérature [78]. Le roman moderne, dès ses débuts, se distingue par une forte tendance métalittéraire, méta-livresque et même méta-typographique (que l’on pense au Quichotte, reflétant « la tension entre les pôles typographie/presse d’imprimerie/livre et manuscrit/plume/papier », ou au Tristram Shandy de Sterne, exploration romanesque de l’« interpénétration de l’art du récit et de la typographie » [79]).
À la fin du livre s’associe donc celle du roman, la question de l’économie des genres littéraires à l’époque post-gutenbergienne. Transformation envisagée aussi, d’un point de vue moins pessimiste, par les autres auteurs de notre corpus : pour Chloé Delaume, le numérique pourrait favoriser « l’évolution des genres, le dépassement de certaines limites du roman, notamment » et, enfin, « la création d’un objet littéraire complètement repensé » [80]. Virginie Despentes s’attend de même à l’apparition de nouveaux « formats hybrides » : « […] ce ne sera plus du roman ou de l’essai. Il faudra trouver un autre nom […] » [81]. Bref : si chaque livre, selon Blanchot, poursuit finalement la « non-littérature » [82], nous assistons aujourd’hui à l’émergence de formes littéraires poursuivant le « non-livre », la littérature continuant d’aller « vers elle-même, vers son essence qui est la disparition » [83].
2.4 Noblesse (papier) oblige : Biblio-Aristocratie vs. Cyberdémocratie ?
Beigbeder, dans sa défense ardente du roman, le caractérise comme « un lieu de liberté » [84] face à l’industrie médiatique. En même temps, il déplore les effets désastreux de la démocratisation de l’écrit par la « révolution » numérique, les ravages de l’« écran […] communiste », ravalant « la prose de Cervantès […] au même rang que Wikipédia » : « Toutes les révolutions ont pour but de détruire les aristocraties. » [85] Si l’invention de l’imprimerie constitue déjà « une véritable révolution démocratique » [86], l’internet, pour Beigbeder, établit définitivement « l’empire de la méchanceté, de la bêtise ; n’importe quel abruti a droit au chapitre » [87]. Odi profanum vulgus… : De telles attaques contre une « cyberdémocratie » [88] supposément abusive permettent de nuancer l’éloge beigbederien de la liberté littéraire – visiblement pas destinée à tous. François Bon – qui, par contraste, met en avant les vertus de l’« échange web » en tant que « nouvelle agora » [89], espace du « partage » [90], de l’« écriture collective » [91] – ironise sur la chimère élitiste d’« une sorte de paradis très ancien, entrée réservée aux membres du club de l’écriture » [92]. Dans un pamphlet de Stéphane Ternoise, « [M]onsieur Frédéric Beigbeder de chez Lagardère » [93] est attaqué en tant que représentant d’une (pseudo-)aristocratie littéraire à laquelle l’auteur oppose la vision d’une biblio-culture démocratisée (tout en idéalisant, de son côté, la numérisation comme une régulière libération face à la « dictature » éditoriale [94]). En fait, avec le livre « traditionnel », on défend souvent aussi un certain habitus bourgeois (sinon aristocratique) ; en 2009, Jean-Marc Roberts, alors directeur des éditions Stock, déclare le livre numérique « juste bon pour les SDF » [95]. Les partisans du numérique, par contre, valorisent la possibilité d’atteindre un public peu réceptif au livre classique ; ainsi François Bon avec son idéal d’une « littérature sociale » [96], d’un livre « nomade et accessible à tous » [97].
3. Défense du livre, défense de l’autorité ?
En un mot, l’avènement du numérique brouille les rôles établis « de l’auteur, de l’éditeur, du typographe, du diffuseur, du libraire et du lecteur » [98] ; le sens d’un texte, plus que jamais, est le produit de l’usage qu’en fait le lecteur [99]. Historiquement, il existe un lien étroit entre essor de l’imprimerie et émergence du concept moderne de l’autorité [100] ; la figure de l’« Auteur », jusqu’à nos jours, reste associée à l’idée du livre papier [101], tandis que l’hypertexte électronique ébranle ce monument auctorial [102] – inéluctablement, les enjeux du discours pro- ou anti-numérique impliquent la mise en question ou la défense de l’autorité. Ainsi, François Bon (de son point de vue d’écrivain consciemment un peu « mineur ») problématise la pose de ces « écrivains imperturbables », défenseurs du livre peut-être surtout attachés à « l’idée d’eux-mêmes en auteur de livre » [103].
3.1 La biblio-apocalypse selon Virginie Despentes
Pour illustrer les répercussions de ces débats dans la fiction littéraire de l’extrême contemporain, jetons un regard sur Apocalypse bébé (2010) de Virginie Despentes, roman « médiatique » reflétant les métamorphoses de la biblio-industrie à l’âge de Wikipédia et d’Amazon : Despentes y met en scène un écrivain conservateur, attaché au livre traditionnel et luttant pour les restes minables de son autorité, avant de périr sous les décombres du Palais-Royal, suite à un attentat commis par sa fille adolescente, représentante d’une génération de « digital natives » [104] – terrorisme parricide comme métaphore parodique d’un changement de paradigmes médiatiques ?
La pose beigbederienne – même ironisée – de l’aristocrate bibliophile est assurément étrangère à Virginie Despentes… ce qui n’empêche pas Beigbeder d’accorder, dans son Premier bilan [105], une place de choix à l’auteur de cet autre ouvrage « apocalyptique » [106]. Chez sa collègue, dont « [l]’énergie […] pulvérise tout sur son passage » [107], il apprécie surtout un énorme dynamisme linguistique [108] et « l’idée de faire un livre qui démode tous les films » [109] (obsession partagée par Beigbeder qui, tout en mythifiant la forme du livre, aspire à moderniser son contenu et son langage [110], voire à « désacraliser la littérature » [111]). Chez Despentes, avec sa vision critique de l’establishment (ainsi que de sa propre personne publique, cette « Despentes vachement construite » [112] recyclée par les médias), sa poétique de la marginalité, de la « lositude » [113], s’impose la question de (l’accès à) la littérature comme privilège socioculturel. À l’occasion de la publication d’Apocalypse bébé, Despentes réfléchit sur sa propre biographie non seulement d’écrivain, mais aussi de lectrice ; ironisant sur son « relatif ‘em-bour-geoisement’ », elle admet s’être mise enfin « à lire une littérature que je n’aurais pas osé aborder auparavant, plus classique » [114]. Quant à la « fin du livre papier », elle se montre plus pragmatique qu’apocalyptique, déclarant craindre plutôt la « fin de la librairie » comme lieu social, ainsi que certaines « facilités » du numérique en matière de censure [115] (sujet présent aussi dans Apocalypse bébé dont la narratrice médite sur l’économie de l’information et de la censure à l’âge digital [116]).
Apocalypse bébé soulève la question du livre et de la littérature aussi dans une perspective sociale – ainsi, du point de vue d’un jeune banlieusard maghrébin : Yacine rejette en bloc toute la « culture » qu’est censée lui apporter l’école ; la cible privilégiée de sa fureur anti-scolaire est son professeur de français, « la pute au tableau » [117]. Mais au centre des réflexions métalittéraires et « à l’origine du roman » [118] se trouve l’écrivain fictif François Galtan qui, tout comme le très réel Frédéric Beigbeder, dénonce l’internet, empire de la « médiocrité » anonyme ; pour le visiteur frustré de divers blogs et forums littéraires, la Toile se transforme en version postmodernisée de l’enfer dantesque [119]. Mortifié, il rédige sa propre notice bio- ou plutôt hagiographique sur Wikipédia, hélas, par trop révélatrice [120]. L’analyse de sa navigation internaute, entreprise par les détectives après la disparition de sa fille, donne lieu à quelques observations critiques sur le rôle ambivalent d’Amazon sur le marché culturel contemporain [121]. Gutenbergien fidèle, Galtan est hanté par l’obsession du livre numérique ; sa mère, psycho-terroriste accomplie, ne cesse de lui annoncer des nouvelles apocalyptiques du front bibliographique : « C’est ainsi qu’elle lui fait entendre qu’il a tout raté dans sa vie. Une vie consacrée aux livres, et les livres bientôt disparus. » [122] Si Galtan, personnage tragicomique, auteur de « drames bourgeois. Droite chrétienne, mais à l’ancienne » [123] et, par anticipation, prétendant déçu au sacre de la Pléiade [124], a l’impression de perdre le contrôle sur sa vie professionnelle comme privée, cette désorientation apparaît liée à la disparition du livre, dispositif de sécurisation ontologique.
Mais Despentes illustre aussi l’aspect oppresseur de la figure traditionnelle de l’auteur. Aux yeux de son ex-épouse, faisant, elle, partie de la classe et du sexe dominés, les activités littéraires de Galtan constituent un pouvoir social, retourné contre elle au moment du divorce. Des années plus tard, elle est toujours furieuse à l’idée d’avoir été exploitée par cet écrivain bourgeois (et recyclée dans ses romans) ; la mémoire de cette violence symbolique, associée à « [l]a main qui écrit, celle qui trahit, épingle et crucifie. Celle qui livre » [125], est évoquée en termes physiques intenses. Valentine, elle aussi, découvre les vertus de l’écriture en tant qu’arme symbolique [126] ; sa transformation en kamikaze est encadrée par ses activités poétiques extravagantes [127]. Or, plus audacieuse et plus désespérée que son père, elle change de genre, se servant de son propre corps comme média explosif afin de communiquer son message paradoxal [128]. Despentes, consciente de sa mission « anarcho-féministe »[129], a souligné, à plusieurs reprises, la nécessité de « faire éclater les choses » [130], définissant le féminisme comme « [u]ne révolution, bien en marche. […] Il ne s’agit pas d’opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis des hommes, mais bien de tout foutre en l’air. » [131] Valentine se dédie littéralement à ce projet de « tout foutre en l’air » – dont son père romancier, au moment même où celui-ci se voit enfin promu « chevalier des Arts et des Lettres » [132].
Au-delà de la littérature, ce texte illustre la reconfiguration du sujet humain dans un monde digitalisé où l’internet dévalorise les formes traditionnelles de savoir acquis [133], un monde de « l’amour Skype »[134] où la Carte de Tendre est redessinée par divers gadgets médiatiques [135] ; l’internet remplit aussi une importante fonction structurelle comme « matrice » narrative [136]. Sous l’influence d’un milieu altermondialiste-marxiste, critique des nouveaux médias, Valentine décide de « solder son identité virtuelle » ; pour consacrer son nouveau moi dé-digitalisé, elle finit par lancer son portable dans la Seine. Or, elle est foudroyée par le choc du sevrage, ressenti comme une régulière « amputation » [137]. Le roman confirme, dans ce sens, la définition freudienne de l’être humain, triste « dieu prothétique » ; le téléphone portable est métaphorisé comme une « prothèse » indispensable de nos jours [138].
La brève biographie de Valentine reflète, enfin, la problématique de la narration dans un monde peut-être déjà « après le livre », de toute façon, après la fin des grands récits. Apocalypse bébé met en scène l’illisibilité d’un « livre-monde » éclaté où l’individu – ou plutôt « dividu(el) » (d’après Anders [139] ou encore Deleuze [140]) – ne dispose plus que de vérités relatives, temporaires, de récits fragmentaires : « La vérité, je ne la connaîtrai jamais. Reste l’histoire que je me raconte, d’une façon qui me convienne, dont je puisse me satisfaire. » [141]
3.2 Chloé Delaume : vers une littérature multi-supports, ou Le livre par-delà le livre
Chloé Delaume [142], dans son « autofiction expérimentale » [143] et « multi-supports » [144], s’essaie à la transgression ludique de la forme livresque – entreprise reflétée non seulement dans sa dimension esthétique, mais aussi éthique et politique. Si Despentes, d’une grande scrupulosité quant au respect D’autres vies que la mienne [145], déclare renoncer à la tentation autofictionnelle [146], Delaume s’applique à « démocratiser » le processus de création, accordant une co-autorité (limitée) aux personn/ag/es impliqués dans son projet autofictionnel : « À leur fictionnalisation je veux qu’ils participent. » [147]
Ses textes, situés dans la tradition de l’Oulipo [148], à la syntaxe complexe, « ensauvagée » [149], pleins de jeux de mots, de références intertextuelles, de néologismes extravagants, mais aussi d’archaïsmes choisis, découragent toute approche naïvement voyeuriste [150]. Intransigeante dans sa condamnation de la « République Bananière des lettres » [151], Delaume affirme sa conviction que la littérature peut et doit défier les lecteurs, qu’elle « se mérite » [152]. En tant que directrice de la série Extraction (éd. Joca Seria), elle poursuit de même une politique pro-expérimentale ; sa quasi-diabolisation d’une littérature facile de simple « divertissement » lui a valu quelques moqueries [153].
Or, cette exigence formaliste s’associe à la revendication d’une « mission » sociale et politique ; au storytelling professionnalisé, aux « grands livres des fictions collectives » [154], Delaume oppose sa « Politique de l’autofiction » [155]. Cette poétique de la résistance narrative, de l’engagement lucide, quelquefois auto-parodique (Delaume ironise elle-même sur cette volonté de « sauver le monde » par une autofiction critique [156], sur la tentation de la « rébellion […] mignonne », de la « subversion Haribo » [157]), est illustrée par son projet J’habite dans la télévision, conçu dans le sillage de l’affaire Le Lay en 2004 [158]. Dans ce « projet multi-supports, portant sur la confrontation des fictions individuelles face au formatage de la fiction collective imposée par la société spectaculaire » [159], l’auteure développe aussi un discours critique sur le livre en tant qu’objet de consommation, objet fétiche de l’auto-mise en scène d’une prétendue élite [160], soucieuse de sauvegarder sa « distinction » en affichant sa préférence pour la « narration sur support papier […] n’importe quelle narration, mais reliée » [161]. Tout comme le livre, le concept de l’œuvre est l’objet d’une méfiance profonde, l’écriture littéraire un projet existentiel : « Je ne cherche pas à faire œuvre, mais surtout à faire vie. » [162] Le « livre » s’oppose au « texte » comme entité créatrice, potentiellement subversive : « Vous ne lisez pas des textes mais vous achetez des livres » [163], reproche Delaume à ses hypocrites lecteurs bourgeois, ne se lassant pas de rappeler que « [l]e livre n’est qu’un objet » et que « ce qui m’importe c’est le texte ». Dans ce sens, le numérique constitue une « ouverture sur la littérature » par-delà le « fétichisme bibliophile », s’adressant « aux vrais lecteurs […] attachés au texte » [164].
L’œuvre de Delaume, « réseau interconnecté » [165], ne se limite donc pas au domaine de la littérature imprimée ou même numérique. L’auteure s’intéresse à toutes sortes de « pratiques transdisciplinaires » [166], à « l’autofiction en BD » [167] ou « en ligne » [168] ; dans ses livres papier, elle déploie tout un programme destiné à l’« activation » multi-médiale des lecteurs, en renvoyant, par exemple, à des enregistrements audio disponibles sur son site [169]. Dans son projet Corpus Simsi – « passion » postmoderne ironique –, Delaume explore les possibilités du jeu vidéo en tant que « générateur de fiction » [170], « exercice d’une nouvelle littérarité » [171]. Au commencement était le rejet de la forme livresque de la part de Chloé Delaume, « personnage de fiction […] [qui] a refusé de s’incarner dans un livre » et qui – le « moi » se transformant en construction collectivement dés/autorisée – « peut être utilisé par n’importe quel joueur l’ayant importé » [172].
Le monde simsien de Delaume, dédoublé dans une curieuse mise en abyme [173], finit pourtant par « aboutir à un livre » [174] – méta-livresque et ludique, illustrant à merveille le paradoxe fondamental qui hante tous ces livres sur la fin du livre [175], envisageant les perspectives de la production littéraire au-delà du livre imprimé : « La chair comme le papier ne sont pas nécessaires aux personnages de fiction [176]. » La description de la vie culturelle simsienne permet de reconsidérer, via défamiliarisation, certains éléments de la littérature « réalistienne » – le concept du livre tout comme celui de l’auteur : « Les Sims n’ont pas d’auteurs, cette notion même n’existe pas. » Le focus est encore déplacé du pôle de l’écriture vers celui de la lecture : « Les Sims lisent mais ils n’écrivent pas [177]. » Par le détour virtuel, Delaume met en question l’idée d’une chimérique originalité : si les Sims peuvent « développer » leur potentiel artistique, leur « Créativité » programmée ne saurait emprunter que des voies déjà tracées, permettant « [j]uste de reproduire, et jamais d’inventer » [178]. Dans ce sens, le monde simsien reflète aussi le statut de l’être humain conditionné par un réseau de discours, ainsi que « l’existence […] dans les sociétés occidentales contemporaines » [179]. Au-delà du livre, le jeu digital – univers parallèle, « enchevêtrement de fictions minuscules » [180] – fait figure de nouvelle métaphore-matrice du monde : « Nous sommes le jeu auquel tout le monde joue déjà. » [181]
Dans La Nuit je suis Buffy Summers (2007) – « livre-jeu […] livre-je » [182], roman interactif basé sur l’imaginaire de Buffy the Vampire Slayer [183] –, le lecteur est convié au jeu avec le « Je élastique » de l’autofiction [184] ; à force de multiplier les coups de dés (inter)textuels, il participe à la création de son livre. D’emblée, Delaume l’invite aussi à une approche physique, « irrespectueuse » de cet objet d’« un curieux fétichisme » [185]. Lector (ou lectrix) in libro – concluant un « pacte illégitime » [186] avec son lecteur ou sa lectrice (le « je » proposé est de genre féminin), Delaume le/la fait entrer dans l’aventure d’une « autofiction collective » [187].
Double discours critique sur un livre symbole de pouvoir [188], un livre-prison : l’(im)possible révolution contre la « fiction collective » [189] hors texte est associée à la rébellion des personnages – « écrits par un cerveau assez indisponible » [190] et en proie à l’obsession métaleptique de « quitter le livre » [191] – contre « la narration imposée » [192]. « Être enfermé dans un livre, […] c’est assez anxiogène […] » [193], déclare la narratrice ; la lectrice, elle aussi « coincée » dans l’histoire [194], se trouve impliquée dans la tentative d’évasion d’un « bouquin » jugé « insalubre » [195] et exposée à la fureur de l’« auteure », défendant ses privilèges menacés [196]. Ironisant sur un imaginaire apocalyptique [197], ce texte-jeu reprend le motif du livre mortifère : Delaume évoque des visions grotesques d’un livre-monstre, d’un livre-vampire s’animant au cours d’un rituel sanguinaire [198].
La poétique delaumienne invite donc tout particulièrement à quelques réflexions sur l’opposition – cruciale dans le discours biblio-apocalyptique contemporain – entre « livre » et « texte ». Dégradation, par le numérique, du livre en un simple texte, voire en « du texte » [199], ou bien libération ? Dans ses réflexions sur la « fin de la galaxie Gutenberg », Bolz ne manque pas de citer Derrida : « La question de l’écriture ne pouvait s’ouvrir qu’à livre fermé. » [200] Walter Benjamin caractérise déjà le livre imprimé comme un « asile » (temporaire et précaire) de l’écriture d’où celle-ci se voit ramenée dans la rue, soumise aux « hétéronomies brutales du chaos économique » [201]. C’est dans ce contexte que François Bon se réfère à Benjamin, fasciné par la « concision » avec laquelle celui-ci formule « l’autonomie réciproque du livre et de l’écriture » [202], tout comme par cette « autre intuition essentielle » benjaminienne, concernant le « retour du corps » [203].
3.3 Michel Houellebecq : l’(im)possibilité du livre ?
La sensibilité à l’aspect corporel et technique de l’écriture (comme de la lecture), revendiqué par un avocat du numérique comme François Bon, se retrouve chez Michel Houellebecq, dont les (para-)textes sont riches en réflexions sur l’industrie littéraire de nos jours, le « true business qu’est le roman » [204] et « le petit milieu de la poésie » [205], paradis perdu pour le romancier à succès ; bref : sur le livre entre mythe et marché. Or, c’est en tant que grand brand littéraire que Houellebecq articule sa critique, victime et complice de cette « labellisation » de la littérature attaquée par Salmon [206].
Abordant sans ambages l’aspect commercial de son activité littéraire – « chance d’échapper au monde du travail » [207] –, Houellebecq ne dédaigne pas non plus la méditation sur les outils de l’écrivain ; dans sa « brève histoire de l’information » [208], il retrace les étapes de l’écriture depuis le manuscrit jusqu’à l’ordinateur, en passant par la machine à écrire – qui a, elle aussi, nourri tout un discours polémique sur splendeurs et misères d’une écriture « technicisée » : merveille technique pour les uns (ainsi pour Jan Tschichold, auteur d’un ouvrage consacré à « La nouvelle typographie » [209]), symbole de l’irruption fatale « du mécanisme dans le domaine du mot » pour les autres (en l’occurrence, pour Martin Heidegger, ennemi juré de la « Schreib-maschine » – orthographiée de manière à en accentuer l’aspect « machine » [210]). De toute façon, la retraite du manuscrit marque une étape décisive dans l’histoire littéraire ; par effet de ré-projection nostalgique, c’est la typographie qui rapproche l’« écriture dite manuscrite » [211] du corps [212], faisant oublier l’aliénation inhérente même à la plume, cet « exil » qu’implique déjà le papier [213].
Si l’autorité moderne est sanctionnée par l’imprimerie, la genèse du livre, (au moins) jusqu’à la fin du XIXe siècle, se situe dans un espace du manuscrit. Houellebecq établit un rapport privilégié entre « la souplesse et l’agrément du manuscrit » et le micro-ordinateur, « libération inespérée » pour l’écrivain [214] : le « combiné ordinateur portable – imprimante Canon Libris » se trouve parmi ces trois objets fétiches dont un « Houellebecq » ivre et mélancolique pleure, dans La Carte et le territoire (2010), la disparition du marché [215]. Ce discours « technique » sur l’écriture relativise l’importance de l’auteur face à la dynamique propre du texte : « On ne décide jamais soi-même de l’écriture d’un livre […] », explique « Houellebecq » ; « un livre, […] c’était comme un bloc de béton qui se décide à prendre, et les possibilités d’action de l’auteur se limitaient au fait d’être là, et d’attendre […] que le processus démarre de lui-même. » [216] De la fleur bleue au béton : métaphore révélatrice qui s’inscrit dans l’imaginaire technique, très présent dans le roman et dont participe aussi la création littéraire, considérée comme (méta-)métier.
Si l’ordinateur constitue une « libération » pour l’écrivain, Houellebecq préconise une dé-digitalisation au moins temporaire du côté du lecteur : le livre traditionnel fait figure de « pôle de résistance vivace » [217], favorisant la très houellebecquienne « mise à distance » du monde [218], la « position esthétique » [219] d’un sujet « étranger à lui-même » (formule kristevienne [220] qui se retrouve dans La Poursuite du bonheur [221]), capable de « regarder la vie comme on lit dans un livre » [222]. Or, le « vrai » lecteur est, selon Houellebecq, une espèce menacée de disparition. On se rappelle les remarques apocalyptiques de Beigbeder sur le lecteur contemporain, cet « automate » corrompu ; Houellebecq constate, lui aussi, la transformation du lectorat, mais il inscrit cette réflexion dans sa critique générale d’une société qui détruit les formes de subjectivité caractérisant un (bon) lecteur, numérisé ou pas [223].
Si Beigbeder s’obstine à défendre le roman contre le numérique, Houellebecq réfléchit sur l’incompatibilité plus profonde entre la forme du roman traditionnel et l’expérience de la vie contemporaine ; pas de pamphlet anti-digital chez lui, mais un acte de décès mélancolique pour un genre qui n’a pas attendu l’arrivée du numérique pour entrer en crise ; une autre fois, le discours sur la mort du roman [224] et celui sur la fin du livre évoluent en parallèle. Dès Extension du domaine de la lutte, Houellebecq thématise la désintégration des biographies individuelles, mise en relief par la comparaison avec le monde narrativement dense d’un roman comme Wuthering Heights [225]. Dans La Carte et le territoire, il oppose les manifestations artistiques du « monde comme narration » et du « monde comme juxtaposition » [226], faisant déclarer à son double fictionnalisé son scepticisme ou plutôt son désintérêt croissant face au premier. En un mot : la crise du roman, selon Houellebecq, dépasse celle du livre papier ; elle traduit une crise généralisée de la narratibilité de l’existence, du sujet humain, ébranlé par l’évolution des sciences rendant obsolète toute « psychologie » littéraire [227]. Mais par-delà et à travers le roman, Houellebecq médite aussi sur la forme livre dans toute son ambivalence – objet de consommation d’un côté, objet mythique de l’autre, modèle d’un monde éminemment (inter)textuel [228].
La Carte et le territoire contient, enfin, un portrait remarquable de « Michel Houellebecq, écrivain », représenté au milieu d’un « univers de papier », de « blocs de texte ramifiés, reliés, s’engendrant les uns les autres comme un gigantesque polype » [229]. Cette « cellule de papier » varie encore la métaphore – détrivialisée dans un nouveau contexte médiatique – d’un monde-livre éclaté en feuilles éparses, étrangement animé.
3.4 Vers une biblio-philosophie de l’homme post-typographique ?
La problématique esquissée invite à quelques méditations d’ordre biblio-philosophique. Si l’être humain est un « animale fabulatore per natura » [230], il est aussi un animal métaphorisant [231]. Or, parmi ces « Metaphors we live by » [232], le livre occupe une position de choix ; depuis des siècles, il a servi de matrice de la lecture du monde [233]. Si la théorie de Marshall McLuhan sur la psychologie spécifique du « typographic man » [234] – théorie des médias et « anthropologie historique spéculative » [235] – a été remise en question ou nuancée sous certains aspects, il n’en reste pas moins que le livre imprimé a (co-)formaté l’identité du sujet occidental moderne. Le discours sur la fin du livre implique, dans ce sens, aussi la réflexion sur un changement de nos paradigmes perceptifs et philosophiques [236]. Qu’en est-il donc aujourd’hui, à l’âge des « hommes post-typographiques » [237], du grand livre du monde, de cette « Œuvre » universelle dont rêve Alexander von Humboldt [238] ? « Ce n’est qu’une métaphore : mais le web est notre livre […] » [239], déclare François Bon, convaincu que, bien plus que le livre numérique, le vrai enjeu, « c’est le Web » [240].
L’idée borgésienne « d’un grand livre qui contiendrait tous les livres du monde et le monde » [241] apparaît plusieurs fois dans la correspondance de Houellebecq avec son co-Ennemi public BHL [242]. Houellebecq médite encore sur ce concept du livre total dans sa préface à Interventions 2 : « Tout devrait pouvoir se transformer en un livre unique, que l’on écrirait jusqu’aux approches de la mort […] » [243]. Écriture virtuellement infinie, fantasme d’un seul grand texte qui ne finirait qu’avec la « mort de l’auteur » : tout texte issu du support électronique, d’après ses réflexions, garde d’ailleurs, même dans sa forme finale, cette idée d’infinitude, la trace des innombrables fois qu’il a été retravaillé, l’écriture numérique se distinguant aussi par une « optionnalisation » sans précédent [244] : « There is no Final Word [245].»
La métaphore du livre-monde, du monde-livre, subit une transformation significative dans une vision onirique attribuée à Jed Martin, alter ego artiste de l’auteur, héros très peu héroïque, personnage (post-)postmoderne paradigmatique dont la biographie éclatée ne se prête plus au récit cohérent. Dans de pareils moments d’illumination, le monde se textualise aussi sous les yeux d’autres protagonistes houellebecquiens. Michel Djerzinski dans Les Particules élémentaires vit déjà un tel rêve méta-textuel, annonçant celui de Martin dans La Carte et le territoire (la correspondance entre les passages en question souligne la parenté manifeste entre ces deux personnages [246]) :
Il était au milieu d’un espace blanc, apparemment illimité. […] À la surface du sol se distinguaient […] des blocs de texte aux lettres noires […] ; chacun des blocs pouvait comporter une cinquantaine de mots. Jed comprit alors qu’il se trouvait dans un livre, et se demanda si ce livre racontait l’histoire de sa vie. Se penchant sur les blocs qu’il rencontrait sur sa route, il eut d’abord l’impression que oui […] mais […] la plupart des mots étaient effacés ou rageusement barrés, illisibles […]. Aucune direction temporelle ne pouvait, non plus, être définie […] [247].
4. Apocalypse (not) now : Conclusion (provisoire)
C’est sur cette vision d’un livre-monde palimpsestique, étrangement dé-livré, délinéarisé, en proie à des métamorphoses qui doivent sans doute quelque chose à la reconfiguration médiatique de nos écritures-lectures, que se termine ce voyage autour de la bibliothèque apocalyptique de la littérature française contemporaine. Le livre, probablement pour un certain temps encore, ne cessera pas de (ne pas) finir ; le discours sur la fin du livre, déjà largement centenaire, ne semble pas non plus près de prendre fin : la biblio-apocalypse, grande procrastinatrice, est toujours pour (après- ?) demain.
Notes
[1] Maurice Blanchot, Le Livre à venir [1959], Paris, Gallimard, 2003, p. 275.
[2] Voir Gérard Desportes/Alexis Lacroix, « “La France doit demeurer une nation littéraire”. Entretien avec Alain Finkielkraut », Libération, 28.01.2011. En ligne ici [02.03.2014]. Voir aussi Alain Finkielkraut, L’Identité malheureuse, Paris, Stock, 2013, p. 150, 167.
[3] François Bon, Après le livre. Qu’est-ce que l’écriture numérique change au destin du livre et aux enjeux de la littérature ?, version digitale [première mise en ligne le 15 mai 2011, dernière mise à jour le 29 juillet 2012], publie.net, « Essais », n° 411 [version imprimée : Paris, Seuil, 2011], pos. 502-503.
[4] Id., pos. 1217-1220.
[5] Nancy Katherine Hayles, Writing Machines, Cambridge, Mass./London, MIT Press, 2002, p. 33.
[6] Joseph Tabbi, « A Media Migration. Toward a Potential Literature », in Essentials of the Theory of Fiction, Michael J. Hoffman & Patrick D. Murphy (dir.), Durham/London, Duke UP, 2005, p. 471-490, ici p. 471.
[7] Norbert Bolz, Am Ende der Gutenberg-Galaxis. Die neuen Kommunikationsverhältnisse [1993], München, Wilhelm Fink, 1995, p. 195. Sauf indication contraire, c’est moi [MS] qui traduis.
[8] Severine Durande, « La fin du livre ? » [Compte rendu de François Bon, Après le livre], 09.11.2012. En ligne ici [02.03.2014].
[9] Lothar Müller, Weiße Magie. Die Epoche des Papiers, München, Hanser, 2012, p. 103.
[10] Voir Marshall McLuhan, The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man [1962], Toronto [etc.], Toronto UP, 1995.
[11] Voir Norbert Bolz, Am Ende der Gutenberg-Galaxis, op. cit., p. 180.
[12] Lothar Müller, Weiße Magie, op. cit., p. 349.
[13] Frédéric Beigbeder, Premier bilan après l’apocalypse. Essai, Paris, Grasset, 2011, p. 15.
[14] Roger Chartier, Le Livre en révolutions. Entretiens avec Jean Lebrun, Paris, Textuel, 1997, p. 9. Voir aussi Lothar Müller, Weiße Magie, op. cit., p. 121 et suiv., et les réflexions de Niklas Luhmann à ce propos (Norbert Bolz, Am Ende der Gutenberg-Galaxis, op. cit., p. 184).
[15] Umberto Eco, examinant « cette idée fixe que le livre va disparaître », souligne qu’avec l’internet, nous sommes « revenus à l’ère alphabétique. […] voilà que l’ordinateur nous réintroduit dans la galaxie de Gutenberg et tout le monde se trouve désormais obligé de lire » (Jean-Claude Carrière/Umberto Eco, N’espérez pas vous débarrasser des livres. Entretiens menés par Jean-Philippe de Tonnac [2009], Paris, Grasset, 2010, p. 16).
[16] Nam June Paik, cit. d’après Norbert Bolz, Am Ende der Gutenberg-Galaxis, op. cit., p. 203.
[17] Frédéric Beigbeder, Premier bilan après l’apocalypse, op. cit., p. 19.
[18] Pierre Robin, « Frédéric Beigbeder : la dissidence caviar », Le Spectacle du monde [Portraits], 01.09.2009 [consulté le 02.03.2014].
[19] Voir Benoît Duteurtre, « Beigbeder et son contraire », dans Frédéric Beigbeder et ses doubles. Avec un entretien et une correspondance inédits de l’écrivain, Alain-Philippe Durand (dir.), Amsterdam/New York, Rodopi, 2008, p. 51-57, ici p. 53.
[20] Voir Émilie Zapater, « Le face à face de Frédéric Beigbeder et François Bon : après le livre, l’apocalypse ? », Monde du livre, 06.07.2013. En ligne ici [05.05.2014].
[21] Frédéric Beigbeder, Premier bilan après l’apocalypse, op. cit., p. 26.
[22] Alain-Philippe Durand, « Entretien avec Frédéric Beigbeder » [2006], dans : Durand (dir.), Frédéric Beigbeder et ses doubles, op. cit., p. 17-37, ici p. 20 ; voir aussi Frédéric Beigbeder, Premier bilan après l’apocalypse, op. cit., p. 263.
[23] Michel Houellebecq, La Carte et le Territoire, Paris, Flammarion, 2010, p. 130.
[24] Frédéric Beigbeder, Premier bilan après l’apocalypse, op. cit., p. 26.
[25] Caroline Parlanti, « Frédéric Beigbeder contre la dictature d’internet et du numérique : je dis bravo ! », Le Nouvel Observateur, 24.08.2012. En ligne ici [02.03.2014].
[26] Voir Laurent Martinet, « Frédéric Beigbeder face à François Bon : le livre numérique est-il une apocalypse? », L’Express, 15.11.2011. En ligne ici [05.05.2014].
[27] Voir Caroline Parlanti, « Frédéric Beigbeder contre la dictature d’internet et du numérique », art. cit. ; Nicolas Gary, « Beigbeder paranoïaque : le livre numérique, c’est l’apocalypse », ActuaLitté. Les Univers du livre, 07.09.2011. En ligne ici [02.03.2014].
[28] Frédéric Beigbeder, Premier bilan après l’apocalypse, op. cit., p. 15.
[29] Voir « L’écrivain Frédéric Beigbeder s’oppose vivement à la dématérialisation des ouvrages » [Interview par Nikos Aliagas], Europe 1, 22.09.2011. [consulté le 18.08.2014].
[30] Frédéric Beigbeder, Dernier inventaire avant liquidation [2001], Paris, Gallimard, 2003, p. 14.
[31] Frédéric Beigbeder, Premier bilan après l’apocalypse, op. cit., p. 11 et suiv.
[32] Vilém Flusser, Die Schrift, cit. d’après Norbert Bolz, Am Ende der Gutenberg-Galaxis, op. cit., p. 183.
[33] Voir Jacques Derrida, « Das Papier oder ich, wissen Sie… (Neue Spekulationen über einen Luxus der Armen) » [Entretien avec Marc Guillaume et Daniel Bougnoux, 1997], in : Maschinen Papier. Das Schreibmaschinenband und andere Antworten (éd. par Peter Engelmann), Wien, Passagen, 2006, p. 221-249, ici p. 224.
[34] Jorge Luis Borges, « Das Buch » [1978], dans : Die letzte Reise des Odysseus. Vorträge und Essays 1978-1982, Frankfurt a. M., Fischer, 2001, p. 13-22, ici p. 16.
[35] Voir Annemarie Schimmel, Das Buch der Welt. Wirklichkeit und Metapher im Islam, Würzburg, Ergon, 1996, p. 5.
[36] Octave Uzanne, « La Fin des livres (Suggestions d’avenir) », dans : Octave Uzanne/Albert Robida, Contes pour les bibliophiles, Paris, May et Motteroz, 1895, p. 125-145, ici p. 125 [consulté le 01.03.2014].
[37] Id., p. 130.
[38] Id., p. 145.
[39] Id., p. 128.
[40] Id., p. 132.
[41] Id., p. 135.
[42] Id., p. 145.
[43] Stefan Zweig, « Das Buch als Eingang zur Welt » [1931], Begegnungen mit Büchern. Aufsätze und Einleitungen aus den Jahren 1902-1939, Frankfurt a. M., Fischer, 1983, p. 7-17.
[44] Id., p. 8 et suiv.
[45] Id., p. 8. Des décennies après Zweig, Umberto Eco médite de même sur le caractère « presque biologique » de l’écriture, « [t]andis que nos inventions modernes, cinéma, radio, Internet, ne sont pas biologiques » (Jean-Claude Carrière/Umberto Eco, N’espérez pas vous débarrasser des livres, op. cit., p. 19) ; il arrive, lui aussi, à la conclusion que « Le livre ne mourra pas » (id., p. 15 et suiv.).
[46] Stefan Zweig, « Das Buch als Eingang zur Welt », art. cit., p. 16 et suiv.
[47] Voir Sigmund Freud, « Das Unbehagen in der Kultur » [1929/1930], Studienausgabe, t. IX : Fragen der Gesellschaft. Ursprünge der Religion, Frankfurt a. M., Fischer, 2000, p. 191-270, ici p. 222.
[48] Voir Marshall McLuhan, Understanding Media. The Extensions of Man, London, Routledge & Kegan Paul, 1964.
[49] Jorge Luis Borges, « Das Buch », art. cit., p. 13.
[50] Jorge Luis Borges, « Del culto de los libros », cit. d’après Adelheid Hanke-Schaefer, Jorge Luis Borges zur Einführung, Hamburg, Junius, 1999, p. 11.
[51] « Borges de la A a la Z », cit. d’après Gloria Nistal Rosique, Espejos, laberintos, bibliotecas y otras cifras. La estética de Borges, Madrid, Sial, 2010, p. 56sq.
[52] Jorge Luis Borges, « Das Buch », art. cit., p. 21.
[53] Beigbeder, Premier bilan après l’apocalypse, op. cit., p. 21. Voir aussi Roger Chartier, analysant « la révolution du texte électronique » comme « un pas supplémentaire dans ce processus de dématérialisation, de décorporalisation de l’œuvre » sans pathos apocalyptique (Le Livre en révolutions, op. cit., p. 67).
[54] Voir « L’écrivain Frédéric Beigbeder s’oppose vivement à la dématérialisation des ouvrages », interview cit.
[55] Philippe Leclercq, « Et si le livre électronique signait la fin de notre civilisation ? », Le Nouvel Observateur, 16.04.2012 [consulté le 02.03.2014].
[56] Il est éclairant de reconsidérer ce discours sur la perte de la sensualité de la lecture dans son contexte biblio-historique. Le narrateur d’Uzanne insiste justement sur l’aspect sensoriel : de nouveaux dispositifs médiatiques procureront aux lecteurs, métamorphosés en « heureux auditeurs », « le plaisir ineffable de concilier l’hygiène et l’instruction » (« La Fin des livres », op. cit., p. 138).
[57] Voir le titre d’Évanghélia Stead, La Chair du livre. Matérialité, imaginaire et poétique du livre fin-de-siècle (Paris, PUPS, 2012).
[58] Voir « L’écrivain Frédéric Beigbeder s’oppose vivement à la dématérialisation des ouvrages », interview cit.
[59] Frédéric Beigbeder, Premier bilan après l’apocalypse, op. cit., p. 19.
[60] Voir Lothar Müller, Weiße Magie, op. cit., p. 344.
[61] François Bon, Après le livre, op. cit., pos. 1638.
[62] Id., pos. 1658-1663.
[63] Cité d’après Nicolas Gary, « Beigbeder paranoïaque : le livre numérique, c’est l’apocalypse », art. cit.
[64] Frédéric Beigbeder, Premier bilan après l’apocalypse, op. cit., p. 18.
[65] Lothar Müller, Weiße Magie, op. cit., p. 352. Voir aussi Norbert Bolz, Am Ende der Gutenberg-Galaxis, op. cit., p. 111.
[66] Norbert Bolz, Am Ende der Gutenberg-Galaxis, op. cit., p. 200.
[67] Voir Roger Chartier, Le Livre en révolutions, op. cit., p. 13 et suiv. ; Jean-Claude Carrière/Umberto Eco, N’espérez pas vous débarrasser des livres, op. cit., p. 103.
[68] Frédéric Beigbeder, Premier bilan après l’apocalypse, op. cit., p. 18.
[69] Lucien Febvre/Henri-Jean Martin, L’Apparition du livre, Paris, Albin Michel, 1958, p. 394.
[70] Norbert Bolz, Am Ende der Gutenberg-Galaxis, op. cit., p. 198.
[71] Voir, à ce propos, aussi Roger Chartier, Le Livre en révolutions, op. cit., p. 88.
[72] « L’écrivain Frédéric Beigbeder s’oppose vivement à la dématérialisation des ouvrages », interview cit.
[73] Voir, p. ex., Laurent Martinet, « Frédéric Beigbeder face à François Bon », art. cit. ; Emilie Zapater, « Le face à face de Frédéric Beigbeder et François Bon », art. cit.
[74] Interview sur Le Point.fr, 09.06.2010, cit. d’après Stéphane Ternoise, Réponses à monsieur Frédéric Beigbeder au sujet du Livre Numérique, Jean-Luc Petit Éditions, « Essais » [format électronique], 14.10.2011, pos. 614-615.
[75] Frédéric Beigbeder, Premier bilan après l’apocalypse, op. cit., p. 13.
[76] Id., p. 16 et suiv.
[77] Id., p. 12.
[78] Voir, p. ex., Lucien Febvre & Henri-Jean Martin, L’Apparition du livre, op. cit., p. 43 et suiv. ; Lothar Müller, Weiße Magie, op. cit., p. 200.
[79] Lothar Müller, Weiße Magie, op. cit., p. 145 et p. 167.
[80] Camille Tenneson, « Chloé Delaume : “Le numérique est une ouverture sur la littérature” », Le Nouvel Observateur, 24.04.2009. En ligne ici [26.06.2014].
[81] Élisabeth Philippe, « Virginie Despentes : “Je crains les facilités qu’offre le numérique : si on veut censurer une page, on l’efface des liseuses” » [Entretien], Les Inrockuptibles, 23.03.2013. En ligne ici [26.06.2014].
[82] Maurice Blanchot, Le Livre à venir, op. cit., p. 273.
[83] Id., p. 265.
[84] Alain-Philippe Durand, « Entretien avec Frédéric Beigbeder », art. cit., p. 19.
[85] Frédéric Beigbeder, Premier bilan après l’apocalypse, op. cit., p. 17.
[86] Jean-Claude Carrière/Umberto Eco, N’espérez pas vous débarrasser des livres, op. cit., p. 111.
[87] V. Christophe Berliocchi, « Frédéric Beigbeder : “Internet, c’est l’empire de la méchanceté, de la bêtise” », Sud Ouest, 24.08.2012. En ligne ici [02.03.2014].
[88] Voir Pierre Lévy, Cyberdémocratie, Paris, Odile Jacob, 2002.
[89] François Bon, Après le livre, op. cit., pos. 1639-1640.
[90] Ibid., pos. 1941-1942.
[91] Ibid., pos. 2681-2682.
[92] Ibid., pos. 1108-1109.
[93] Stéphane Ternoise, Réponses à monsieur Frédéric Beigbeder au sujet du Livre Numérique, op. cit., pos. 853-854.
[94] Ternoise va jusqu’à saluer l’arrivée de l’Amazon Kindle en France comme « [u]n vrai débarquement pour libérer les écrivains français » (id., pos. 23-25).
[95] Le 18.08.2009 sur France Inter, dans le cadre de l’émission « Ça vous dérange » ; cit. d’après Stéphane Ternoise, Réponses à monsieur Frédéric Beigbeder au sujet du Livre Numérique, op. cit., pos. 792. Cf. aussi Nicolas Gary, « Jean-Marc Roberts (Stock) : l’ebook, c’est bon pour les SDF », ActuaLitté. Les Univers du livre, 18.08.2009 [consulté le 02.03.2014].
[96] François Bon, Après le livre, op. cit., pos. 1276-1277.
[97] Severine Durande, « La fin du livre ? », art. cit. Cette vision d’une démocratisation de la culture post-livresque s’inscrit, elle aussi, dans une tradition intertextuelle. Le narrateur d’Octave Uzanne explique déjà que, suite à « La Fin des livres », « l’auteur deviendra son propre éditeur » ; à part les biblio- ou plutôt « phonographophiles » aisés, le « peuple », lui aussi, « pourra se griser de littérature comme d’eau claire, à bon compte, car il aura ses distributeurs littéraires des rues comme il a ses fontaines » (op. cit., p. 135 et suiv.).
[98] Roger Chartier, Le Livre en révolutions, op. cit., p. 16 et suiv..
[99] Norbert Bolz, Am Ende der Gutenberg-Galaxis, op. cit., p. 199 et suiv., 222.
[100] Voir Lucien Febvre/Henri-Jean Martin, L’Apparition du livre, op. cit., p. 244 ; Lothar Müller, Weiße Magie, op. cit., p. 123 et suiv.
[101] Voir Lothar Müller, Weiße Magie, op. cit., p. 344.
[102] Voir Norbert Bolz, Am Ende der Gutenberg-Galaxis, op. cit., p. 223.
[103] François Bon, Après le livre, op. cit., pos. 2280-2281.
[104] Voir Marc Prensky, « Digital Natives, Digital Immigrants », On the Horizon (MCB UP, Vol. 9, n° 5, oct. 2001), [consulté le 02.03.2014].
[105] « Numéro 36 : “Les Jolies Choses” de Virginie Despentes (1998) » (Frédéric Beigbeder, Premier bilan après l’apocalypse, op. cit., p. 260-264).
[106] Beigbeder y préfère pourtant Les Jolies Choses, exemptes de ce « militantisme lesbien confinant à l’hétérophobie » (id., p. 263) qu’il reproche à Apocalypse bébé.
[107] Id., p. 260.
[108] « […] Despentes rock’n’viole notre idiome national. […] Avec elle, le français reste une langue vivante » (id., p. 261).
[109] Ibid.
[110] « Un livre ne doit pas parler comme un livre » (ibid.).
[111] Frédéric Beigbeder, Dernier inventaire avant liquidation, op. cit., p. 13.
[112] Voir Luc Le Vaillant, « Biaise-moi » [Portrait], Libération, 30.07.2004 [consulté le 02.03.2014].
[113] Dans les romans de Despentes, peuplés par des personnages marginaux, mais doués de la « lucidité spéciale des dominés » (Pierre Bourdieu, La Domination masculine, Paris, Seuil, 1998, p. 37), ce sont les losers (et « looseuses ») qui font figure de vrais héros – et surtout héroïnes ; l’écrivain revendique sa propre position du côté de chez les « Bad Lieutenantes » (King Kong Théorie [2006], Paris, Grasset, 2008, p. 9 et suiv.).
[114] Voir Josyane Savigneau, « Virginie Despentes : “Je ne suis pas encore très disciplinée, mais j’essaie” », Le Monde des livres, 26.08.2010 [consulté le 02.03.2014].
[115] Voir Élisabeth Philippe, « Virginie Despentes : “Je crains les facilités qu’offre le numérique” », art. cit.
[116] Voir Virginie Despentes, Apocalypse bébé, Paris, Grasset, 2010, p. 99.
[117] Ibid., p. 135sq.
[118] Voir Josyane Savigneau, « Virginie Despentes : “Je ne suis pas encore très disciplinée” », art. cit.
[119] Virginie Despentes, Apocalypse bébé, op. cit., p. 41.
[120] Id., p. 19.
[121] Id., p. 104.
[122] Id., p. 47.
[123] Id., p. 74.
[124] Id., p. 40.
[125] Id., p. 165.
[126] Voir id., p. 93 et suiv.
[127] Id., p. 276, 327.
[128] Id., p. 328.
[129] Voir Marianne Costa, « Despentes : anarcho-féministe » [Interview], le magazine.info, 08.06.2007 [consulté le 02.03.2014].
[130] Voir Béatrice Vallaeys & François Armanet, « Trois femmes s’emparent du sexe. Interview : Catherine Breillat (Une vraie jeune fille) dialogue avec Virginie Despentes et Coralie Trinh Thi (Baise-moi) », Libération, 13.06.2000 [consulté le 02.03.2014].
[131] Virginie Despentes, King Kong Théorie, op. cit., p. 145.
[132] Virginie Despentes, Apocalypse bébé, op. cit., p. 302.
[133] Id., p. 250.
[134] Id., p. 323 et suiv.
[135] Id., p. 109.
[136] Voir Xavier de la Porte, « Apocalypse Bébé : Internet, matrice du récit », InternetActu.net, 14.02.2011 [consulté le 02.03.2014].
[137] Virginie Despentes, Apocalypse bébé, op. cit., p. 290 et suiv.
[138] Id., p. 100.
[139] Günther Anders, Die Antiquiertheit des Menschen, t. I : Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution [1956], München, Beck, 1992, p. 135, 141.
[140] Voir Gilles Deleuze, « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle » [1990], Pourparlers 1972-1990, Paris, Minuit, 2009, p. 240-247, ici p. 244.
[141] Virginie Despentes, Apocalypse bébé, op. cit., p. 343.
[142] Comme pour « Virginie Despentes », il s’agit d’un pseudonyme littéraire – ou bien d’« un geste performatif » (Chloé Delaume, Une femme avec personne dedans. Roman, Paris, Seuil, 2012, p. 14), donnant naissance à ce « personnage de fiction » que se déclare C. D. (voir La Règle du Je. Autofiction. Un essai, Paris, PUF, 2010, p. 5, 21, 79, 82 ; La Dernière Fille avant la guerre, Paris, Naïve, 2007, p. 8, 63, 103 ; Une femme avec personne dedans, op. cit., p. 13, 17, 113, et passim). Voir aussi Barbara Havercroft, « Le soi est une fiction » [Entretien avec Chloé Delaume], Revue critique de fixxion française contemporaine, 4, « Fictions de soi », 2012 [consulté le 26.06.2014].
[143] Voir Arnaud Genon, « De l’autofiction expérimentale (Sur Chloé Delaume, La règle du je) », autofiction.org, 29.04.2010 [consulté le 02.03.2014].
[144] Chloé Delaume, La Règle du Je, op. cit., p. 62.
[145] Voir le titre d’Emmanuel Carrère (Paris, P.O.L., 2009).
[146] Voir Éric Neuhoff, « La subversive et l’inclassable. Deux femmes écrivains loin des codes et des modes », Le Figaro Madame, 28.11.2010 [consulté le 02.03.2014].
[147] Chloé Delaume, La Règle du Je, op. cit., p. 68.
[148] Voir Minh Tran Huy, « Entretien avec Chloé Delaume », Zone littéraire, 08.11.2001. en ligne ici [02.03.2014].
[149] Renaud Pasquier, « L’œuvre indistincte (Vasset, Volodine, Delaume, Bon) », in La caméra des mots. Dans le spectacle du roman, Matteo Majorano (dir.), Bari, B.A. Graphis, 2007, p. 49-69, ici p. 61.
[150] Chloé Delaume, La Règle du Je, op. cit., p. 66.
[151] Chloé Delaume, Certainement pas (Paris, Verticales, 2004), cité d’après Renaud Pasquier, « L’œuvre indistincte », art. cit., p. 60.
[152] Voir Minh Tran Huy, « Entretien avec Chloé Delaume », art. cit.
[153] Voir Alexandra Galakof, « “Se divertir avec la littérature, c’est grave… politiquement”(Chloé Delaume) », L’Express. Blog Café livres, 09.02.2009 [consulté le 02.03.2014].
[154] Chloé Delaume, J’habite dans la télévision, Paris, Verticales, 2006, p. 95.
[155] Chloé Delaume, La Règle du Je, op. cit., p. 77 et suiv.
[156] Id., p. 57.
[157] Chloé Delaume, La Dernière Fille avant la guerre, op. cit., p. 60.
[158] Chloé Delaume, La Règle du Je, op. cit., p. 89 [Annexe]. V. à ce propos aussi Christian Salmon, Verbicide. Du bon usage des cerveaux humains disponibles [2005], Arles, Actes Sud, 2007 [éd. actualisée], p. 16, 57 et suiv.
[159] En ligne ici [consulté le 08.06.2012].
[160] Chloé Delaume, J’habite dans la télévision, op. cit., p. 12.
[161] Ibid., p. 16.
[162] Chloé Delaume, La Règle du Je, op. cit., p. 7 ; cf. aussi p. 56.
[163] Chloé Delaume, J’habite dans la télévision, op. cit., p. 17.
[164] Camille Tenneson, « Chloé Delaume : “Le numérique est une ouverture sur la littérature” », art. cit.
[165] Dawn Cornelio, « Nimphaea in fabula : le bouquet d’histoires de Chloé Delaume. Par Marika Piva (2012) » [Compte rendu], French Studies, n° 68:1, 2014, p. 129-130, ici p. 129 [consulté le 26.06.2014].
[166] Voir « 24 h dans la vie de Chloé Delaume » [Entretien par Colette Fellous], France Culture, 09.08.2009. Transcription par Maryse Legrand disponible sur [consulté le 26.06.2014].
[167] Chloé Delaume, La Règle du Je, op. cit., p. 62.
[168] Id., p. 87 [Annexe].
[169] Ainsi dans J’habite dans la télévision (op. cit., p. 110sq. ; voir aussi La Règle du Je, op. cit., p. 90 et suiv. [Annexe]). Dans La Dernière Fille avant la guerre, Delaume parallélise « pacte de lecture » littéraire et « pacte d’écoute » musical (op. cit., p. 99) ; elle esquisse même la perspective d’une autofiction « musicale » (voir La Règle du Je, op. cit., p. 93 [Annexe]).
[170] Chloé Delaume, Corpus Simsi. Incarnation virtuellement temporaire, Paris, Léo Scheer, 2003, p. 124.
[171] Norbert Bolz, Am Ende der Gutenberg-Galaxis, op. cit., p. 223.
[172] Chloé Delaume, Corpus Simsi, op. cit., p. 124 et suiv.
[173] Dans le monde simsien, s’insère une fiction de second degré, les « Sims Alpha » jouant aux « Sims Bêta », ces « sous-Sims » (id., p. 103).
[174] Voir, évidemment, la fameuse formule de Stéphane Mallarmé (Œuvres complètes, vol. II. éd. par Bertrand Marchal, Paris, Gallimard,« Pléiade », 2003, p. 224).
[175] Voir Norbert Bolz, Am Ende der Gutenberg-Galaxis, op. cit., p. 8, 203.
[176] Chloé Delaume, Corpus Simsi, op. cit., p. 5.
[177] Id., p. 50.
[178] Id., p. 63.
[179] Id., p. 124.
[180] Id., p. 107.
[181] Id., p. 116.
[182] Chloé Delaume, La Règle du Je, op. cit., p. 91 [Annexe]. Pour Certainement pas, autre livre-jeu, Delaume emprunte la structure du Cluedo.
[183] Version française : Buffy contre les vampires.
[184] Chloé Delaume, La Règle du Je, op. cit., p. 92sq. [Annexe].
[185] Chloé Delaume, La Nuit je suis Buffy Summers, Paris, è®e, 2007, p. 13.
[186] Id., p. 106.
[187] Id., p. 10sq.
[188] Id., p. 77.
[189] Id., p. 45.
[190] Id., p. 73.
[191] Id., p. 59, voir aussi p. 96 et suiv.
[192] Id., p. 99.
[193] Id., p. 87.
[194] Id., p. 107.
[195] Id., p. 47.
[196] Iid., p. 100.
[197] Id., p. 68, voir aussi p. 34 et suiv., 43.
[198] Iid., p. 112 et suiv.
[199] Voir, p. ex., Philippe Leclercq, « Et si le livre électronique signait la fin de notre civilisation ? », art. cit.
[200] Jacques Derrida, L’écriture et la différence [1967], Paris, Seuil, 2006, p. 429 ; cité. par Norbert Bolz, Am Ende der Gutenberg-Galaxis, op. cit., p. 192.
[201] Walter Benjamin, cit. d’après Norbert Bolz, Am Ende der Gutenberg-Galaxis, op. cit., p. 196.
[202] François Bon, Après le livre, op. cit., pos. 1234-1235.
[203] Id., pos. 1236-1237.
[204] Michel Houellebecq & Bernard-Henri Lévy, Ennemis publics, Paris, Flammarion/Grasset, 2008, p. 263.
[205] Id., p. 269.
[206] V. Christian Salmon, Verbicide, op. cit., p. 60.
[207] Michel Houellebecq & Bernard-Henri Lévy, Ennemis publics, op. cit., p. 270 et p. 234.
[208] Michel Houellebecq, « Approches du désarroi » [1992], Interventions 2 : traces, Paris, Flammarion, 2009, p. 21-45, ici p. 31 et suiv.
[209] Die neue Typographie. Ein Handbuch für Zeitgemäss Schaffende (1928 ; v. Lothar Müller, Weiße Magie, op. cit., p. 316).
[210] Norbert Bolz, Am Ende der Gutenberg-Galaxis, op. cit., p. 197 et suiv.
[211] François Bon, Après le livre, op. cit., pos. 392-393.
[212] Lothar Müller, Weiße Magie, op. cit., p. 133.
[213] Jacques Derrida, « Das Papier oder ich, wissen Sie… », art. cit., p. 245.
[214] Michel Houellebecq, « Approches du désarroi », op. cit., p. 32 et suiv. Voir aussi Martin de Haan, « Entretien avec Michel Houellebecq », in : Sabine van Wesemael (dir.), Michel Houellebecq, Amsterdam/New York, Rodopi, 2004, p. 9-27, ici p. 17.
[215] Michel Houellebecq, La Carte et le territoire, op. cit., p. 170 et suiv.
[216] Id., p. 254.
[217] Michel Houellebecq, « Approches du désarroi », op. cit., p. 34. Houellebecq adopte, significativement, des positions différentes selon son rôle respectif d’auteur ou de lecteur. Tandis que Houellebecq l’auteur « [s]’intéresse surtout à l’objet-livre » (« Entretien avec Gilles Martin-Chauffier et Jérôme Béglé » [2006], in : Interventions 2, op. cit., p. 255-265, ici p. 263), ce même objet le laisse indifférent en tant que lecteur (« J’ai lu toute ma vie », Interventions 2, op. cit., p. 267-273, ici p. 273).
[218] Voir Martin de Haan, « La mise à distance du monde : entretien avec Michel Houellebecq », Speakers Academy Magazine, mai 2011 ; en ligne: 15.05.2011 [consulté le 02.03.2014].
[219] Michel Houellebecq, « Approches du désarroi », op. cit., p. 45.
[220] Voir Julia Kristeva, Étrangers à nous-mêmes, Paris, Fayard, 1988.
[221] V. Michel Houellebecq, Poésie, Paris, J’ai lu, 2010, p. 236.
[222] Id., p. 40 [Le Sens du combat].
[223] Michel Houellebecq, « Approches du désarroi », op. cit., p. 40.
[224] Autre mort annoncée depuis des décennies : dès 1925, José Ortega y Gasset considère le roman « como una cantera de vientre enorme, pero finito » (« Ideas sobre la novela », in : Obras completas, Madrid, Alianza, 1987, t. 3, p. 387-419, ici p. 388).
[225] Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte [1994], Paris, Flammarion, 1999, p. 42.
[226] Michel Houellebecq, La Carte et le territoire, op. cit., p. 258 et suiv.
[227] Michel Houellebecq, « Lettre à Lakis Proguidis » [1997], in : Interventions 2, op. cit., p. 149-156, ici p. 152.
[228] Voir Martin de Haan, « Entretien avec Michel Houellebecq », art. cit., p. 10 et p. 26.
[229] Michel Houellebecq, La Carte et le territoire, op. cit., p. 184 et suiv.
[230] Alasdair C. MacIntyre affirme à son tour que « man is […] essentially a story-telling animal » (After Virtue. A Study in Moral Theory [1981], London, Duckworth, 1999, p. 216).
[231] Voir Norbert Bolz, Am Ende der Gutenberg-Galaxis, op. cit., p. 163.
[232] Voir George Lakoff/Mark Johnson, Metaphors we live by, Chicago, Ill. [etc.], Univ. of Chicago Press, 1980.
[233] Voir Hans Blumenberg, Die Lesbarkeit der Welt [1981], Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1993.
[234] Voir Marshall McLuhan, The Gutenberg Galaxy, op. cit.
[235] Lothar Müller, Weiße Magie, op. cit., p. 86.
[236] Voir François Bon, Après le livre, op. cit., pos. 1524-1528.
[237] Norbert Bolz, Am Ende der Gutenberg-Galaxis, op. cit., p. 194.
[238] Voir id., p. 110.
[239] François Bon, Après le livre, op. cit., pos. 2072-2073.
[240] Laurent Martinet, « Frédéric Beigbeder face à François Bon », art. cit.
[241] L’œuvre de Borges, biblio-philosophe par excellence – « Le livre est en principe le monde pour lui, et le monde est un livre » (Maurice Blanchot, Le Livre à venir, op. cit., p. 131) –, a été, ces dernières années, l’objet de relectures la mettant en rapport avec les nouveaux médias (voir Perla Sassón-Henry, Borges 2.0. From Text to Virtual Worlds, New York/Vienna [etc.], Lang, 2007 ; Dante Augusto Palma, Borges.com. La ficción de la filosofía, la política y los medios, Buenos Aires, Biblos, 2010).
[242] Michel Houellebecq & Bernard-Henri Lévy, Ennemis publics, op. cit., p. 284 [BHL], voir aussi p. 170.
[243] Michel Houellebecq, « Avant-propos » [2008], Interventions 2, op. cit., p. 7-8, ici p. 8. Voir aussi les réflexions similaires de François Bon : « Nous serions alors chacun l’écrivain d’un seul livre. Ce livre grandirait avec nous […]. Il serait fait de toutes nos traces […] » (Après le livre, op. cit., pos. 2048-2049).
[244] Voir Lothar Müller, Weiße Magie, op. cit., p. 342, 351.
[245] Ted Nelson, Literary Machines, cit. d’après Norbert Bolz, Am Ende der Gutenberg-Galaxis, op. cit., p. 218.
[246] Voir aussi l’errance de « Daniel 1 » à travers l’installation de Vincent Greilsamer, « l’artiste élohimite » (La Possibilité d’une île [2005], Paris, Fayard, 2007, p. 144), autre espace textualisé (id., p. 150sqq.).
[247] Michel Houellebecq, La Carte et le territoire, op. cit., p. 153.
Bibliographie
ANDERS, Günther, Die Antiquiertheit des Menschen, t. I : Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution [1956], München, Beck, 1992.
BEIGBEGER, Frédéric, Dernier inventaire avant liquidation [2001], Paris, Gallimard, 2003.
—, Premier bilan après l’apocalypse. Essai, Paris, Grasset, 2011.
BERLIOCCHI, Christophe, « Frédéric Beigbeder : “Internet, c’est l’empire de la méchanceté, de la bêtise” », Sud Ouest, 24.08.2012 [consulté le 02.03.2014].
BLANCHOT, Maurice, Le Livre à venir [1959], Paris, Gallimard, 2003.
BLUMENBERG, Hans, Die Lesbarkeit der Welt [1981], Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1993.
BOLZ, Norbert, Am Ende der Gutenberg-Galaxis. Die neuen Kommunikationsverhältnisse [1993], München, Wilhelm Fink, 1995.
BON, François, Après le livre. Qu’est-ce que l’écriture numérique change au destin du livre et aux enjeux de la littérature ?, version digitale [première mise en ligne le 15 mai 2011, dernière mise à jour le 29 juillet 2012], publie.net, coll. « Essais », n° 411 [version imprimée : Paris, Seuil, 2011].
BORGES, Jorge Luis, « Das Buch » [1978], Die letzte Reise des Odysseus. Vorträge und Essays 1978-1982, Frankfurt a. M., Fischer, 2001, p. 13-22.
BOURDIEU, Pierre, La Domination masculine, Paris, Seuil, 1998.
CARRIÈRE, Jean-Claude, ECO, Umberto, N’espérez pas vous débarrasser des livres. Entretiens menés par Jean-Philippe de Tonnac [2009], Paris, Grasset, 2010.
CHARTIER, Roger, Le Livre en révolutions. Entretiens avec Jean Lebrun, Paris, Textuel, 1997.
CORNELIO, Dawn, « Nimphaea in fabula : le bouquet d’histoires de Chloé Delaume. Par Marika Piva (2012) » [Compte rendu], French Studies, no 68:1, 2014, p. 129-130 [consulté le 26.06.2014].
COSTA, Marianne, « Despentes : anarcho-féministe » [Interview], le magazine.info, 08.06.2007 [consulté le 02.03.2014].
DELAUME, Chloé, Corpus Simsi. Incarnation virtuellement temporaire, Paris, Léo Scheer, 2003.
—, Certainement pas, Paris, Verticales, 2004.
—, J’habite dans la télévision, Paris, Verticales, 2006.
—, La Dernière Fille avant la guerre, Paris, Naïve, 2007.
—, La Nuit je suis Buffy Summers, Paris, è®e, 2007.
—, La Règle du Je. Autofiction. Un essai, Paris, PUF, 2010.
—, Une femme avec personne dedans. Roman, Paris, Seuil, 2012.
DELEUZE, Gilles, « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle » [1990], Pourparlers 1972-1990, Paris, Minuit, 2009, p. 240-247.
Derrida, Jacques, L’écriture et la différence [1967], Paris, Seuil, 2006.
—, « Das Papier oder ich, wissen Sie… (Neue Spekulationen über einen Luxus der Armen) » [Entretien avec Marc Guillaume et Daniel Bougnoux, 1997], Maschinen Papier. Das Schreibmaschinenband und andere Antworten (éd. par Peter Engelmann), Wien, Passagen, 2006, p. 221-249.
DESPENTES, Virginie, King Kong Théorie [2006], Paris, Grasset, 2008.
—, Apocalypse bébé, Paris, Grasset, 2010.
DESPORTES, Gérard/Lacroix, Alexis, « “La France doit demeurer une nation littéraire”. Entretien avec Alain Finkielkraut », Libération, 28.01.2011 [consulté le 02.03.2014].
DURAND, Alain-Philippe, « Entretien avec Frédéric Beigbeder » [2006], dans Frédéric Beigbeder et ses doubles. Avec un entretien et une correspondance inédits de l’écrivain, Alain-Philippe Durand (dir.), Amsterdam/New York, Rodopi, 2008, p. 17-37.
DURANDE, Severine, « La fin du livre ? » [Compte rendu de François Bon, Après le livre], 09.11.2012 [consulté le 02.03.2014].
DUTEURTRE, Benoît, « Beigbeder et son contraire », dans : Alain-Philippe Durand (dir.), Frédéric Beigbeder et ses doubles. Avec un entretien et une correspondance inédits de l’écrivain, Amsterdam/New York, Rodopi, 2008, p. 51-57.
FEBVRE Lucien, MARTIN, Henri-Jean, L’Apparition du livre, Paris, Albin Michel, 1958.
FINKIELKRAUT, Alain, L’Identité malheureuse, Paris, Stock, 2013.
FREUD, Sigmund, « Das Unbehagen in der Kultur » [1929/1930], Studienausgabe, t. IX : Fragen der Gesellschaft. Ursprünge der Religion, Frankfurt a. M., Fischer, 2000, p. 191-270.
GALAKOF, Alexandra, « “Se divertir avec la littérature, c’est grave… politiquement” (Chloé Delaume) », L’Express. Blog Café livres, 09.02.2009 [consulté le 02.03.2014].
GARY, Nicolas, « Jean-Marc Roberts (Stock) : l’ebook, c’est bon pour les SDF », ActuaLitté. Les Univers du livre, 18.08.2009 [consulté le 02.03.2014].
—, « Beigbeder paranoïaque : le livre numérique, c’est l’apocalypse », ActuaLitté. Les Univers du livre, 07.09.2011 [consulté le 02.03.2014].
GENON, Arnaud, « De l’autofiction expérimentale (Sur Chloé Delaume, La règle du je) », autofiction.org, 29.04.2010 [consulté le 02.03.2014].
HAAN, Martin de, « Entretien avec Michel Houellebecq », in Michel Houellebecq, Sabine van Wesemael (dir.), Amsterdam/New York, Rodopi, 2004, p. 9-27.
—, « La mise à distance du monde : entretien avec Michel Houellebecq », Speakers Academy Magazine, mai 2011 ; en ligne: 15.05.2011 [consulté le 02.03.2014].
HANKE-SCHAEFER, Adelheid, Jorge Luis Borges zur Einführung, Hamburg, Junius, 1999.
HAVERCROFT, Barbara, « Le soi est une fiction » [Entretien avec Chloé Delaume], Revue critique de fixxion française contemporaine, 4, « Fictions de soi », 2012 [consulté le 26.06.2014].
HAYLES, N[ancy] Katherine, Writing Machines, Cambridge, Mass./London, MIT Press, 2002.
HOUELLEBECQ, Michel, Extension du domaine de la lutte [1994], Paris, Flammarion, 1999.
—, La Possibilité d’une île [2005], Paris, Fayard, 2007
—, Interventions 2 : traces, Paris, Flammarion, 2009.
—, La Carte et le territoire, Paris, Flammarion, 2010.
—, Poésie, Paris, J’ai lu, 2010.
— /Lévy, Bernard-Henri, Ennemis publics, Paris, Flammarion/Grasset, 2008.
KRISTEVA, Julia, Étrangers à nous-mêmes, Paris, Fayard, 1988.
LAKOFF, George/Johnson, Mark, Metaphors we live by, Chicago, Ill. [etc.], Univ. of Chicago Press, 1980.
LECLERCQ, Philippe, « Et si le livre électronique signait la fin de notre civilisation ? », Le Nouvel Observateur, 16.04.2012. En ligne ici [consulté le 02.03.2014].
LE VAILLANT, Luc, « Biaise-moi » [Portrait], Libération, 30.07.2004. En ligne ici [02.03.2014].
LÉVY, Pierre, Cyberdémocratie, Paris, Odile Jacob, 2002.
MACINTYRE, Alasdair C., After Virtue. A Study in Moral Theory [1981], London, Duckworth, 1999.
MALLARMÉ, Stéphane, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « Pléiade », vol. II., 2003.
MARTINET, Laurent, « Frédéric Beigbeder face à François Bon : le livre numérique est-il une apocalypse? », L’Express, 15.11.2011 [consulté le 05.05.2014].
McLUHAN, Marshall, Understanding Media. The Extensions of Man, London, Routledge & Kegan Paul, 1964.
—, The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man [1962], Toronto [etc.], Toronto UP, 1995.
MINH, Tran Huy, « Entretien avec Chloe Delaume », Zone littéraire, 08.11.2001. [consulté le 02.03.2014].
MÜLLER, Lothar, Weiße Magie. Die Epoche des Papiers, München, Hanser, 2012.
NEUHOFF, Éric, « La subversive et l’inclassable. Deux femmes écrivains loin des codes et des modes », Le Figaro Madame, 28.11.2010. En ligne ici [02.03.2014].
NISTAL ROSIQUE, Gloria, Espejos, laberintos, bibliotecas y otras cifras. La estética de Borges, Madrid, Sial, 2010.
ORTEGA Y GASSET, José, « Ideas sobre la novela », Obras completas, Madrid, Alianza, 1987, t. 3, p. 387-419.
PALMA, Dante Augusto, Borges.com. La ficción de la filosofía, la política y los medios, Buenos Aires, Biblos, 2010.
PARLANTI, Caroline, « Frédéric Beigbeder contre la dictature d’internet et du numérique : je dis bravo ! », Le Nouvel Observateur, 24.08.2012. En ligne ici [02.03.2014].
PASQUIER, Renaud, « L’œuvre indistincte (Vasset, Volodine, Delaume, Bon) », in La caméra des mots. Dans le spectacle du roman, Matteo Majorano (dir.), Bari, B.A. Graphis, 2007, p. 49-69.
PHILIPPE, Élisabeth, « Virginie Despentes : “Je crains les facilités qu’offre le numérique : si on veut censurer une page, on l’efface des liseuses” » [Entretien], Les Inrockuptibles, 23.03.2013. En ligne ici [26.06.2014].
PORTE, Xavier de la, « Apocalypse Bébé : Internet, matrice du récit », InternetActu.net, 14.02.2011. En ligne ici [02.03.2014].
PRENSKY, Marc, « Digital Natives, Digital Immigrants », On the Horizon (MCB UP, Vol. 9, n° 5, oct. 2001) ; disponible en ligne ici [02.03.2014].
ROBIN, Pierre, « Frédéric Beigbeder : la dissidence caviar », Le Spectacle du monde [Portraits], 01.09.2009. En ligne ici [02.03.2014].
SALMON, Christian, Verbicide. Du bon usage des cerveaux humains disponibles [2005], Arles, Actes Sud, 2007 [éd. actualisée].
SASSÓN-HENRY, Perla, Borges 2.0. From Text to Virtual Worlds, New York/Vienna [etc.], Lang, 2007.
SAVIGNEAU, Josyane, « Virginie Despentes : “Je ne suis pas encore très disciplinée, mais j’essaie” », Le Monde des livres, 26.08.2010. En ligne ici [02.03.2014].
SCHIMMEL, Annemarie, Das Buch der Welt. Wirklichkeit und Metapher im Islam, Würzburg, Ergon, 1996.
STEAD, Évanghélia, La Chair du livre. Matérialité, imaginaire et poétique du livre fin-de-siècle, Paris, PUPS, 2012.
TABBI, Joseph, « A Media Migration. Toward a Potential Literature », in Essentials of the Theory of Fiction, Michael J. Hoffman & Patrick D. Murphy (dir.), Durham/London, Duke UP, 2005, p. 471-490.
TENNESON, Camille, « Chloé Delaume : “Le numérique est une ouverture sur la littérature” », Le Nouvel Observateur, 24.04.2009. En ligne ici [26.06.2014].
TERNOISE, Stéphane, Réponses à monsieur Frédéric Beigbeder au sujet du Livre Numérique, Jean-Luc Petit Éditions, « Essais » [format électronique], 14.10.2011.
UZANNE, Octave, « La Fin des livres (Suggestions d’avenir) », dans : Octave Uzanne & Albert Robida, Contes pour les bibliophiles, Paris, May et Motteroz, 1895, p. 125-145. En ligne ici [01.03.2014].
VALLAEYS, Béatrice & ARMANET, François, « Trois femmes s’emparent du sexe. Interview : Catherine Breillat (Une vraie jeune fille) dialogue avec Virginie Despentes et Coralie Trinh Thi (Baise-moi) », Libération, 13.06.2000. En ligne ici [02.03.2014].
ZAPATER, Emilie, « Le face à face de Frédéric Beigbeder et François Bon : après le livre, l’apocalypse ? », Monde du livre, 06.07.2013. En ligne ici [05.05.2014].
ZWEIG, Stefan, « Das Buch als Eingang zur Welt » [1931], in : Begegnungen mit Büchern. Aufsätze und Einleitungen aus den Jahren 1902-1939, Frankfurt a. M., Fischer, 1983, p. 7-17.
Sources audiovisuelles
« L’écrivain Frédéric Beigbeder s’oppose vivement à la dématérialisation des ouvrages » [Interview par Nikos Aliagas], Europe 1, 22.09.2011, disponible ici [18.08.2014].
« 24 h dans la vie de Chloé Delaume » [Entretien par Colette Fellous], France Culture, 09.08.2009. Transcription par Maryse Legrand disponible ici [26.06.2014].
Auteur
Martina Stemberger est chercheuse et enseignante à l’Institut d’Études Romanes de l’Université de Vienne en Autriche. Ses principaux domaines de recherche sont la littérature française et francophone des XXe et XXIe siècles, la littérature de voyage, les relations culturelles et littéraires franco-russes, l’imagologie comparatiste, les Gender Studies. Pour une liste complète de ses publications et autres activités scientifiques, voir ici.
Copyright
Tous droits réservés