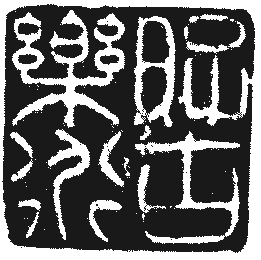La correspondance de guerre de Victor Segalen (1er août 1914 -20 mai 1919)
Texte intégral
En août 1914, Victor Segalen, Jean Lartigue et Auguste Gilbert de Voisins, après avoir terminé leur fructueuse mission archéologique, exploraient la grande boucle du Yangzi, « un joli blanc sur la carte du Yunnan », au Sud-Ouest de la Chine, près de la frontière tibétaine. Tandis que ses deux compagnons effectuaient des relevés topographiques le long du fleuve, Segalen a emprunté, seul avec le gros de la caravane, un chemin déjà connu, par les montagnes. Il marchait en pleines futaies de pins, « hautes d’altitude et de sève », accueilli le soir par des Mossos « aux gestes doux » (5/8/1914, 515 [1]). À l’étape, au calme, il se consacrait à ses manuscrits et à sa correspondance. Il était heureux. Le jour de la mobilisation générale, le 1er août, il écrit à son fils Yvon : « Mon cher petit Yvon, Nous ne sommes plus dans un vrai pays chinois, mais dans un pays habité par des gens que les chinois appellent des sauvages, et qui ne sont pas sauvages du tout. Ce sont les Lolos et les Mossos. » (1/8/1914, 509) « Tout bien » — tels sont les derniers mots de son télégramme à Yvonne du 7 août (516) — pour lui, à cette date, la guerre n’a pas commencé.
Il aurait dû rejoindre Yvonne à Hanoï vers le 15 octobre. Ils seraient arrivés en France vers le 1er décembre pour un long congé, une installation à Paris, espérait-il. De Chine, il préparait sa carrière de sinologue en envoyant des rapports à l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres et sa vie littéraire en prenant contact avec des écrivains ; le 10 août, sa dernière lettre de voyageur paisible est adressée à Gide (518). Il envisageait un long séjour parisien consacré à la littérature, à la musique et à des conférences sur la statuaire chinoise, puis un « retour à Péking, vers Février ou Mars 1915 […]. Et nous bâtissons notre vie, autant que possible sur ce thème : 8 mois en Chine, 1 mois (aller et retour) de voyage, et 3 mois tous les hivers à Paris » consacrés à la sinologie et à la création littéraire. (19/9/1913, 237) Il précise à Yvonne le 9 avril 1914 que la « chose désirable » est une « installation prolongée » à Paris, « rive gauche, près du Luxembourg » dans un petit appartement « meublé avec nos meubles de Brest ». (9/4/1914, 388) Le « bon voyageur » organise sa vie selon son principe d’exotisme entre Paris et Pékin où il sera soit directeur d’une Fondation sinologique française, appelée aussi « Mission archéologique permanente de Pékin », soit « Inspecteur des Antiquités » pour le gouvernement chinois. Quoi qu’il en soit, il fera de la sinologie son « bouclier définitif contre l’abominable médecine. Au moins, écrit-il, me conduit-elle tout droit à la Terre promise de l’art des âges anciens » (19/2/1914, 316). Pour ajouter une dimension « exotique » à ce programme, il envisage une croisière en Polynésie avec Yvonne, Lartigue et Gilbert de Voisins, et leurs épouses. Mais voilà que l’irruption de la « guerre moderne », dans sa sauvagerie, brise tous ces projets.
Segalen reçoit la nouvelle de la guerre « le 11 Août, à 8 h du matin, seul, au sommet d’un col, dans la brume » écrit-il à Yvonne (Haiphong, 28/8/1914, 519). De Lijiang, Augusto lui avait envoyé un messager porteur de ce billet : « Mon vieux. La guerre est déclarée depuis le 5 août entre la France, l’Angleterre et la Russie contre l’Allemagne et l’Autriche. Augusto [2]. » Segalen rejoindra Yvonne à Saigon le 7 septembre, ils arriveront à Marseille le 6 octobre. Il avait demandé à être envoyé dans les « régiments de marins qui se battent dans l’est » (à ses parents 11/10/1914, 520), mais il est d’abord affecté à l’hôpital de Rochefort, puis en novembre retourne à Brest. L’administration militaire avait besoin de médecins dans les hôpitaux pour soigner les dizaines de milliers de blessés des terribles combats d’août à novembre 1914 [3].
Après qu’il eut arpenté, libre, les sublimes paysages du Yunnan, le retour à l’hôpital militaire de Brest fut pour Segalen une chute très brutale. Écrire à ses compagnons de la mission archéologique (Gilbert de Voisins et surtout Lartigue), à ses maîtres en sinologie (Édouard Chavannes et Henri Cordier) et en philosophie (Jules de Gaultier), à son éditeur Crès, à des écrivains (Claudel, Saint-Pol-Roux), à ses amis proches (Georges Daniel de Monfreid, Henry Manceron, Jean Fernet) lui permet de penser en dialogue avec eux, de faire vivre ses projets. Depuis sa jeunesse, les conversations avec ses amis, parfois accompagnées de la pipe Tibétaine ou d’une de ses sœurs aînées, stimulaient son imagination créatrice et ont parfois aidé à faire surgir des idées d’œuvres nouvelles. Si solitaire qu’il soit pour créer, à l’aube, « aux heures thibétaines, aux heures du soi-même » (à Hélène Hilpert, 31/10/1918, 1162), Segalen a besoin d’échanger avec ses proches, particulièrement avec Yvonne, devenue une véritable collaboratrice de son entreprise littéraire. Elle s’intéresse aux ébauches, écoute les premières lectures, copie des manuscrits, s’occupe des épreuves, de la diffusion des textes. Quand Segalen se trouve loin d’elle, sur le front ou en Chine, elle est de loin la destinataire principale de ses lettres. Elle constitue le point central qui le relie aux siens et à lui-même — en tant qu’artiste. Or c’est en tant qu’artiste qu’il fait face à la guerre. Nous allons assister à travers ses lettres à la confrontation entre les dévastations de la guerre industrielle et un artiste qui affirmait son « désir permanent de tendre partout à la beauté, d’en réaliser un reflet dans ses pensées, dans ses actes et surtout dans ses œuvres » (à Claudel 15/3/1915, 565).
Dans un premier temps, il prend le parti de maintenir la guerre à distance : il se désintéresse des événements, s’efforce de continuer son œuvre. Ses lettres tentent de raffermir le réseau de ses amis et de renforcer ses liens avec le milieu intellectuel et artistique. Mais l’expérience du front à Nieuport l’amène à changer sa vision de la guerre en cours, ce qu’il exprime de manière diverse en fonction de ses destinataires. Après la gastrite aiguë qui l’a épuisé, il retourne à l’hôpital militaire de Brest. Il s’efforce à nouveau de reprendre le fil de son œuvre et de sa vie d’artiste, correspond avec ses amis et ses relations du milieu littéraire. Il soutient de plus en plus fermement que son combat essentiel se situe hors de la guerre, c’est « la bataille de l’homme contre les Puissances des Ténèbres » pour « la Connaissance » (à Yvonne, 15/1/18, 1057). Son long voyage pour examiner des travailleurs chinois, du 25 janvier 1917 au 6 mars 1918, lui permet de compléter ses recherches sur la « Grande Statuaire » chinoise et de se consacrer davantage à l’écriture, c’est là qu’il commence son dernier poème Thibet. Ses lettres à Yvonne prennent alors une importance primordiale tant par leur nombre que par leur contenu. Elle apparaît non seulement dans son rôle de collaboratrice efficace mais surtout elle rattache Segalen à la possibilité d’un avenir après « la Grande Chose ». Sa troisième installation à l’hôpital de Brest a été encore plus difficile que les deux précédentes. Il est amaigri, physiquement affaibli par son séjour en Extrême-Orient, désespéré par la guerre, une nouvelle correspondance tente de briser, un temps, la gangue qui l’enserre : Hélène Hilpert prendra de plus en plus de place.
1. « Embaumé » à Brest, novembre 1914-fin avril 1915 (p. 526-584)
Les lettres les plus importantes de cette époque sont adressées à Lartigue, lieutenant de vaisseau (capitaine) sur le front à Nieuport en Belgique. Segalen souhaitait alors être lui aussi affecté sur le front. Il n’était pas resté insensible au vaste mouvement patriotique de l’été 1914. Beaucoup d’intellectuels et d’artistes attendaient de la guerre une régénérescence morale et spirituelle opposée à l’Allemagne impériale, tenue pour autoritaire et matérialiste, et à la société marchande en général. L’héroïsme des chevaliers médiévaux (pour Maurras et Psichari) ou des soldats de l’An II et de l’Empire (pour Barrès et Péguy) renverserait la mollesse de la république bourgeoise prosaïque, matérialiste, positiviste. « Selon une vue toute intellectuelle qui ne s’encombrait ni de problème moral ni de considérations sociales, violence et destruction devaient être la source de renaissance créatrice propre à balayer les scléroses de l’avant-guerre et à en faire épanouir les promesses [4] ». Segalen fait plusieurs fois allusion au Tête d’Or de Claudel dans sa correspondance avant et pendant la guerre [5]. Tête d’Or explore le monde « avec le feu et l’épée » :
Si vous songez que vous êtes des hommes et que
Vous vous voyez empêtrés de ces vêtements d’esclaves, oh criez
De rage et ne le supportez pas plus longtemps ! Venez ! Sortons !
Et je marcherai devant vous, tenant l’épée à mon poing, et déjà il y a du sang sur la lame [6].
Dans un texte préparatoire à la deuxième version de cette pièce, Claudel note : « j’ai voulu montrer le triomphe de la volonté individuelle, sauvage, furieuse, enivrée du désir surhumain, de la toute-puissance [7]. » La guerre semblait située du côté de l’énergie vitale comme dans Salammbô, que Flaubert opposait à la morosité du « monde moderne » de Madame Bovary — Salammbô que Gauguin et Segalen ont médité quand ils cherchaient des « vrais sauvages » jusqu’aux Marquises. Mais Segalen est d’abord attaché à la réalisation de son œuvre qui exige la liberté de l’artiste entravé par la réalité de la guerre.
Si ses lettres témoignent de son désir de participer au « grand effort national » conformément au patriotisme en cours, il exprime aussi son amertume : l’esprit, « occupé » par l’angoisse de la guerre, il ne s’appartient plus entièrement, il a perdu une partie de sa liberté créatrice. Son service l’astreint à des horaires et des contacts qui l’éloignent de ce qui importe vraiment pour lui : « sa vie intérieure », ses lectures, son travail d’écrivain, les échanges avec ses amis : « Quand serons-nous libres et nous ? » (à Lartigue 6/11/1915, 542). Il exprime sa déception de ne pas être envoyé dans les Dardanelles : « J’ai vu en effet partir d’ici deux de mes plus inodorants confrères, embarqués sur des transports de troupes. Je suis encore cinquième sur une liste de départ à raison d’à peine une désignation par mois. » (16/4/1915, 579) Il souffre d’être enregistré dans une bureaucratie militaire étouffante : « je ne suis plus à la source, mais immatriculé » écrit-il à Lartigue (6/3/1915, 560) et à Louise de Heredia : « Mon Amie, y a-t-il une Croix-Rouge spécialiste des soins à donner aux plaies blanches d’un désir guerrier insatisfait ? » (20/3/1915, 562) De fait l’urgence était de prendre en charge les blessés ; selon le site officiel du Service de Santé des Armées, « l’inadaptation des services de santé aux conditions de la Grande Guerre est totale et le désastre sanitaire des premiers mois oblige le service de santé à procéder à une vaste réorganisation dès septembre 1914 [8]. »
Quand on rêve de Tête d’Or, il est difficile d’accepter de se trouver enfermé dans une salle d’opération ou dans des chambrées d’hôpital, occupé à « recoudre les dégâts » de la guerre (à M. de Lesquen 15/1/1915, 555) : « moi, la chirurgie me condamne au lit… du malade, et ne me laisse que les restes à réparer » (à Monfreid, 26/11/1914, 532). Son service à l’hôpital renforce le rejet de la pratique médicale qu’il a souvent exprimé, ainsi quand il évoque « la besogne ignoble et sanglante » qu’il lui fallait accomplir à l’Imperial Medical College de Tientsin (à Yvonne, 4/7/1917, 925). De plus, il ressent comme humiliant son « embaumement [9] » dans cet hôpital et cette ville qu’il cherche à quitter depuis l’adolescence.
Cette déception se manifeste par un épisode dépressif, un « à-plat physique » à l’origine « pityriasis versicolore » qui couvre le corps de « plaques rouges — et les idées d’un voile de gris », écrit-il à Lartigue (9/12/1914, 534) — l’heureux bénéficiaire d’une plaie au bras soignée par un « séton ». Segalen réagit cependant contre le « voile gris » : d’abord il décide « d’ignorer la guerre » puisqu’il n’y participe pas (à Lartigue 6/1/1915, 541), ensuite il a quelques satisfactions à être utile :
De 8 à 11 h, je panse et opère. Le Ceylan et le Duguay-Trouin ont rempli jusqu’aux recoins de mes salles, et j’ai 122 blessés qu’il importe de ne pas délabrer davantage. La rancœur diminue devant un certain succès technique, et j’accepte enfin l’inévitable. Parfois au prix d’une fatigue physique lourde au regard de celle des soirées de grande étape, et des visions anatomiques me poursuivant dans les moments de créâtions (sic). » (à Lartigue, 6/1/1915, 540)
Le Ceylan et le Duguay-Trouin transportaient les fusiliers-marins blessés dans les combats de Nieuport (où se trouvait Lartigue). Il tente de s’évader en rêvant de voyage : il prend des contacts à Papeete pour louer une goélette après la guerre (à M. Lemasson, 1/3/15, p. 555). Il voudrait surtout recréer l’intimité avec son ami Jean, mais il a conscience qu’il est inutile de chercher à « étirer à l’avenir la trame soyeuse mais arrêtée de [leur] passé chinois » (à Lartigue 4/2/1915, 552). Dès janvier 1915 en effet, Segalen a constaté une différence avec Lartigue dans le rapport à la guerre : « depuis le 11 août, aux antipodes d’ici, tu désirais tout ce qui s’est passé depuis ». Segalen admire son ami resté fidèle à la grande aventure virile et chevaleresque qu’il avait souhaitée, malgré la « grossièreté » de la guerre que Segalen, lui, doit affronter chaque jour sur le corps des blessés :
Tu n’as jamais varié ton vouloir, et, par un miracle dont j’admets en ta faveur la surhumanité, tu as imposé aux choses grossières cela exactement qui te plaisait. Je te déclare heureux à l’extrême, mais d’un bonheur qui pour la première fois, nous sépare plus qu’il nous réunit : les risques n’ont pas été communs. Tu as les deux bras traversés et les miens intacts. Tu sentiras comme moi le discord, le premier, que toute autre confidence ou sophisme ne parviendrait à rabrouer (6/1/1915, 541).
Médecin sur le front, Segalen précisera sa position dans une lettre à Jules de Gaultier. À l’hôpital, il avait la sensation d’étouffer, « une limite à l’ample respiration. Non pas, écrit-il, que j’aie jamais désiré la guerre ; mais la chose étant, je ne pouvais admettre de m’en voir ainsi exclu. » (17/5/1915, 596). En août 1914, Lartigue et Segalen n’avaient pas le même imaginaire de la guerre : tandis que le premier y voyait une occasion de se dépasser, de grandir dans l’épreuve, le second n’associait pas l’imaginaire de la puissance et de l’énergie à la réalité de la guerre. Il mettait au-dessus de tout la réalisation d’une œuvre consacrée à la beauté, la guerre n’entrait pas dans son champ visuel…
Elle y entre, et avec quelle force ! quand il arrive à Nieuport.
2. Sur le front à Nieuport, 10 mai – 5 juillet 1915 (p. 585-694)
Attaché au 2e bataillon du 1er Régiment de fusiliers-marins, Segalen écrit presque chaque jour à Yvonne de longues lettres (quarante-huit) souvent rédigées sur plusieurs jours en fonction des possibilités d’envoi. Elles constituent un journal adressé à l’épouse, qu’il convient de rassurer, en même temps qu’elles dressent un tableau de la vie au front. Segalen décrit les paysages : « de longues ondulations blanc de sable et herbes vertes. […] C’est bien la Belgique imaginée dans sa douceur provinciale. Il n’y manque que des habitants et aussi des murs et des toits aux maisons » (11/4/1915, 587). Il donne des détails sur son installation en insistant sur la solidité de son abri, « dans la cave puissamment voûtée, somptueuse, garnie, meublée, qui, depuis quatre ou cinq mois, abrite l’ambulance du bataillon » (11/4/1915, 587). Il habite cette cave dans les ruines de Nieuport quand son bataillon est en première ligne pendant deux jours, puis il va trois jours en réserve aux fermes de Groote-Laber, suivis de trois jours de repos au « camp Gallimard » près de Coxyde, où il retrouve ses amis, Lorin [10], Lartigue et Quinton, commandant d’artillerie [11]. Il a la joie d’échanger souvent avec Lartigue aussi ne lui écrit-il pas ; ce vide dans la correspondance permet de mesurer la profondeur des analyses qui lui étaient adressées auparavant.
Après la bataille autour de la ferme de l’Union, Segalen fait le bilan des officiers tués et blessés (à Yvonne 14/5/1915, 591). Il précise à une amie : « coût 400 hommes » (à Gabrielle de Fourcault 15/5/15, 593). L’attaque allemande, repoussée avec ces pertes importantes, a eu lieu dès l’arrivée de Segalen. Il voulait voir la guerre, elle est là : « Mes deux premières nuits au poste de secours ont été blanches et rouges, tragiques et belles. Une splendide tenue de tous » écrit-il à Jean Fernet [12] (19/5/1915, 599). Il donne dans plusieurs lettres (à Yvonne, à Gabrielle de Fourcault, à Fernet) les noms des jeunes enseignes de la marine (lieutenants) tués ou gravement blessés. Il insiste sur les spécificités de la guerre dans les polders : les Belges ont rompu les digues pour arrêter l’invasion allemande ; les soldats se battent dans des marécages, les chaussées et les ponts sont constamment bombardés.
Pendant cette première période, il exprime sa satisfaction d’être engagé dans l’action : « Pour la première fois sans doute mon métier m’agréera sans dégoût : la Maideucine (sic) est réduite à sa plus simple expression : l’organisation, la décision, l’action y ont enfin quelque importance » (à Yvonne, 14/5/1915, 592). À la différence de la routine de l’hôpital, il doit faire face ici à des situations d’urgence, son rôle essentiel consiste à trier les blessés et à ordonner les premiers secours les plus appropriés. Il éprouve une certaine fierté à participer à « la Grande Chose », d’autant plus qu’il estime la victoire proche : « je ne veux pas trop m’attacher à cette cave pour n’avoir pas de mélancolie à la quitter bientôt en marche vers le nord » (à Yvonne, 11/5/1915) ; il imagine qu’il suivra son régiment repoussant les Allemands le long de la côte belge, Yvonne pourrait alors le retrouver dans l’armée d’occupation à Ostende ou à Anvers (à Yvonne, 23/6/1915, 661).
Y croit-il ? Le 23 juin, ce n’est pas sûr. Le 15 juin, il avançait une condition « si la percée d’Arras réussit… » Le 17 juin, il espérait que la percée réussirait : « Il est vraisemblable que l’automne verra notre libération » (à Yvonne, 17/6/1915, 651). Fin juin, l’échec est évident en dépit des communiqués victorieux : certes les villages de Carency et d’Ablain-Saint-Nazaire ont été pris, mais les Allemands ont gardé la crête de Vimy, donc le contrôle sur la plaine minière. Le coût humain de cette grande offensive, sans résultat stratégique majeur, fut tragique pour l’armée française : 102 000 pertes. Sans doute Segalen n’avait-il pas une vision aussi claire du désastre car le nombre des tués était minimisé et la surface des territoires « libérés » mise en valeur, mais il a compris la spécificité de cette guerre : l’échec des offensives successives qui ne tiennent pas compte des armes de plus en plus puissantes de la guerre industrielle. Sur le plan personnel, il en tire quelques conclusions : d’abord l’expérience de la guerre lui donne le droit de « poser sa pensée » sur la guerre dans le contexte intellectuel (à Jean Fernet 19/5/1915, 600). Il peut légitimement prendre position sur la propagande patriotique par exemple. Le 27 mai, il écrit à Jules de Gaultier qu’il « poursuit la tâche illusoire et énorme d’une “Introduction au Sottisier de la Guerre” » (27/5/15 615). Il s’intéresse à un poème de Benjamin de Cassères traduit par Remy de Gourmont dans le Mercure de France ; ce poète américain « s’est fait le juge de Dieu et lui reproche violemment les crimes sur lesquels s’achève l’année 1914 [13]. » Segalen l’apprécie: « Oui, j’ai lu, vraiment lu et jusqu’au fond les Directives de Benjamin de Cassères. Elles sonnent avec un si beau métal dans les plâtras, les stucs et les cartons — pâtriotiques (sic) à un sou. » (à Jules de Gaultier, Nieuport, cave, 27/5/1915, 616).
Par conséquent, il se met en retrait, à distance de l’excitation générale de ses compagnons, suspendus aux communiqués, à l’attente de la « percée » :
Je ne prophétise rien du tout ; mais devant les deux coups de bélier jusqu’alors infructueux devant Arras, je décide de ne m’occuper que des jours qui se suivent sans tabler sur un lendemain sur lequel je n’ai point de prise. Je ne prépare ni la campagne d’hiver, ni la grande issue soudaine ; mais je reporte mon attention sur ce qui ne relève que de moi. Et d’abord sur une forte vie intérieure (à Yvonne 25/6/15, 664-665).
La guerre n’est qu’un « phénomène » humain trop humain, loin d’exalter les énergies les plus nobles, elle n’est que « tonitruante grossièreté » : « La guerre n’est rien de plus qu’un autre phénomène, et beaucoup moins que certains phénomènes que nous plaçons très haut » écrit-il à Jules de Gaultier (27/5/1915, 615).
Aussi souhaite-t-il finalement quitter le front, et puisqu’on ne peut faire aucune « prévision générale », il en fait de personnelles : « c’est que le Petit Dieu noir de cristal fumé, qui m’a fait partir un beau jour, juste à point, me ramènera de même, un autre beau jour, à point encore ; je suis décidé à lui obéir à nouveau, en sens inverse, dès qu’il me fera signe » (à Yvonne, 1/7/1915, 671). Le 3 juillet, ce n’est plus la marche vers le nord qu’il envisage, mais le « repos complet des marins envoyés à l’intérieur » (à Yvonne 3/7/1915 675). Il ne retrouvera pas Yvonne à Ostende, mais n’importe quelle garnison française sera bienvenue car il se lasse de « la guerre usinière », selon l’expression de Cendrars…
Le 11 juin, il écrivait au sinologue Édouard Chavannes :
C’est tantôt le « coup de feu » ininterrompu nuit et jour, et le défilé de brancards, et le bruit — tantôt le plus grand calme, le bord de mer, le silence. Le silence me ramène en Chine, au désir de reprendre vite ce que nous commençons à peine : — enfin à une œuvre qui ne soit pas de destruction (11/6/1915, 642).
La réalité de la guerre lui apparaît dans toute son horreur, comme une entreprise de destruction de corps fragiles et d’œuvres humaines. 1915 a été l’année la plus meurtrière : 333 700 morts et 1 600 000 blessés. Segalen en a évacué quelques centaines.
Il est évacué lui-même le 5 juillet pour une « gastrite aiguë » — un ulcère à l’estomac.
3. À Brest « si loin de tout », mi-août 1915 – mi-janvier 1917 (p. 695-769)
Après un séjour d’un mois (du 5 juillet au 3 août) à l’hôpital de Zuydcoote, il attend avec impatience sa convalescence d’une dizaine de jours à Rouen « la joie enfin de regarder sans voir seulement des trous, des décombres, toute la ferraille guerrière » ; il pourra admirer « le tumulte flamboyant de la cathédrale » (à Claudel, 27/7/1915, 692). De retour à Brest, il est nommé sur un poste administratif, adjoint au Directeur gouverneur sanitaire des Hôpitaux et Formations médicales de l’Hôpital de Brest. Si cette fonction le dispense du contact avec les hommes souffrants et avec leurs terribles blessures (au moins, « les papiers sont propres », à Lartigue 13/9/1915, 709), il supporte mal une situation d’Assis, pénible à l’admirateur de Rimbaud.
Yvonne est à ses côtés. Lartigue devient à nouveau le destinataire principal, lui qui est toujours au combat à Nieuport :
Mon vieux Jean, tant d’efforts, trente-sept ans d’héroïsme, deux grands Voyages et la Prédication du Divers, vingt blessures… pour arriver à m’asseoir sur le cuir élimé du Siège quasi directorial de la Santé… (à Lartigue, 13/10/15, 709).
La déception, une certaine amertume même, sont sensibles. Après la dissolution de la brigade des fusiliers-marins, le 9 décembre 1915, Lartigue est nommé commandant d’un navire qui fait la chasse aux sous-marins allemands. Il est en pleine action, tandis que Segalen attend sur son siège une affectation anywhere out of Brest, mais « rien ne bouge de la liste où je suis, et mon cuir continue à tourner, comme les choses, en rond » (à Louise Gilbert de Voisins, 30/5/1916, 746). Ses positions à l’égard de la guerre sont complexes : s’il est vexé d’être tenu à l’écart des combats, l’artiste en lui méprise la bassesse de la guerre elle-même : « Je ne me plains pas amèrement du temps dont j’aurais mauvais gré à découvrir la tonitruante grossièreté, et je porte tous mes efforts sur les seuls points où je puisse intervenir activement, — mon œuvre littéraire » (à Manceron, 5/4/1916, 739).
Ce qu’il fait pendant l’été 1916 : il est requis par son service à l’hôpital dans la journée, mais habite avec Yvonne, leurs enfants, et ses amis Augusto et Louise Gilbert de Voisins dans une belle villa qu’ils ont louée au bout de la ligne de tramway. « Ce temps de douceur et d’amitié, malgré la Grande Chose » (à Louise Gilbert de Voisins, 21/6/1916), est favorable à la création ; il s’occupe de Peintures qui vient de paraître, travaille à René Leys, entreprend L’Hommage à Gauguin dont il rêvait depuis trois ans. La correspondance ne comprend aucune lettre entre la mi-juillet et le 4 octobre, date à laquelle il adresse à Édouard Chavannes les tirés à part de deux articles sur la statuaire chinoise publiés dans le Journal asiatique [14].
À l’automne, revient la routine oppressante, « une année d’Assis par ce temps est collante à la peau » (à Saint-Pol-Roux, 17/11/1916, 155). Il cherche à embarquer « sur un Hôpital-bateau, qui lui du moins, [le] met officiellement à pied d’œuvre » écrit-il à Lartigue le 28 novembre 1916 (758). Il lance un peu partout des « télégrammes de permutation » — en vain. La délivrance arrive par la voie de la sinologie : sur les conseils de Paul Chavannes, Segalen est désigné comme médecin pour une « mission militaire en Chine où l’on recrute des travailleurs pour les usines » (à J. de Gaultier, 11/12/1916, 764). Il espère poursuivre jusqu’au Yunnan ses recherches archéologiques, prépare son matériel. Il part « plein d’ardeur et de joie » (à Lartigue, 7/12/1916, 762).
4. « Tourisme de guerre », 23 janvier 1917 – 6 mars 1918 (p. 770-1067)
Ainsi débute ce qu’il appelle le « tourisme de guerre » dans sa première lettre à Yvonne, envoyée de Londres le 25 janvier 1917. Yvonne est la principale destinataire pendant cette mission, prolongée bien au-delà des six mois initialement prévus à cause de divers imbroglios administratifs et d’une collusion entre navires pendant le voyage de retour, si bien que Segalen n’arrivera en France qu’en mars 1918. À la différence de l’expérience du front, il s’agit d’un voyage solitaire, parfois avec Paul Vitry, conservateur au Louvre, mais le plus souvent seul. Il fait allusion à sa situation avec une certaine distance : « L’absence complète de nouvelles et d’autre part cette vie de travail et de lectures intenses me donnent des jours où le vide et le plein se confondent sans savoir le goût du résultat » (à Yvonne, 6/5/17, 862)
En effet, le destinataire reste des semaines sans nouvelles et l’expéditeur doit attendre l’opportunité d’un courrier pour envoyer ses lettres, si bien que certaines d’entre elles, écrites sur plusieurs jours, prennent la forme d’un journal de plus de dix pages. De plus, les aléas de la mission entraînent de nombreux retards dus à l’incertitude des adresses auxquelles Yvonne doit adresser ses lettres. Une nouvelle difficulté apparaît après la Révolution d’Octobre : la voie la plus rapide, le transsibérien, est coupée, les lettres doivent transiter par l’Indonésie ou par l’Amérique : « La Poste Anglaise prévient ici que les courriers ne passent plus par la Sibérie mais par le Canada » (à Yvonne, 6/5/17, 860). Le 14 Janvier 1918, Segalen écrit de Singapour à Yvonne : « J’ai là un précieux paquet : tes lettres enfin, Mavone aimée, que l’Atlantique m’apporte de Colombo. Il a fallu, pour que je les obtienne ici, deux télégrammes et un abordage. Mais je les ai. D’anciennes, du 11 Juin, adressées à Tientsin! La dernière, de Tercis, 11 Octobre » (1053). Six mois, c’est long pour acheminer une lettre !
Ce voyage de plus d’un an, partie la plus importante de la correspondance de guerre, occupe près de trois cents pages sur les sept cent cinquante de l’ensemble compris entre août 1914 et le 20 mai 1919, veille de la mort de Segalen (la correspondance de l’année 1916 atteint seulement quarante-six pages). Ce n’est pas une « équipée » car les multiples trajets en train ou en bateau entrecoupés de longues attentes obéissent à des « feuilles de route » au sens propre, c’est-à-dire les indications des étapes d’une troupe selon des ordres militaires.
Partir loin de l’hôpital et de la guerre se présente d’abord comme une agréable diversion touristique et culturelle : à Londres, Segalen rencontre le grand sinologue Laurence Binyon ; il traverse la Norvège, la Suède, arrive en Russie, reste une dizaine de jours à Petrograd où il visite, émerveillé, L’Ermitage, assiste, heureux, à une représentation de Boris Godounov de Moussorgski, s’entretient longuement de poésie chinoise avec Basile Alexeieff, sinologue « entièrement épris du WEN. Il en parle avec une flamme dans les yeux, et récite les vers comme la plus vieille bouche chinoise » (à Lartigue 10/2/1917 [15], 787). Le 14 février, il embarque sur le transsibérien, le 22 le voici « enfin en terre chinoise », le 23 à Harbin d’où il prend un train pour Pékin. Harbin, en russe Kharbine, la « dernière station » du transsibérien imaginé de Cendrars — et c’était déjà la guerre, celle de 1904-1905 entre la Russie et le Japon [16] !
Je ne chercherai pas à retracer l’itinéraire erratique de Segalen entre Pékin, Tientsin, Nankin, Shanghai, Haiphong, Saigon ; loin de la belle diagonale de la Grande Traversée (février-août 1914), les feuilles de route successives de Segalen lui ont fait accomplir tellement d’allers et retours que son périple en zigzag aurait découragé les mauvais esprits chinois (qui ne se déplacent qu’en ligne droite). Ainsi on le trouve à Pékin le 1er mars, il évoque pour Yvonne les lieux qu’ils aimaient, parcourt les antiquaires, achète une petite boîte ronde de l’époque Kangxi (fin du xviie siècle) : « Elle est sur ma table et tient cette présence étrange d’être inhumaine, qui, lorsque les êtres humains que j’aime sont absents, me satisfait, m’environne, me calme » (à Yvonne, 4/3/1917, 804). À Tientsin, il s’occupe d’emballer leur mobilier, leurs collections, leurs livres et leurs vêtements, quelques manuscrits. À Nankin, il examine des travailleurs chinois, « en somme, j’accomplis un travail réglementaire, et ma conscience médico-militaire est, pour longtemps, à l’abri de tous scrupules » (à Yvonne 20/4/1917 820). Aussi peut-il consacrer ses larges loisirs à la statuaire. Le 13 mars, il écrit à Jules de Gaultier qu’il découvre « de grandes et sauvages statues funéraires des 5e et 6e siècles de l’ère chrétienne » et qu’il commence un nouveau manuscrit intitulé Sites (816). Il reprend son combat à lui avec une énergie renouvelée en contemplant les « statues les plus belles qu’[il] connaît sur le territoire chinois » (à Chavannes, 6/4/1917, 829). Il éprouve la satisfaction de « sauver » des « gestes antiques » par ses descriptions et ses photographies. Il ajoute à la fin de quelques lettres un sceau qu’il a réalisé :
Doc. 1 ‒ « Ce qui veut dire : Aimer le Passé est chemin de joie » (à Lartigue, 4/3/1917, 808 ; à Fernet, 10/3/1917, 814).
« Arriverai-je à retrouver une trace de ce passé si loin, si mystérieux ? Et le présent ne me disait rien qui vaille. Retrouver l’ancien foyer, raviver le feu sous toutes ces cendres [17] », écrivait Gauguin à Tahiti. Segalen poursuit la voie qu’il avait commencé à emprunter en Polynésie, sur les pas de Gauguin. Son projet était alors d’« exalter le prodigieux profond passé inconnu [18] » des Maoris contre le monde moderne. Il résume sa démarche dans son Essai sur l’Exotisme : « Fuite du présent misérable et mesquin. Les ailleurs et les autrefois [19]. » Les belles statues du « Passé » l’émeuvent, le ramènent à ses propres forces créatrices ; sans doute serait-il plus exact de dire « aimer les œuvres d’art du passé est chemin de joie… » en contraste avec les horreurs de la guerre industrielle :
Et j’enrage de voir passer le temps et que des choses croulent et que d’autres qui devraient être dites sont tues.
Et j’attends avec ferveur la reprise du temps libre, de libre pensée retrouvée… car la grandeur de quelques moments de guerre n’en a pu me faire accepter la « servitude [20] ». Les hommes oublieraient-ils que la Connaissance est un autre combat, et de tous les instants, contre les puissances aveugles et taciturnes (à Jules de Gaultier, 13/3/1917, 815).
Le terme « Connaissance » rappelle Connaissance de l’Est (1900) de Claudel et son Traité de la Co-naissance au monde et de soi-même (1907), où il s’agit de déchiffrer le « tableau » de l’univers pour y intégrer la vie et la conscience [21]. Ce combat recourt aux facultés intellectuelles, à l’imagination apte à découvrir les rapports entre les choses elles-mêmes, entre elles et nous, et à « l’énergie spirituelle » tendue vers « le mystérieux ». Ce combat est mené contre la « grossièreté » en cours, contre « ces puissances aveugles et taciturnes » qui étouffent, à la fois la clarté de la raison, la « libre pensée » et la voix qui travaille à exprimer « ce qui n’a pas été dit ». Les travaux archéologiques de Segalen participent du combat de la Connaissance. En mai, à Shanghai, ville coloniale qu’il n’aime pas, il se lie d’amitié avec le grand spécialiste du Tibet, Gustave-Charles Toussaint [22]. Il donne une conférence en anglais sur la grande Statuaire chinoise à la Royal Asiatic Society. Il lit beaucoup, trouve la Correspondance de Flaubert, « pleine de saveur » (à Yvonne, Shanghai, 27/4/1917, 856) ; Flaubert est « passionnant quand il se montre tout entier, divers, jouissant, souffrant… » (à Yvonne, 9/5/1917, 867) ; « Saint Flaubert devrait être le patron efficient de tous les écrivains » (à Yvonne 30/6/1917, 919). Il conseille à Yvonne et à Lartigue de lire cette correspondance qui a dû prendre un relief particulier pour lui quand seules les lettres le relient de temps à autre à ses proches.
Segalen s’occupe aussi d’enrôler des « spécialistes-mécaniciens » pour les usines françaises (à Yvonne 14/4/1917 835). Il espère pouvoir poursuivre sa mission de recrutement dans le Yunnan puis voyager en Annam. « Du Yunnan (dont les troubles sont purement politiques), j’espère remonter un peu vers Tali, ou donner une pointe vers le Kouei-tcheou. Je ne sais, et me réserve tout droit d’aventures. Mais l’espace est plus grand. Le Fong-chouei [fengshui] est celui des grands vents libres » (à Yvonne 24/5/1917, 887). Le Yunnan, quitté précipitamment en août 1914, continue de le hanter, mais plus sa mission se prolonge, plus l’Ouest chinois s’éloigne, devenant aussi inaccessible que le Royaume de la Reine de l’Ouest et les neiges du Tibet.
Le médecin de 1ère classe est agacé par l’indécision de ses « chefs » et par les lenteurs des bureaucraties françaises et chinoises en désaccord sur le contrat concernant les travailleurs chinois :
J’appartiens à une sorte de cirque ambulant – Mission de recrutement de main-d’œuvre chinoise – dont le premier travail dut être de concilier à Paris le Ministère du Travail et celui de la Guerre ; puis, en Chine, divers départements encore plus distants, divers, inexistants (à C. de Polignac, Pékin, 20/6/1917, 907).
Il est de plus en plus fatigué par les incertitudes sur sa mission. L’attente nuit à sa liberté d’esprit. S’il reprenait du service sur un navire de la Marine, ses chefs « disposant de [s]on corps et de [s]es gestes apparents », il reprendrait l’essentiel : « son indépendance de pensée » (à Yvonne, Tientsin, 9/6/1917, 900). Il écrit à Lartigue que son séjour en Chine est « abusif, illusoire et honteux » ; il a le sentiment d’y être « à l’abri » en « fils de famille payé de rançons louches » (à Lartigue, 10/6/1/1917, 903). Il souffre de passer pour « embusqué », il se sent éloigné de l’action collective, isolé aux antipodes. Comme il l’était à Brest en 1914 puis en 1916, il est dépité d’être tenu à l’écart de la « Grande Chose » :
Ces temps d’esclaves où l’on vit, où l’on piétine, où des gens mangent ici cependant que d’autres se battent, me pèsent. Tels les vieux numéros de Revues Littéraires, nés du temps « où il n’y avait pas la guerre », sonnent un autre son – tel je voudrais me replonger dans la guerre pour avoir le droit physique de l’oublier, de la négliger de nouveau ; – de revivre (à Yvonne, 22/6/1917, 910).
La guerre l’obsède, pèse sur son esprit plus qu’elle ne le ferait, croit-il, s’il l’affrontait dans le « Réel ». Mais, par un mouvement de balancier, il se libère de cette obsession, reprend sa liberté intérieure :
J’essaierai d’oublier la guerre, décidément illogique, imprécise, – plus que grossière : populaire. Je ne vois pas pourquoi, récusant le suicide, je suiciderai nationalement chacun de mes jours après l’autre. Il y a trois ans, presque, que j’attends d’impatience la liberté et l’ampleur. Elle ne vient pas, et l’on se doit de vivre. Je me déciderai à vivre jusqu’au bout… (à Yvonne 25/5/1917, 887)
« Vivre jusqu’au bout », c’est continuer son œuvre d’archéologue et de poète, c’est aussi préparer la vie « après la Grande Chose ». Il raconte à Yvonne comment il prépare l’embarquement de leur mobilier laissé à Tientsin en 1914 ; il fait mettre les livres en caisse zinguée, emballe les antiquités dans plusieurs boîtes. Les caisses seront expédiées dès qu’un bateau pourra les charger. Il espère alors que ces objets, qui sont pour lui des présences vivantes, habiteront avec Yvonne et lui à Paris. Les caisses arriveront à Brest en octobre 1918. Segalen vivant, leur contenu n’ira pas plus loin.
Sa situation en Chine lui devient insupportable. Il tente de soumettre sa démission de la mission, d’abord en juillet 1917 puis en septembre, afin d’être réintégré dans la marine, mais ses démarches se perdent dans les bureaux. Finalement la mission est compromise parce que Paris refuse la clause des retours des ouvriers chinois (945) Il doit attendre des « ordres » à Hanoi, puis à Saigon jusqu’à ce qu’enfin il reçoive celui d’accompagner en France un convoi de travailleurs chinois que son navire embarquera à Nankin. Mais ce navire a proprement « expédié par le fond le paquebot anglais Laertes » le 14 décembre 1917 (1031). En attendant l’envoi d’un autre bateau, il doit supporter jusqu’au 28 janvier une longue attente à Singapour, pendant laquelle il écrit beaucoup de lettres, à Yvonne surtout, à Yvon, à Manceron, à Lartigue. Il travaille chaque jour à son poème Thibet. Au crépuscule, il « emmène Baudelaire par les routes rouges » (à Yvonne 2/1/1918, 1047).
Il débarque enfin à Marseille le 6 mars 1918.
5. Le dernier retour à Brest, mars 1918-mai 1919 (p. 1096-1261)
Il revient donc à Brest ; ces treize mois de voyage solitaire l’ont éprouvé physiquement, il a souffert d’une entérite, fumé pour soulager la douleur et l’angoisse. Il est las de la guerre, de l’hôpital, de Brest et peut-être de lui-même. À peine rentré, il combat une mauvaise grippe. Mais il profite de « la tiédeur du chez-soi » pour s’atteler à la rédaction de sa Grande statuaire (1078). Il poursuit le matin l’écriture de Thibet. Yvonne est près de lui ; Lartigue commande L’Espiègle, il chasse des sous-marins allemands. Il se montre distant envers Victor. Une nouvelle destinataire prend une place considérable, Hélène Hilpert, une amie d’enfance d’Yvonne dont le mari a « disparu » le 29 septembre 1915 pendant l’offensive de Champagne [23]. Segalen la voit rarement, il développe avec elle un espace imaginaire, l’emmène « dans les chemins féodaux du château de [s]on âme » (24/10/1918, 1156). Quand il est loin d’elle, au repos en Algérie, il évoque le « fantôme amical, [le] Double » de son Amie (25/3/1919, 1226). Chrétienne fervente, elle reçoit ses messages de plus en plus ardents et désespérés : « Donc j’ai tout ici de ce que l’humaine vie a l’usage de jouir. Et j’ai tant soif de ce qui n’est pas l’humaine vie… » (12/3/1919, 1221).
La fin de la guerre le hante. La mort d’Édouard Chavannes, son maître en sinologie, le 29 janvier 1918, et celle de Debussy, l’ami musicien très cher, le 25 mars 1918, l’affectent douloureusement. Même si Segalen avait renoncé à la perspective d’une collaboration, il était attaché à ce très grand musicien qui l’avait compris et apprécié en tant qu’artiste. Il espérait renouer avec ses projets artistiques pendant son séjour à Paris, du 17 mai au 30 juin 1918, obtenu grâce à un stage de spécialisation à l’hôpital Saint-Louis. Mais la violence de l’offensive allemande terriblement meurtrière et la mort de son beau-frère Georges Hébert devant Reims le 3 juin l’atteignent profondément. Ces terribles nouvelles et l’angoisse de savoir Paris menacé à nouveau brisent l’espoir de renouer avec ses projets. « Las et meurtri », il renonce à prononcer sa communication. Il écrit à Hélène Hilpert :
Notre séjour à Paris qui aurait dû se développer abondant et opérant se restreint à l’exercice du « devoir » social. J’ai reculé ma communication trop personnelle à l’Académie, n’étant point d’humeur à dire « je » quand « ils » se battent si près de nous, et pour nous. Je ne puis rien écrire et ne veux rien lire. Je ne veux rien faire pénétrer qui ouvre les portes et retentisse… (8/6/1918, 1089)
Il écrit à Lartigue qu’il remet aussi à plus tard la parution son « Hommage à Gauguin », longue préface aux Lettres de Gauguin à Monfreid [24] : « je renonce moi-même à paraître en Gauguin avant l’automne, peut-être plus accalmisé que l’été plein de menaces » (9/6/18, 1089). Il précise qu’il « ne peut se résoudre à dire “je” dans les moments où l’impersonnel et le hagard se disputent l’espace » (9/6/18, 1090). Il parvient cependant à présenter le compte rendu de l’avancée de ses découvertes sur la statuaire chinoise « devant le cénacle octogénaire des Vieux de la Montagne Académique » (24/6/1918 1094). Malgré cela, il revient à Brest déçu de son séjour, « angoissé par le tumulte de la Marne, hanté du viol de Paris » écrit-il à Jules de Gaultier (16/6/1918, 1093). Le 10 juillet, il écrit au même destinataire : « J’entame aussitôt les dix publications qui attendent, les vingt projets qui se bousculent » (1099).
Il est nommé chef de service de dermatologie et de vénérologie à l’hôpital maritime de Brest et il consacre les loisirs de ce qui sera son dernier été à de nombreux projets : Chine la grande Statuaire, sa pièce Combat pour le sol, en réponse au Repos du Septième Jour de Claudel et, pour se « venger de [s]a chair moins robuste », Thibet, son « poème lyrique d’escalade et d’effort » (à J. de Gaultier 29/4/1918, 1080). Il veut en faire un « chef d’œuvre », conscient que Thibet « marque un pic dans [s]a vie » (à Hélène, 9/9/1918, 1127). Pendant ce temps, il continue à tenter de réparer les corps des innombrables victimes de l’offensive allemande de l’été 1918.
Nietzschéen impénitent, il dit à Hélène son aversion envers les malades au nom de l’énergie vitale : « J’ai plus de pitié de ceux qui sont morts en désirant toujours que de ceux qui souffrent sans désirs. Voilà pourquoi j’entends peu et n’aime point le malade ; il vit ; j’ai grand’ pitié des vampires errants » (12/8/1918, 1111). Dès la fin du mois d’août, les malades de la « grippe infectieuse[25] » affluent par centaines. En dépit de ces propos (qui s’adressent peut-être à lui-même ?), le médecin se donne alors entièrement à sa tâche, il s’occupe même des cuisines, fait ouvrir de nouvelles salles, se consacre aux malades : « cela fait six ou sept heures d’auscultation » par jour (à Hélène 3/9/1918, 1023). Il éprouve une certaine satisfaction à avoir agi : « j’ai tenté de faire ce qui se devait : même en médecine » (ibid.). Il exprime de la compassion envers les jeunes gens de l’École des Mousses :
Six de mes soixante petits bretons sont morts. Le septième m’a dit hier matin avec le pur accent touchant et navrant des gars de Lannilis « Je serai mort aussi donc, ce soir ! » Et il le fut. D’autres arrivent (à Hélène 5/9/1918, 1126).
Le médecin qui signe « les papiers de décès » est touché par cette nouvelle offensive de la Mort dans les casernes, les villes et les villages, les champs de bataille. Elle emporte le « petit Jacques Andlauer [26] » (à Hélène, 29/10/18), fils d’amis proches. Dans des conditions très difficiles, il tente de mener de front son service à l’hôpital, l’écriture de ses manuscrits et sa correspondance avec Hélène, au prix d’une fatigue intense qu’il combat parfois avec de l’alcool.
Quand « la bête monstrueuse » plie enfin (1141), l’avenir s’ouvre ; il écrit à Marie Manceron : « Dès que le projet sera décent à reprendre, je préparerai mon émigration sur Paris, pour aussi longtemps que le demanderont mes publications et bien d’autres désirs… celui de musique, entre autres ! » (4/11/1918, 1168). Le 11 novembre il envoie une longue lettre à Henri Cordier [27] : « L’armistice est signé aujourd’hui. Nous devenons libres » (11/11/1918, 1170). Après cette entrée en matière énergique, il sollicite un poste auprès de l’Institut ou du Ministère de l’Instruction publique, présente des plans de fouilles et il esquisse la fondation d’une « Action Sinologique Française permanent en Chine ». Il précise ses projets dans plusieurs lettres en novembre et décembre. Il s’occupe de préparer une édition américaine de Chine. La Grande Statuaire (1190). Il envoie un dossier détaillé à Philippe Berthelot [28] après leur entretien, il revient de Paris plein d’espoir : « le moment est propice aux renouveaux », écrit-il à Lartigue. La Fondation semble en bonne voie, mais le 10 janvier 1919 la réponse est dilatoire : « La Marine ne veut pas se séparer du Dr Segalen avant 7 ou 8 mois » (1203). Il reste trop de grands blessés, de gazés, de mutilés dans les hôpitaux…
Segalen souffre d’être amarré à l’hôpital de Brest, alors qu’il voudrait se consacrer à ses recherches, à son œuvre, à ses amis ; « dans le nouvel état des choses, la liberté retrouvée », il ne peut plus accepter « le harnais des jours et des lieues » (à Hélène 19/12/1918, 1204). Fin décembre, il tombe « gravement malade » — « une crise aiguë de neurasthénie avec des désespoirs atroces » écrit Yvonne le 31 décembre (1209). Il attribue cette crise au « surmenage » (1213). Il précise à Hélène : « une vie double, si ce n’est triple, menée pendant combien d’années, m’a conduit au point d’un repos total nécessaire » (à Hélène 10/1/1919, 1210). Les examens médicaux approfondis à l’hôpital de Brest et au Val-de-Grâce ne « révèlent aucune anomalie somatique » (1212). Il obtient un congé de deux mois, en passe un avec Yvonne un chez un ami en Algérie sans que ce séjour n’améliore son état. Dans la solitude de ce bordj, il écrit à Hélène : « Chose plus lourde que la guerre, cet après-guerre pour les nôtres et nous… » (22/2/1919, 1217). Après la tension extrême de l’action, après l’attente, l’angoisse et les deuils, les réserves d’énergie psychique cèdent — sans doute aussi, en ce qui le concerne, son « amitié » pour Hélène associée à une recherche spirituelle intense, le laisse de plus en plus insatisfait. Il lui écrit de très longues lettres sur plusieurs jours, comme un journal.
À Paris, en mars, il apprend que ses démarches n’ont pas abouti car « la marine, à court de personnel, refuse de [le] lâcher » (1228) : « Tout est remis en question… mes beaux projets d’automne à Paris où vous serez… TOUT. Demain, je vais voir si mes chefs feront quelque chose de moi […] Mon voyage, vous le savez presque seule au monde, Hélène, ma confidente, mon voyage n’est pas de ce monde » (25/3/1919, 1227). En avril, son congé est prolongé de « quarante-cinq mornes jours », il en vient à regretter l’hôpital. Avec Lartigue, il est direct : « Je suis lâchement trahi par mon corps », que trop d’efforts ont épuisé, « je constate simplement que la vie s’éloigne de moi », ajoute-t-il (21/4/1919, 1239). C’est la dernière lettre qu’il écrit à son ami le plus cher [29].
Le 26 avril, il part se reposer au Huelgoat où le froid, la pluie, le grésil et le vent l’empêchent de sortir. Il renonce à répondre à l’invitation de Claudel : s’il admire « la puissance mystique des mots » du grand poète, « ses Arguments demeurent vains » (à Hélène, 7/5/1919, 1249). Il relit « l’immense Hamlet si humain » (à Yvonne 12/5/1919, 1255). Il tente de rassurer Yvonne : « je continue ma végétation, du matin au soir, dans les arbres » (14/5/19, 1256). Yvonne est venue passer quelques jours avec lui. Il la raccompagne à Morlaix le 18 mai. Le 19, il lui écrit : « Tes deux séjours ici auront été les grands moments de lumière, maintenant si vive qu’elle déborde et noie les ombres… » (1259). Ses lettres à Hélène expriment davantage son angoisse : « C’est à cette heure où j’allais atteindre la Possession du moi lucide et aimant qu’il me faut constater les dérobées de cette Bête qui m’avait toujours bien mené, parfois emporté… » (20/5/1919, 1260). C’est sa dernière lettre. Le même jour, il s’efforce de redonner confiance à Yvonne : « Je respire avec prudence encore, mais pour calmer ma hâte, je me réfugie près de mon amante aimée, qui sait vivre si fortement, si courageusement pour nous deux… » (1261). Le 21 mai, il ne rentre pas de sa promenade. Le 23, Yvonne et Hélène le retrouvent mort dans la forêt, après qu’il a été blessé à la cheville. A-t-il trouvé sous les hêtres et les chênes du Huelgoat l’apaisement qui l’avait rendu si heureux dans les forêts du Yunnan ?
Place au poète :
Certes la mort est plaisante et noble et douce. La mort est fort habitable. J’habite dans la mort et m’y complais.
o
Cependant, laissez vivre, là, ce petit village paysan. Je veux humer la fumée qu’ils allument dans le soir.
Et j’écouterai des paroles [30].
Notes
[1] Victor Segalen, Correspondance II, 1913-1919, texte établi et annoté par Annie Joly-Segalen, Dominique Lelong et Philippe Postel, Paris, Fayard, 2004. (Date et numéro de page entre parenthèses). 1er août 1914 p. 509 au 20 mai 1919 p. 1261.
[2] Archives Jean Lartigue, Philippe Rodriguez, Jean Lartigue, Une vocation, la Marine. Une passion, la Chine. Une amitié, Victor Segalen, Les Indes Savantes, 2012, p.194.
[3] Pour la seule journée du 22 août 1914, on compte 25 000 morts et 50 000 blessés.
[4] Christophe Prochasson, Au nom de la Patrie : Les Intellectuels et la Première Guerre mondiale : 1910-1919 (avec Anne Rasmussen), La Découverte, « L’Aventure intellectuelle de la France au XXe siècle », 1996, p. 123.
[5] Le 18 juin, il écrit à Yvonne qu’il « compare mot à mot les deux versions de Tête d’Or et qu’il a « acquis sur le front le droit de préférer Tête d’Or à L’hymne au Saint-Sacrement » (18/6/15 656)
[6] Paul Claudel, Tête d’Or [1889 et 1894, L’Arbre, Mercure de France 1901, p. 145 (volume appartenant à Segalen).
[7] Paul Claudel, Théâtre, I, la Pléiade, Paris, Gallimard [1948], 1985, p. 1248.
[8] Service de santé des armées, « Trois cents d’histoire », en ligne : https://www.defense.gouv.fr/sante/le-ssa/trois-cents-ans-d-histoire/trois-cents-ans-d-histoire.
[9] « C’est mon embaumement actuel qui peut avoir pour toi la valeur d’un exotisme » (à Lartigue 13/3/1915, 563).
[10] Marie-Alphonse Lorin était capitaine adjudant-major (c’est-à-dire adjoint du commandant) du 1er Régiment de la Brigade. Il admirait l’œuvre de Segalen.
[11] René Quinton, biologiste, a mis au point le fameux « plasma de Quinton » à base d’eau de mer qui eut un succès considérable en Europe à l’époque. Segalen rêvait de le commercialiser en Chine…
[12] Jean Fernet, officier de marine proche de l’Action française, ami de Lartigue et de Gilbert de Voisins, ami aussi de Martin du Gard, il sera vice-amiral en 1940 puis conseiller du maréchal Pétain.
[13] Remy de Gourmont, « Épilogue », Mercure de France, 1er mai 1915, p. 93.
[14] Premier exposé des résultats archéologiques obtenus dans la Chine Occidentale par la Mission Gilbert de Voisins, Jean Lartigue et Victor Segalen (1914), Journal Asiatique, mai-juin 1915.
[15] « Petrograd – 10 février 13 » (sic) corrigé par les éditeurs en 1917 ! (p. 787) Est-ce un retour tant désiré au temps d’avant la « Grande chose » ?
[16] « Je débarquai à Kharbine comme on venait de mettre le feu aux bureaux de la Croix-Rouge » Blaise Cendrars, Prose du transsibérien et de la petite Jehanne de France [1913], Claude Leroy éd., TADA, Denoël, 2001, p. 32.
[17] Paul Gauguin, Noa Noa, Jean Loize éd. Paris, Balland 1966, p. 37.
[18] Victor Segalen, Essai sur l’exotisme, Œuvres complètes I, H. Bouillier éd., Paris, Robert Laffont, 1995, p. 776.
[19] Victor Segalen, ibid., p. 753
[20] Alfred de Vigny, Servitude et grandeur militaire [1835], Folio classique, 1992.
[21] Paul Claudel, Art poétique, Œuvres poétiques t. 1, J. Petit éd., la Pléiade, Gallimard, 1957, p. 154.
[22] Gustave-Charles Toussaint (1869-1938), magistrat colonial, est chargé en 1917 à Shanghai d’une mission judiciaire pour le compte du Ministère des Affaires étrangères. Il a rapporté du Tibet en 1911 le manuscrit du Dict de Padma qu’il a traduit. Il en a lu des extraits à Segalen et, quelques années plus tard, à Alexis Léger en poste à Pékin. Ce texte a eu une influence sur Thibet de Segalen et sur Anabase de Saint-John Perse. Voir la lettre à Yvonne, p. 919.
[23] Maurice Hilpert, né en 1878, caporal au 402e Régiment d’Infanterie, « disparu au combat » le 29 septembre 1915 à Sainte-Marie-à-Py (Marne). Jugement rendu le 9 septembre 1920.
[24] Lettres de Gauguin à Monfreid, Paris, Crès, 1919 (sur la couverture), 1918 (sur le copyright).
[25] Il s’agit de la « grippe espagnole », originaire de Chine (pour le « virus père ») et d’Amérique (pour sa mutation génétique). La pandémie a fait dans le monde entre 50 millions et 100 millions de morts, plusieurs centaines de milliers en France, essentiellement des jeunes adultes.
[26] Jacques Andlauer, né le 10 mai 1899, aspirant, Régiment d’Infanterie Coloniale du Maroc, mort à l’ambulance de Villers-Daucourt (Marne), le 22 octobre 1918.
[27] Henri Cordier, sinologue, était professeur à l’École spéciale de langues orientales, spécialiste de l’histoire de la Chine.
[28] Philippe Berthelot était alors Directeur-adjoint des affaires politiques au Ministère des Affaires étrangères.
[29] Le contre-amiral Jean Lartigue sera tué le 22 août 1940 par un bombardement allemand sur l’aéroport de Rochefort. Son fils François, Jean, Victor mourra le 8 novembre 1942 dans un sous-marin au large d’Oran.
[30] Victor Segalen, « Édit funéraire », Stèles, Œuvres Complètes, II, op. cit., p. 60.
Auteur
Colette Camelin, professeur émérite de littérature française du xxe siècle à l’université de Poitiers, a enseigné les humanités à Sciences Po Euroamerican College (Reims) de 2012 à 2017. Elle a publié notamment : Éclat des contraires, la poétique de Saint-John Perse (CNRS éditions, 1998) ; L’imagination créatrice de Saint-John Perse (Hermann, 2007) ; une édition critique des Premiers écrits sur l’art (Gauguin, Moreau, la sculpture) de Segalen (Champion, 2011). Elle a organisé, avec Marie-Paule Berranger, le colloque 1913 cent après : enchantements et désenchantements au CCI de Cerisy (Hermann, 2015). Elle est actuellement présidente de l’Association Victor Segalen.
Copyright
Tous droits réservés.