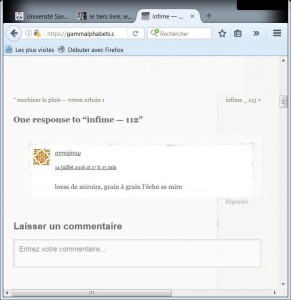Le flâneur, le collectionneur, le blogueur et l’art de la trouvaille
L’écriture littéraire du blog, en ses notes quotidiennes, micro-fictions ou poèmes, souvent suscités par des rencontres, et qui se donnent à lire à partir du plus récent, réinvente aujourd’hui une figure du flâneur (et, dans une moindre mesure, du collectionneur) et un art de la trouvaille dont les racines sont anciennes. Elle réactive une peinture de la vie moderne qui a conquis sa légitimité artistique au XIXe siècle, mais elle s’inscrit également dans une requalification des arts de faire et des pratiques quotidiennes dont Michel de Certeau a montré depuis les années 1970 l’importance dans la culture européenne, au côté de, et souvent en rivalité avec, les savoirs savants institutionnalisés depuis le XVIIe siècle. Nous voudrions ici analyser comment cette écriture du blog, en valorisant l’anodin, le fugace ou l’infime, approfondit un art de la déviance, politique, fictionnelle ou imaginaire, et réinterroge notre inscription dans un présent en devenir.
Literary writing on blogs in the form of daily notes, micro-fictions or poems, is often inspired by encounters, allowing the reinvention of the figure of the flâneur (and to a lesser extent, of the collector) and the ancient art of discovery. It revives the practice of the artistic depiction of modern life which gained legitimacy in the 19th century; but it may also be considered as one of the ‘arts of doing’ that Michel de Certeau regarded as so important in European culture. In the 1970s, Certeau showed how the ‘practice of everyday life’ was in competition with institutionalised scholarly knowledge from the 17th century onwards. Our aim here is to analyse how this blog writing, in placing value on the banal, allows us to question our own place in the ever-evolving present time.
Texte intégral
L’écriture littéraire du blog, en ses notes quotidiennes, micro-fictions ou poèmes, souvent suscités par des rencontres, et qui se donnent à lire à partir du plus récent, réinvente aujourd’hui une figure du flâneur (et, dans une moindre mesure, du collectionneur) et un art de la trouvaille dont les racines sont anciennes. Elle réactive une peinture de la vie moderne qui a conquis sa légitimité artistique au XIXe siècle, mais elle s’inscrit également dans une requalification des arts de faire et des pratiques quotidiennes dont Michel de Certeau a montré depuis les années 1970 l’importance dans la culture européenne, au côté de, et souvent en rivalité avec, les savoirs savants institutionnalisés depuis le XVIIe siècle. Nous voudrions ici analyser comment cette écriture du blog, en valorisant l’anodin, le fugace ou l’infime, approfondit un art de la déviance, politique, fictionnelle ou imaginaire, et réinterroge notre inscription dans un présent en devenir.
1. L’écrivain blogueur, peintre de la vie moderne
La présentation de la série « Balades photo » de Dominique Hasselmann par François Bon sur le site remue.net rappelle les grands modèles d’une écriture de la déambulation urbaine en dialogue avec l’image photographique :
Paris au gré de la flânerie, Paris des écrivains à portée d’œil, dans la magie baudelairienne des instants de la ville – entre instants d’épiphanie saisis sur le vif, et les livres et la littérature relus dans la rue, c’est sur remue.net manifester notre attachement à Nadja, au Paysan, à la grande tradition surréaliste d’entre la ville et les signes [1].
Ces chroniques urbaines intègrent d’ailleurs souvent une dimension réflexive, comme l’indique clairement la page « Flânerie interdite » de la série « La ville écrite » d’Arnaud Maïsetti, où tente de s’approfondir la relation avec les modèles invoqués, en même temps que le compagnonnage se tresse de renvois hypertextuels (ici soulignés) aux auteurs ou aux notions cités, qui essaie de conjurer l’angoisse d’un univers beaucoup plus contraint :
Baudelaire, Blanqui, Benjamin (Bataille, pour la destruction du but) (et Blanchot pour le désœuvrement) – dans nos errances, on voudrait rejoindre leurs ombres, on voudrait glisser la nôtre sous elles : et nos ombres sont errantes dans l’espace judiciarisé qu’est devenue la ville [2].
Quelques textes de la série de François Bon « Étrangetés concernant les villes » mettent particulièrement en abyme la figure du flâneur observateur, et questionnent la dimension problématique de la captation visuelle dans l’univers urbain. Dans « L’œil dans la ville », le flâneur (« moi, qui n’avait rien à faire ici et qui m’était arrêté une seconde photographier l’appareil ») tombe sur un œil autrement plus performant que le sien, un œil machine sur son trépied, qui capte, au-delà du visible, « notre réseau de relations, l’infini et grouillant nuage de notre totalité relationnelle », qui intègre et supplante la ville elle-même comme contexte de toutes les rencontres possibles. La série de photos qui accompagne ce texte progresse vers un gros plan de cet œil machine qui, occupant toute l’image, semble effectivement avoir englouti la ville et s’avancer avec voracité vers l’internaute [3].
Doc. 1 et 2 – « L’œil dans la ville », images en fin de texte (François Bon, Tiers Livre, série « Étrangeté concernant les villes », ici).
Dans la même série « Étrangetés concernant les villes », à la page « Branche 4 bis du tombeau de Joseph Beuys », composée d’une série de propositions cinématographiques (sous l’enseigne d’un miroir de surveillance, dont le passage de la souris provoque le grossissement), la Section 26 intitulée « développer l’inventaire des captations arbitraires » propose une réécriture de « l’homme des foules » de Poe puis Baudelaire, avec pour modèle non plus le peintre Constantin Guys, mais le cinéaste russe d’avant-garde Ziga Vertov :
images à hauteur de buste, et se déplacer soi dans une foule, devenir homme-caméra selon moyens mobiles d’aujourd’hui, transposer la suite des figures de Ziga Vertov dans une métropole contemporaine
passer aussi dans les tombes
explorer les lieux de travail
revenir à celui qui est dans son appartement et n’ose pas en sortir [4].
Ici s’articulent l’extérieur urbain dans la multiplicité de ses décors et l’intérieur-coquille du reclus, en une complémentarité qu’avait déjà décrite Walter Benjamin, quand les trouvailles chinées dehors se font ornementations d’un dedans à l’image de l’habitant [5].
Certains des textes de la série « Étrangetés concernant les villes », courts récits à tonalité fantastique [6], proches du poème en prose (qui peu à peu composent un Spleen des métropoles ?), n’oublient pas en effet de faire surgir les chambres, écrins des corps, en leurs métamorphoses contemporaines : cases superposées pour une humanité qui vit donc désormais en rampant [7] ; séries d’écrans qui matérialisent la chambre mentale, l’ancienne projection psychologique de l’individu sur son décor [8], en soutirant et affichant toutes ses données personnelles [9] ; série de chambres d’hôtels toutes semblables où l’identité du sujet ne peut plus s’affirmer que dans la scrutation de sa propre absence [10].
Les « instants d’épiphanie saisis sur le vif » peuvent donc susciter une dérive imaginaire où s’exprime l’angoisse inverse d’un vertige de la sériation, de la totalisation, qui piège le sujet singulier, entrave sa liberté et sa capacité à réagir. Ce sont les principes de ce surgissement fondateur, essentiel à la fertilité de la flânerie, et dont la perte est thématisée avec angoisse, que nous voudrions à présent analyser.
2. Un art du kairos
Il faut approfondir ce que la figure du flâneur et sa capacité de captation à l’aide des « moyens mobiles d’aujourd’hui » doit à une très ancienne intelligence tactique de l’occasion, du moment opportun (kairos), qui prédispose à la rencontre d’une trouvaille. Michel de Certeau en voit la trace dans la mètis des Grecs, analysée par Marcel Detienne et Jean-Pierre Vernant dans Les Ruses de l’intelligence (1974), et il choisit d’en détailler le mécanisme pour pouvoir mieux comprendre, au chapitre suivant de son essai L’Invention du quotidien, les « Marches dans la ville », la façon dont les « marcheurs », à l’opposé des totalisations d’une vision surplombante ou panoramique, redécouvrent l’étrangeté du quotidien, en préférant le fragment et en amplifiant le détail, d’une part, en défaisant la continuité et en déréalisant la vraisemblance, d’autre part (il y a ainsi pour de Certeau une « rhétorique cheminatoire » qui repose sur la synecdoque et l’asyndète [11]). Cette façon d’isoler et de singulariser le détail de la déambulation urbaine est de fait à l’œuvre dans la série « Fictions dans un paysage » de François Bon. Cette série, sous-titrée « De l’imaginaire du monde par nos photographies qui l’arrêtent » (je souligne), appartient, comme la série « Étrangetés concernant les villes », à la rubrique plus vaste « Tunnel des écritures étranges », et peut nous aider à comprendre le dispositif d’écriture du blogueur-flâneur : F. Bon évoque en effet pour « seule contrainte un lien le plus organique possible entre le texte – censé ne rien connaître d’autre, à ce moment précis, que ce qu’elles isolent provisoirement – et la série d’images sur un même point très précis de réel qu’on arrête. » (je souligne). Il ajoute : « C’est une série au long cours, uniquement basée sur l’irruption – tellement rare bien sûr – de ce dépaysement [12]. »
Or l’« irruption du dépaysement », l’apparition soudaine de l’étrange dans le quotidien qu’arpente le flâneur, et le retournement déréalisant de la perception ordinaire, reposent sur une gestion spécifique du temps et de la mémoire, sur cette saisie de l’occasion, du moment opportun, qu’analyse précisément Michel de Certeau. Ce retournement, qui fait que l’ordinaire le plus pauvre devient la source d’un potentiel insoupçonné, implique la mise en œuvre d’une mémoire pratique, d’une mémoire des expériences passées, concentré de savoir qui s’actualise paradoxalement dans l’instant (« l’occasion loge tout ce savoir sous le volume le plus mince. Elle concentre le plus de savoir dans le moins de temps [13] »). Qu’on songe par exemple à la quête du chineur qui saura repérer, au plus obscur d’une boutique délabrée, une pièce de grand prix, parce qu’il aura reconnu la courbe ou l’éclat d’un type d’objets qu’il collectionne depuis longtemps. Autre paradoxe associé à la saisie du moment opportun, celui qui s’opère dans la « juxtaposition de dimensions hétéronomes [14] », dans la requalification de l’objet perçu, pour suivre l’exemple du chineur, où le plus ordinaire (le débris apparent) devient le plus précieux (un violon de faïence, un éventail peint par Watteau [15]…). Un ordre spatial stabilisé (ici la boutique ensevelie dans sa poussière séculaire) est modifié par l’irruption du temps tranchant de l’occasion, et un « invisible savoir » bouleverse le « pouvoir visible [16] » (le beau est découvert en un endroit étiqueté dans l’espace social comme lieu de rebut).
N’est-ce pas ce fonctionnement que l’on trouve à l’œuvre dans « La disparition de la jeune fille en rouge », extrait de la série « Étrangetés concernant les villes » de François Bon, où un escalier (de parking ?) est requalifié comme un « avaleur » ? Si l’escalier anodin, aux montants de béton maculés d’inscriptions taguées, est soudain perçu comme un prédateur, gueule ouverte vers une passante qui le frôle (comme le montre la photographie qui ouvre le texte), c’est parce qu’une mémoire de savoirs et d’expériences disjointes (« On dit que les villes sont vivantes. » ; « On leur a tant demandé, à nos villes. On les use […], on les creuse […] » ; « On dit que la fonction sacrificielle est si vieille dans nos sociétés […] »), s’actualise soudain dans un choc ici complexe, celui d’une rencontre sitôt doublée d’une disparition (« Elle était là et puis soudain plus [17] »), qui transforme la perception du contexte immédiat, soudain rendu responsable de la disparition, « de façon quantitativement disproportionnée » à l’équilibre alentour qui semble perdurer. La stabilité environnante, thématisée en amont par « la boutique étroite, l’air comme endormie » avec ses « alternateurs alignés sur des étagères » (de sorte que le narrateur est presque un collectionneur fasciné par la série, « répétition d’un objet de plus chargé pour moi de mémoire », « curieux assemblage » qui prépare la découverte de l’autre curiosité qu’est « l’avaleur »), l’est en aval par le vide dans lequel résonne l’événement (vide de la boutique, vide des alentours). Mais la saisie du moment a fait jaillir un savoir nouveau, la conscience que la « structure de fer et de béton, immobile », est en fait un « avaleur » dont il faut désormais s’éloigner prudemment. Face à la banalité anesthésiante de l’ordre urbain se dresse la dénonciation de sa violence cachée, qui programme la disparition perlée des individus auxquels on cesse d’être attentifs, plus radicalement encore que ces objets vieillissants des boutiques étroites auxquels s’attache encore la nostalgie du promeneur [18]. L’instant de la saisie est d’autant plus dramatisé qu’il résonne comme celui d’autres pertes à venir. Le kairos de la rencontre du flâneur est un moment d’autant plus précieux qu’il est plus fragile, et le flâneur connaît le maelström menaçant dans lequel il se produit (« La rue assourdissante autour de moi hurlait », dit Baudelaire) : pour l’écrivain blogueur, ce n’est plus seulement le tourbillon de la ville, c’est aussi celui de l’espace virtuel du web qui lui confère la conscience aiguë de cette fragilité.
Doc. 3 – « La disparition de la jeune fille en rouge », image liminaire (François Bon, Tiers Livre, série « Étrangeté concernant les villes », ici).
À la flânerie urbaine répond ainsi l’autre flânerie, dans le cyberespace, quand la rencontre dans l’espace réel transcrite par le texte et l’image devient chez le lecteur naviguant dans l’espace virtuel l’occasion d’une autre trouvaille, suscitant à son tour la mise en jeu d’une mémoire des expériences passées qui s’actualise en un instant. Ce jeu de réactions en chaîne a également été pensé par Michel de Certeau, qui met en valeur l’altérité qui stimule la mémoire que mobilise l’occasion :
La mémoire pratique est régulée par le jeu multiple de l’altération, non seulement parce qu’elle ne se constitue que d’être marquée des rencontres externes et de collectionner ces blasons successifs et tatouages de l’autre, mais aussi parce que ces écritures successives ne sont « rappelées » au jour que par de nouvelles circonstances. […] la mémoire est jouée par les circonstances, comme le piano « rend » des sons aux touches des mains. Elle est sens de l’autre. Aussi se développe-t-elle avec la relation […]. Plus que enregistrante, elle est répondante [19].
On comprend que cette mémoire répondante « du tac au tac [20] » est aujourd’hui particulièrement stimulée par la circulation de l’information en réseaux, et on peut voir l’exemple de ces trouvailles en chaîne lorsque les commentaires accueillis sur la page du blogueur ne sont pas simple acquiescement, mais rebondissement et surgissement d’une autre image. Ainsi, sur le site Gammalphabet où Jean-Yves Fick publie chaque jour un court poème proche du haiku, et parfois une photographie, peut-on trouver le texte suivant, dont nous donnons ensuite le commentaire qu’il a suscité un jour après :
infime — 112 13 juillet 2016
aux lisières du jour
des rires d’étoiles
peu à peu qui s’effacentsans jamais d’ironie
le fleuve découvre
leurs reflets sur ses rivesmême aux sables noirs.
loess de miroirs, grain à grain l’écho se mire [21]
Dans le poème de J.-Y. Fick se déploie un petit diptyque qui oppose un ciel d’aube à l’obscurité du fleuve, étrangement unifié par un picotement pâlissant d’étoiles. Or le commentaire est surtout sensible à cet émiettement, qu’il accentue, et transpose sur le plan sonore (dans l’image et l’allitération généralisée en r). Ce rebondissement est peut-être inconsciemment stimulé par la photographie postée le même jour par Jean-Yves Fick (sans lien direct avec le poème) et intitulée « Machiner la pluie – totem urbain 1 », où des architectures urbaines floutées par la double médiation, qui écrase la perspective, d’une vitre et de la pluie, donnent l’illusion d’un visage stylisé. Si le lien entre le commentaire (qui se rapporte au poème) et l’image (laissée sans commentaire), n’est pas délibéré, en dépit des jeux de miroirs et de délitements qu’ils partagent, l’architecture de la page dessine l’habituel carrefour qui appelle le surgissement d’autres rencontres, et peut-être, de nouvelles fulgurances, avec les autres interventions sollicitées, concernant le même poème (« Laisser votre commentaire »), ou répondant au premier commentaire (« Répondre »), ou renvoyant aux poèmes précédant (« Machiner la pluie – totem urbain 1 ») ou suivant (« infime – 113 »).
Doc. 4 – « Machiner la pluie – totem urbain 1 » (Jean-Yves Fick, Gammalphabet, 13 juillet 2016, ici).
Doc. 5 – Commentaire signé « annajouy, 14 juillet 2016, 17h25 », au poème « infime – 112 » (Jean-Yves Fick, Gammalphabet, 13 juillet 2016, ici).
On voit comment cette écriture du blog maximise son ouverture à toutes les rencontres, et démultiplie la force subversive du kairos, en mobilisant une pluralité de mémoires, potentiellement riches de « détails ciselés, singularités intenses [22] », et susceptibles de produire des retournements inattendus. Michel de Certeau prolonge l’analyse de ce fonctionnement de la mémoire, dont il restitue l’étonnante plasticité dans ses actualisations instantanées et souvent disruptives, jusqu’à une sorte de préscience des usages contemporains du web :
Le plus étrange est sans doute la mobilité de cette mémoire où les détails ne sont jamais ce qu’ils sont : ni objets, car ils échappent comme tels, ni fragments, car ils donnent aussi l’ensemble qu’ils oublient ; ni totalités, car ils ne se suffisent pas ; ni stables, puisque chaque rappel les altère. Cet « espace » d’un non-lieu mouvant a la subtilité d’un monde cybernétique. Il constitue probablement […] le modèle de l’art de faire, ou de cette mètis qui, en saisissant des occasions, ne cesse de restaurer dans des lieux où les pouvoirs se distribuent l’insolite pertinence du temps [23].
Il en ressort que flânerie urbaine et flânerie sur le net relèvent toutes deux d’un art de faire, d’un savoir pratique où la saisie du moment joue un rôle crucial, à chaque instant, et le monde, mouvant, se réinvente, dans chacune de ces occasions captées et retournées.
En décrivant un « art de la mémoire » fondé sur la gestion empirique du moment, De Certeau s’oppose à une conception plus traditionnelle des techniques de mémoire depuis l’Antiquité, où la remémoration des choses repose sur leur insertion dans un quadrillage spatial, assemblage des éléments d’une architecture, voire vitrines successives d’une collection : de la sorte, « la spatialisation du discours savant » rationalise et contrôle l’imprévisible de l’occasion [24].
Or ces deux modèles coexistent en réalité : il y a de fait une tension persistante entre, d’une part, le quadrillage rationalisant de la taxinomie, qui garantit une visibilité du contexte, et, partant, une lisibilité de la trouvaille, progressivement enveloppée dans les couches successives de ses significations, de ses appartenances à des classifications, et, d’autre part, l’aléa des empilements d’expériences qui ont créé l’occasion et permis l’émergence soudaine de ladite trouvaille.
Cette tension est diversement gérée sur les blogs littéraires. Certains parient plutôt sur le surgissement : le poème du jour apparaît dès l’accès à la page d’accueil de Gammalphabet, il faut dérouler longuement celle-ci pour découvrir enfin le blogroll, menu latéral où sont listées d’abord les billets les plus récents, ensuite les différentes séries poétiques dans lesquels ils sont réordonnés. Sur la page d’accueil du site « Désordre » de Philippe de Jonckheere, des photos sont jetées en vrac (tas épars remélangé à chaque navigation), sur lesquelles il faut cliquer pour accéder à une série qu’on peut alors dérouler chronologiquement, mais sans jamais pouvoir visualiser une architecture d’ensemble du site [25].
Doc. 6 – Page d’accueil du site « Désordre » de Philippe de Jonckheere (https://www.desordre.net/), le 6 août 2016.
À l’opposé, d’autres sites s’ouvrent d’abord par un sommaire. Celui du Tiers Livre de François Bon, quoique détaillé, semble répondre à une rhétorique assez pragmatique, qui mime les interrogations du lecteur (sa première subdivision s’intitule « qui quoi comment ? », et chaque page contient dans son en-tête la formule « mais quelle est cette rubrique (se repérer) »). La page d’accueil des Carnets d’Arnaud Maïsetti propose quant à elle un sommaire extrêmement soigné, en diverses catégories qui contiennent chacune trois subdivisions, lesquelles listent les trois textes les plus récents. Mais chaque page du carnet présente ensuite, au-delà d’un menu latéral gauche avec un sommaire simplifié qui reprend le dispositif classificatoire initial, un choix de liens qui invite à une circulation plus libre sur le site, et qui répond à une rhétorique plus désinvolte : « par le milieu », « une autre page des carnets arrachée par hasard ». À contrepied des dispositifs taxinomiques qui balisent trop strictement la lecture et limitent la surprise des rencontres, il s’agit d’encourager celles-ci en multipliant comme on l’a vu les carrefours, mais on peut se demander si la quête du « moment », constamment stimulée puisqu’il suffit de cliquer sur un lien, n’est pas à tout moment menacée par la nomenclature, et la trouvaille sur le point de s’enliser dans l’exhibition ou le classement de la collection. Est-ce que les mises en listes piègent l’instant du surgissement ? À moins qu’elles ne le protègent et le pérennisent dans l’espace mouvant du web…
3. L’art de l’infime et de la fugue
On voudrait finalement s’attacher à la façon dont certains blogs littéraires s’efforcent de thématiser l’instant, quand il est moins temps du retournement que temps qui passe et temps qu’il fait, temps mouvant mais suspendu dans le moment de sa captation (sensorielle et/ou photographique) et de sa transcription (écrite), temps rendu sensible dans l’attention à l’infime, non plus temps électrisé du surgissement mais temps autrement arrêté dans sa continuité, par une préhension ponctuelle. Le flâneur, comme on sait, a la tête en l’air et le nez au vent, à moins qu’il ne scrute à terre un détail insignifiant.
La démarche n’est pas nouvelle. Comme le rappelle Marie-Ève Thérenty, « il ne faudrait pas imputer au Web l’invention de phénomènes qui lui sont bien antérieurs et qu’il amplifie et renouvelle comme l’écriture du quotidien, le travail sur le fragment [26] […] ». Le flâneur des poèmes en prose du Spleen de Paris est fasciné par « l’architecture mobile des nuages », « les merveilleuses constructions de l’impalpable [27] ». L’écriture diariste des Goncourt enregistre le jour qui « se lève pour la première fois dans la brume d’automne » (6 octobre 1870), « un ciel de sang, une lueur de cerise, teignant le ciel jusqu’au bleu ombre de sa nuit … » (24 octobre 1870), « un léger lavis de nuages violets sur une feuille de papier d’or » (27 octobre 1870) [28]. Le haïku a rendu compte aussi des instants du jour, et ajoute à l’éphémère de la notation, la brièveté de la forme et l’effet de surprise de la chute. Ces différents héritages (et le dernier cité, particulièrement) inspirent l’écriture littéraire des blogs, comme l’attestent ces deux exemples, emprunté l’un au site « Paumée » de Brigitte Célérier, l’autre au site « Fut-il » de Christophe Sanchez : « ciel de pierre bleue / sous coup de fouet modéré / du seigneur mistral » (mardi 2 aout 2016, « Dans les rues, matin ») [29] ; « L’attente de l’aube / Monte en ventre bleu / Et rouge, couperose / Sur le visage de l’im- / Patient » (vendredi 8 janvier 2016) [30].
On voudrait surtout s’attarder sur les poèmes du site Gammalphabet de Jean-Yves Fick, parfois rangés dans des séries au titre explicite (« Infimes », « Formes de peu »), qui comptent chacune plus d’une centaine d’items. Ces poèmes sont aussi tressés aux fils d’autres catégories : « Icaria », « Notes brèves », « Riens »… Dans ces séries ouvertes, qui classent tout en mélangeant, et étiquettent en blanc, car elles n’indiquent que le vide ou le presque néant, l’écrivain laisse en outre visibles des ratures et des tâtonnements, dans un site lui-même placé sous le signe de l’essai (avec son sous-titre « Des essais de voix par temps contemporain ») :
infimes – 118, 25 juillet 2016
des feuillages
d’encore l’été
et dessous des voixque viennent mêler d’ombres
les formes diverses du jour
avant que les yeux ne se fermenttout un monde bascule chute vers sa nuit [31].
L’instant fragile du soir d’été où des voix conversent se dit dans un feuilletage de formes, de sons, d’ombres, et la frêle épaisseur s’abolit. Confusions infimes d’échos ténus qui sont pourtant preuves de l’être :
infimes – 123, 3 août 2016
rumeurs
comme de voix
mais ce sonttout bas
d’autres hôtes
qui bruissentl’exister — [32]
cela que hisse delà
le corps soudain aboli évanoui évanescent épuisé
regarde l’étrange
extrême de vivre [33].
Objets non finis, glissés dans des séries ouvertes, à l’intersection de fils à tresser encore, voilà ce que semblent être les instants captés, en mots transposés, de Jean-Yves Fick. Loin de la taxinomie qui fige l’instant, il suscite, comme Des Esseintes avec son orgue à parfums dont des touches manquent, de curieuses contre-collections [34], qui jouent de la perception et de son évanescence, de l’essence et de son abolition, de l’émergence et de la néantisation : le plus fragile, et le plus essentiel, de chaque instant, paradoxalement travaillé et esthétisé dans sa fragilité même.
Notes
[1] En ligne ici. Voir aussi la récente synthèse de Marie-Ève Thérenty, « La rue au quotidien. Lisibilités urbaines, des tableaux de Paris aux déambulations surréalistes », Romantisme, n° 171, 2016, p. 5-14.
[2] http ://www.arnaudmaisetti.net/spip/spip.php?article1726, consulté le 6 août 2016. Voir aussi la page « Enjoy », de la même série « La ville écrite ». La violence coercitive de la ville suscite un positionnement à rebours du flâneur, comme l’avait déjà montré Walter Benjamin (Chapitre III, « Le flâneur » dans Charles Baudelaire. Un poète lyrique à l’apogée du capitalisme, Payot, 2002).
[3] « L’œil dans la ville », http ://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article3231, consulté le 6 août 2016.
[4] « Branche 4 bis du tombeau de Joseph Beuys », http ://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article3231, consulté le 6 août 2016.
[5] Paris, capitale du XIXe siècle, Exposé de 1939, « Louis-Philippe ou l’intérieur », Cerf, 1989, p. 40 sq.
[6] Sur l’utilisation de ce registre chez F. Bon, en lien avec la déambulation urbaine, voir notamment Gilles Bonnet, François Bon. D’un monde en bascule, La Baconnière, 2011 (chap. 5, « Mondes possibles », section « Dans la ville fantastique », p. 185 sq.)
[8] Voir mon essai Poétique de la collection au XIXe siècle, Presses universitaires de Paris-Ouest, 2010, accessible en ligne : http ://books.openedition.org/pupo/618?lang=fr
[9] « Remembrance of things past », http ://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article3536, consulté le 6 août 2016.
[10] « J’ai dormi dans mon absence (nuits Cergy) », http ://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article4066, consulté le 6 août 2016.
[11] L’Invention du quotidien (1980), Gallimard, « Folio Essais », 1990, t. I, p. 151 sq.
[12] « Fictions dans un paysage. Sommaire général », http ://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article4004, consulté le 6 août 2016. C’est F. Bon qui souligne le mot dépaysement.
[13] L’Invention du quotidien, op. cit, p. 126.
[14] Ibid., p. 127.
[15] Ce sont les trouvailles respectives des héros de Balzac et de Champfleury (Le Cousin Pons, 1847 ; Le Violon de faïence, 1862).
[16] Ibid., p. 128.
[17] « Un éclair… puis la nuit ! » (Baudelaire, « À une passante »).
[18] L’obsolescence est une thématique privilégiée de l’écriture littéraire du blog : voir par exemple Dominique Hasselmann, « Machine-aérolithe d’un temps disparu », http ://remue.net/spip.php?article1686, et, sous forme de séries de textes et d’images, les devantures condamnées du blog « Au petit commerce », http ://aupetitcommerce.tumblr.com. C’est « l’archéologie du présent » qui s’écrit alors sur le net, pour reprendre le titre évocateur d’un portfolio du photographe Georgios Makkas, « The Archeology of Now », http ://www.gmakkas.com/portfolio/C00005CBWq5gxTjk/G00005nk8B9pj9n4 (sites consultés le 6 août 2016).
[19] L’Invention du quotidien, op. cit., p. 132.
[20] « L’occasion, saisie au vol, ce serait la transformation même de la touche en réponse, un « retournement » de la surprise attendue sans être prévue : ce qu’inscrit l’événement, si fugitif et rapide qu’il soit, est retourné, lui est retourné en parole ou en geste. Du tac au tac. » (ibid., p. 133).
[21] https ://gammalphabets.org/2016/07/13/infime-112/, consulté le 6 août 2016.
[22] L’Invention du quotidien, op. cit., p. 133.
[23] Ibid., p. 133 (je souligne).
[24] Ibid., p. 134. M. de Certeau se refère à l’important ouvrage de Frances Yates, The Art of Memory (1966, première traduction française en 1975).
[25] https ://www.desordre.net/, consulté le 6 août 2016.
[26] Marie-Ève Thérenty, « L’effet-blog en littérature. Sur L’Autofictif d’Éric Chevillard et Tumulte de François Bon », Itinéraires [en ligne], 2010-2 | 2010, http ://itineraires.revues.org/1964, p. 61, consulté le 6 août 2016.
[27] Baudelaire, « Le port », « La soupe et les nuages ».
[28] E. de Goncourt, Journal, éd. Robert Ricatte, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 1956, t. II, p. 304, 320, 322.
[29] http ://brigetoun.blogspot.fr/, consulté le 6 août 2016.
[30] La série « Morning à la fenêtre » de Christophe Sanchez a été pensée à l’avance dans sa périodicité et dans sa mise en forme textuelle, mais aussi dans sa publication, comme l’atteste le commentaire de la dernière livraison, publié le 13 janvier 2016 : « C’est la dixième semaine du « morning » par la fenêtre. Deux strophes de quatre vers avec la contrainte de terminer par un vers court, un ou deux mots. Chaque « poème » est publié sur les réseaux sociaux. Un par jour. » (http ://www.fut-il.net/2016/01/morning-la-fenetre-s10.html, consulté le 6 août 2016). Il s’agit de « co-joindre le temps de l’écriture et de la publication », également « datés et préservés par la date », et par-là moins périmés que placés « sous la sauvegarde de l’événement », pour reprendre les termes d’Arnaud Maïsetti (« Lire et écrire numérique : journal d’un désœuvrement », 5 juin 2013, http ://arnaudmaisetti.net/spip/spip.php?article1077, consulté le 6 août 2016).
[31] https ://gammalphabets.org/2016/07/25/infimes-118/, consulté le 6 août 2016.
[32] https ://gammalphabets.org/2016/08/03/infimes-123/, consulté le 6 août 2016.
[33] https ://gammalphabets.org/2016/07/31/formes-de-peu-213-2/, consulté le 6 août 2016.
[34] Voir mon article « Huysmans et la collection : le bazar, le répertoire, le bouquet, le recueil », Bulletin de la Société J.-K. Huysmans, n° 101 (centenaire de la mort de Huysmans), dir. André Guyaux, 2008, p. 17-44.
Auteur
Dominique Pety est professeure de littérature française à l’Université Savoie Mont Blanc depuis 2008. Ses travaux de recherche concernent particulièrement les représentations de la collection au XIXe siècle (Les Goncourt et la collection. De l’objet d’art à l’art d’écrire, Droz, 2003 ; Poétique de la collection au XIXe siècle. Du document de l’historien au bibelot de l’esthète, Presses universitaires de Paris-Ouest, 2010), ainsi que l’organisation des savoirs et les pratiques de classement : elle a notamment codirigé la Bibliographie du XIXe siècle Lettres-Arts-Sciences-Histoire, initiée par Claude Duchet, de 1999 à 2009 (SEDES puis Presses de la Sorbonne Nouvelle). Elle travaille actuellement sur les représentations de l’amateur, des anciennes pratiques savantes aux technologies du numérique (voir notamment Dominique Pety (dir.), Patrimoine littéraire en ligne : la renaissance du lecteur ?, Chambéry, Publication de l’Université Savoie Mont Blanc, « Corpus », 2015).
Copyright
Tous droits réservés.