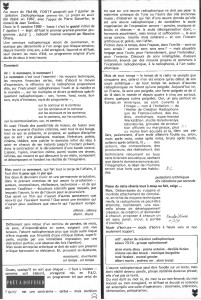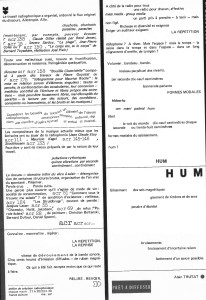Quelques réflexions autour du documentaire et sa difficulté d’être ici et ailleurs
Texte intégral
Toute grande entreprise a coutume d’installer – généralement dans lieux bizarres, combles, serres ou pavillons isolés- des laboratoires de recherche, banc d’essai, centres expérimentaux – centres plus ou moins marginaux, si l’on peut dire- dont il est attendu beaucoup mais dont on se défie toujours quelque peu [1].
Réfléchir à partir de la proposition « Désir de belle radio : documentaires » : un défi.
Si nous le relevons c’est que, depuis un certain temps, l’avenir d’une « belle radio » et de (beaux) documentaires nous semble incertain. Et ce pas seulement en France : dans beaucoup d’autres pays, les documentaires – surtout ceux dits « de création » – deviennent plus rares, se fabriquent dans des conditions plus contraignantes, disparaissent de la grille, parfois en même temps que le programme dédié, jusqu’alors, à leur production [2].
Mais comment répondre à un défi s’ouvrant sur un domaine vaste et obscur, semé d’embûches et hanté par le souvenir de jours (qui nous semblaient) meilleurs ?
Mon entrée en matière sera par les quatre mots clefs destinés à sous-tendre une réflexion qui, tout en restant fragmentaire, va tenter d’interroger l’état des choses à l’heure actuelle.
1. Désir
Curieusement – et peut-être seulement dans ce contexte particulier – c’est le mot désir qui est le plus facile à définir :
– quelque chose auquel on aspire, vers lequel on tend (dit le Robert).
Pour le documentariste, le désir est une deuxième nature : désir d’arpenter des villes invisibles, d’écouter des mondes nouveaux, de les faire entendre en les écrivant avec des sons ne connaît pas de limites… alors qu’en même temps deviennent moins nombreux et plus étriqués les lieux où pratiquer cette écriture singulière ; des lieux qui « entendent bien » qu’écrire avec des sons est une activité qui prend du temps, beaucoup de temps ; et qui comprennent que le temps est le tribut qu’il faut payer au son capturé.
2. Beau
Le poète dit :
Beauté c’est Vérité, Vérité est Beauté, – voilà tout
Ce que vous savez sur terre, tout qu’il vous faut savoir [3].
Mais le poète (John Keats) parle d’une forme de beauté, spécifique et codée – celle du classicisme grec – et le « beau » n’est pas une valeur absolue, empirique, immuable. « La beauté » est un concept abstrait, subjectif, variable, versatile, conditionnel, contingent, traître. En quelque sorte intraitable.
« Des goûts et des couleurs on ne discute pas », dit le proverbe.
Pour que quelque chose soit considéré comme « beau », il faut un contexte qui le reconnaît en tant que tel, qui désire qu’il le soit et qui est heureux de reconnaître qu’il l’est.
Il en va de même pour les documentaires.
Jusqu’à présent ce contexte « désirant » et (littéralement) « reconnaissant » a toujours été « la radio ». Mais si, un jour, cet espace n’existait plus – et on le craint par moments – quel « comble, serre, ou pavillon isolé » pourrait le remplacer ?
Faire « de la radio », c’est pratiquer un métier artisanal dont le savoir-faire est transmis sur le terrain, par des compagnons.
3. Radio
Ah ! Le comment, le comment !
Le comment c’est tout l’essentiel : les moyens techniques, les moyens financiers, certes, mais d’abord le moyen d’expression, la réflexion sur la radiophonie proprement dite, sur l’instrument radiophonique l’outil et la matière et la manière, sur les problèmes spécifiquement radiophoniques— son, forme, fond, texte, écriture [4]…
« Avant »… c’est-à-dire :
avant la révolution numérique…
avant la démocratisation de l’outil permettant à tous de « faire de la radio » : (enregistrement, montage, mixage)…
avant, donc, le raz-de-marée de podcasts venu saturer un espace considéré, jusqu’alors, comme exclusivement « radiophonique »…
il fut un temps où on pensait savoir ce que le mot « radio » voulait dire.
Peut-être qu’on ne sait plus.
Si, parfois, nous oublions que les mots « radio » et « podcast » sont des métonymies (le nom de l’objet diffusé est remplacé par celui qui désigne le mode de diffusion), nous sommes obligés de constater que les mots « podcast » et « radio » sont en train de devenir interchangeables, synonymes.
Mais
est-ce que un « podcast » est « de la radio » ?
Est-ce qu’un « podcast » peut être « de la radio » ?
Est-ce qu’un « podcast » voudrait être « de la radio » ?
Est- ce qu’un « podcast » parle la même langue que la radio ?
Ou bien, est-ce qu’un « podcast » est « autre chose » ? (Nouvelle tentative pour s’emparer des ondes, par exemple ? Rappelons-nous les utopistes, les futuristes et les autres qui ont voulu le faire.)
Ou encore, (ce qui n’est pas impossible) est-ce qu’un « podcast » ne serait qu’une façon de faire, à moindres frais, quelque chose qui ressemblerait à « de la radio » ?
« Autre chose ».
Parfois, dans un forum comme celui-ci, on serait tenté d’oublier que la vocation première de la radio n’est pas la création mais la communication d’information rendue accessible au plus grand nombre, grâce à une ligne éditoriale séduisante. La diffusion de fictions et de concerts de musique (sous-produits de la grande culture « générale ») est assimilable à cette démarche ; alors que la création proprement « radiophonique » (pourtant mentionnée explicitement dans la charte de la plupart des radios d’état, dont Radio France) suscite rarement beaucoup d’enthousiasme de la part de ceux qui ont le pouvoir de décider de son sort. Destinée à un public minoritaire (« élitiste »), gourmande en moyens techniques (« chronophage »), de facture et de contenu variables (« suspecte »), la création sonore suscite toujours une certaine méfiance. Sa place n’est jamais acquise d’avance. Les espaces qui lui sont accordés s’acquièrent à un certain prix, et pas pour toujours.
Vous avez entendu le dernier programme de l’Atelier de création radiophonique tel qu’il a été conçu à sa création en octobre 1969. Une belle aventure prend fin aujourd’hui.
Je m’appelle René Farabet ; avec l’équipe de l’ACR et tous ceux qui nous ont accompagnés à travers le temps, nous souhaitons un bel avenir radiophonique à vous, auditeurs fidèles et exigeants [5].
Depuis des décennies se poursuit, ainsi, un jeu curieusement répétitif qui consiste à octroyer un espace « libre », destiné à la création, pour le reprendre quelques années plus tard [6].
Jeu de donner-pour-reprendre dont la forme (si, par hasard, on était effleuré par le désir de la dessiner) ressemblerait à celle de l’électrocardiogramme d’un cœur malade.
4. Documentaires
Domaine infini du vécu à saisir… désorganisation des structures brutes… organisation de l’en vrac du spontané [7]…
En cherchant du côté des origines étymologiques du mot « documentaire », on trouve une définition bien plus austère que celle proposée par Alain Trutat. Du latin documentum (« modèle, exemple »), lui-même dérivé de docere (« montrer, faire voir, instruire »), le mot « documentaire » sert à désigner tout « objet » qui « documente » un « sujet » traitant d’un certain aspect du « réel ».
Quel que soit le sujet, la forme, ou le support, un documentaire se doit d’informer…
Cousin germain du reportage (censé être « objectif »), le documentaire s’en distingue. Derrière le reportage se cache un « rapporteur », un porte-parole ; derrière le documentaire se révèle un auteur (et son imaginaire) dont la présence sera plus ou moins affirmée selon le type de documentaire qu’il voudrait faire et l’attente du programme auquel l’émission est destinée. Et la gamme-vaste- s’étend depuis « le-court-moment-de-réel-brut-à-peine-monté » jusqu’à ces documentaires dits (sans doute faute d’avoir trouvé mieux) « de création ».
Mais quelle que soit sa forme, faire un documentaire est toujours une entreprise hasardeuse. À partir de sons « sauvages » – et tout son capturé, déplacé de son environnement normal, devient « sauvage » – l’auteur aspire à créer un univers. Et, pourtant, le documentaire est souvent considéré comme le parent pauvre de la famille radiophonique – paradoxalement parce qu’il est composé de quelques sons « réels ». Il n’a pas les titres de noblesse de la fiction ou de la musique, pas l’authenticité du journal parlé, ni l’utilité d’un bulletin météo : il n’est pas traité avec les mêmes égards.
******
Quand l’homme a voulu imiter la marche, il a inventé la roue pas une jambe
disait Apollinaire [8].
Quand on me demande quel est mon métier, je dis que « je fais des documentaires ».
Je ne sais pas si c’est tout à fait vrai.
Il est vrai que mes « documentaires » traitent du monde réel – mais seulement d’une certaine façon ; que mes « protagonistes » sont des gens ordinaires, souvent anonymes ; que je partage avec le genre documentaire un certain goût pour cette banalité qui caractérise le réel (le réel est essentiellement banal) que je décline en moments discontinus composés de bribes de voix et de sons, toujours « naturels » – mais découpés, déplacés, mixes, sur-mixés…
Mais il est vrai, aussi, que loin d’informer, mes soi-disant documentaires – et ceux de beaucoup d’autres « documentaristes » – ne tiennent pas seulement à « informer » ; ils voudraient surtout faire rêver, transporter l’auditeur ailleurs, dans un espace-temps « autre ». Leur point de départ est rarement un sujet à documenter ; c’est une intuition, un détail. Le « sujet » se révèle fugitivement, progressivement, au fur et à mesure que la matière sonore se travaille. Le sujet est contenu dans le son. C’est le son qui va déterminer le sens. C’est le son qui est (en quelque sorte) le sens. « Le sujet », en fin de compte, sera probablement très peu de chose, du « presque rien » : quelques moments de « sensation vraie » (selon la phrase de Peter Handke).
******
Suite à des études de littérature française en Australie et en France, j’ai entamé – par hasard et avec un enthousiasme teinté d’innocence – une carrière à l’Australian Broadcasting Corporation. Je ne savais pas ce que « faire de la radio » voulait dire : je n’avais jamais été effleurée par le moindre désir d’en faire (bien que la radio m’ait accompagnée le long d’une enfance un peu solitaire, passée à la campagne).
À cette époque, l’ABC était « une radio de service » dont la mission (explicite) était de « vaincre la tyrannie de la distance » qui régnait sur un continent immense peuplé de 8 millions d’habitants. Le signal sonore était fort, et les formes épurées ; des sons et des voix traversaient les airs en lignes droites.
Dans mon souvenir, c’était assez beau.
Mais l’ABC était aussi une radio qui portait la trace – les stigmates ? –de ses origines. C’était une « radio colonisée », une copie conforme de la BBC – jusqu’à la moindre inflexion de chaque
voix.
Cela paraissait étrange, même à l’enfant que j’étais alors.
******
Tout ce qui est sonore aujourd’hui s’étouffe, a besoin de reprendre un peu d’air pour survivre, à la façon des oiseaux […]
En occident nous avons perdu l’oreille et c’est dire que nous sommes aveugles. Nos yeux s’arrêtent sur les objets mesurables et c’est dire que nous sommes sourds.
Il nous faudrait […] savoir que nos œuvres les meilleures s’inscrivent toujours dans le vent des sables [9].
******
Quand je suis arrivée à l’ABC pour y travailler, des années plus tard, tout avait changé. Les anciens moules étaient en train de craquer. Ça sentait la marihuana dans la rue et la révolution dans le studio. Partout – sur les murs et sur toutes les lèvres- le même mot d’ordre :
« à bas la colonisation culturelle ».
Le désir de « belle radio » était très fort. Et pour que la radio fût « belle » il fallait qu’elle parle notre langue.
La lutte idéologique s’est dédoublée (c’est souvent le cas) d’une dimension esthétique : le désir de trouver/ inventer/ posséder/ savoir manier un langage radiophonique qui soit vraiment à nous.
Paradoxalement, ce désir nous a amenés ailleurs.
Nous avons décidé d’écouter et d’analyser des créations radiophoniques provenant d’autres pays ; nous voulions entendre d’autres voix, d’autres formes, d’autres types de syntaxe sonore.
Ce sont les émissions de l’Atelier de création radiophonique de France Culture – de facture si différente d’autres formes radiophoniques croisées jusqu’alors – qui ont retenu mon attention : écheveaux de paroles et de sons d’où jaillissaient des mondes invisibles, des histoires racontées autrement, qui résonnaient ailleurs, quelque part au-delà de la parole.
Une façon d’ « écrire sur bande magnétique », disait Alain Trutat.
Et, c’est ainsi, en écoutant ces émissions singulières, que j’ai commencé à comprendre que le son pouvait être un langage à part entière, avec une syntaxe qui lui est propre.
Un langage dont toute tentative de transcription (autre que la trace qu’il laisse en nous) était vouée à l’échec.
Un langage écrit dans le vent des sables. Langage à jamais « étranger ».
Langage qu’il faudrait laisser dire ce que lui seul sait dire.
******
Son lavé, détaché de tout code, de toute convention psychologique. Pour.
Eternel rapport fond et forme et matière- la matière du son, élémentaire, nue, germinative.
Dire entre les lignes, entre les mots, le silence [10].
Notes
[1] Alain Trutat, « L’Atelier de création radiophonique », Cahiers d’Histoire de la radiodiffusion, n°92, avril-juin 2007, p. 197.
[2] L’Australian Broacasting Corporation (ABC) ; Danemarks Radio (DR) ; l’Italie (RAI) ; l’Espagne (RNE), les pays de l’ancienne Yougoslavie (dont surtout la Croatie, grande réalisatrice de documentaires de création) ; Yleisradio (Finlande) où les deux services de documentaires (de langue suédoise et de langue finnoise) ont disparu…
[3] John Keats, « Ode sur une urne grecque », dans Poèmes et Poésies, traduction Paul Gallimard, Paris, Mercure de France, 1910, p.148-149.
[4] Alain Trutat, op.cit., p. 198.
[5] Propos de René Farabet qui précèdent la diffusion de L’ingénieux maçon Lucio, de Cascante, Atelier de création radiophonique n°1399, diffusé sur France Culture le 30 décembre 2001. Enregistrement conservé à l’INA.
[6] Voir, par exemple, La radio d’art et essai après 1945, et La Radio après le Club d’Essai, Fabula, https ://www.fabula.org
[7] Alain Trutat, op. cit, p. 201.
[8] Guillaume Apollinaire, Les Mamelles de Tirésias, préface, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1967, p. 865.
[9] François Billetdoux, Dans le vent des sables, texte sur la Radiophonie écrit au moment de la première diffusion de l’ACR, le 3 octobre, 1969. Disponible à la BnF.
[10] Alain Trutat, op. cit, p. 200.
Liste des sons
1. Le Transcamerounais (extrait), par José Pivin, dans Prix Italia 1977, prod. René Farabet, France Culture, ACR du 23 octobre 1977. Enregistrement conservé à l’INA. Durée : 1’06.
2 Deux mouches s’étaient accouplées dans mon oreille, dans La Radio et les escargots, prod. René Farabet, France Culture, ACR du 10 juillet 1973. Enregistrement conservé à l’INA. Durée : 5’50.
3 Deux mouches s’étaient accouplées dans mon oreille (2e), même source. Durée : 5’00.
4. Phil Niblock : La Musique a besoin de temps, prod. René Farabet, France Culture, ACR du 20 octobre 1996. Enregistrement conservé à l’INA. Durée : 1’35.
5. Corbeau australien, enregistrement Kaye Mortley. Durée : 1’40.
6. Skye Boatsong, radio scolaire, archives Australian Broadcasting Corporation, date inconnue. Durée : 1’44.
7. Le voyage, par Kaye Mortley, France Culture, L’Expérience du 20 octobre 2019. Durée : 2’48.
8. India Song de Marguerite Duras, de et par Georges Peyrou, France Culture, Atelier de création radiophonique du 12 novembre 1974. Enregistrement conservé à l’INA. Durée : 3’30.
Auteur
Kaye Mortley, d’origine australienne, a fait des études de littérature française à Sydney (licence), Melbourne (master) et Strasbourg (doctorat), puis enseigné un temps à l’université avant d’intégrer le département « Fictions et documentaires » de l’Australian Broadcasting Corporation (ABC). Installée à Paris en 1981, elle produit des documentaires sonores pour l’ACR et d’autres émissions de France Culture comme Nuits magnétiques, Surpris par la nuit, L’atelier de la création ou (tout récemment) L’Expérience, ainsi que pour diverses radios d’État en Europe (Allemagne, Belgique, Finlande, Suisse), tout en gardant des liens avec l’ABC. Citons quelques œuvres à redécouvrir, parmi celles diffusées sur France Culture : Là-haut, le Struthof (ACR, 1995, version courte 1998) ; Une famille à Mantes-la-Jolie (ACR, 2000) ; Retour en Australie, série de 5 petites séquences sur les lieux de son enfance dans l’immense plaine de l’Ouest australien : « Le Train », « L’Aube », « La Route », « L’École », « Le Soir » (Résonances, 2001) ; Dans la rue (Le monde en soi, 2005) ; La ferme où poussent les arbres du ciel (Les Passagers de la nuit, 2011, trois épisodes ; autre version dans L’atelier de la création, 2013) ; Thèbes: ville fauve, ville noire – the road movie (L’atelier de la création, 2011) ; Si je perdais mes oreilles… je deviendrais aveugle (L’atelier de la création, 2014). En 1989, sollicitée par Phonurgia Nova, elle se lance pour quelques décennies dans l’animation d’ateliers de « documentaire sonore de création », ateliers mêlant théorie et pratique de l’écriture sonore, dont témoigne un ouvrage collectif paru en 2013 sous sa direction, La Tentation du son (Phonurgia nova éditions). Des prix internationaux (Futura, Europa, Italia, IRAB, grand prix de la SCAM) ont salué la qualité de son travail à plusieurs reprises.
Copyright
Tous droits réservés.