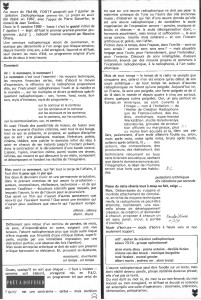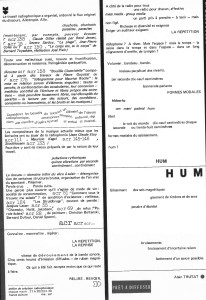Français
Si les écrits radiophoniques d’Hélène Cixous apparaissent marginaux au sein de son œuvre, ils rendent compte néanmoins d’un rapport singulier entre le rêve comme source d’inspiration créatrice et la radio comme medium par excellence de l’activité onirique. En effet, le motif des yeux clos associé au rêve chez Cixous renvoie directement au phénomène acousmatique de la radio. En outre, à l’instar du rêve, l’écriture radiophonique constitue pour elle une plongée dans la mémoire, tant personnelle qu’historique, et une traversée du royaume des morts. Cet article verra comment s’articulent travail du rêve et écriture radiophonique chez l’écrivaine en examinant les deux créations radiophoniques qu’elle a produites, à plus de trente ans d’intervalle, pour l’Atelier de création radiophonique : Portrait de Dora (1973), qui est une réécriture du célèbre cas Dora de Freud, et Ceci est un exercice de rêve (2005).
English
If Hélène Cixous’s radiophonic writing is a minor part of her work, the two pieces she wrote for the Atelier de création radiophonique (1973 ; 2005) indicate nonetheless a singular relationship between dreaming as a source of creative inspiration and radio as the medium of oniric activity par excellence. Associated with dreaming, the motif of the eyes closed actually evoks the acousmatic phenomenon of the radio. Furthermore, like dreams, radiophonic writing for Cixous is a plunging into the personal and historical memory, and a journey through the kingdom of the dead. The present article examines Portrait de Dora, broadcasted in 1973, which is a rewriting of Freud’s Case study on Dora, and Ceci est un exercice de rêve, broacasted 30 years later, in 2005, in order to see how the dream-work and the radiophonic writing are articulated.
Texte intégral
« L’autre vie [1] ». C’est ainsi qu’Hélène Cixous nomme, en écho à la célèbre formule du poète Gérard de Nerval, le mystérieux monde des rêves, dont elle n’a jamais caché qu’il constitue l’une des sources actives de son écriture de fiction depuis ses commencements. Dans les rêves, c’est « l’autre monde [2] », écrit celle qui se dit « droguée au rêve [3] » et dont les textes sont « dictés de nuit [4] » : « on y est sans effort, en fermant les portes des yeux [5] » ; c’est là, dit-elle encore, où « reviennent vivants les morts bien-aimés ». Si l’on ferme les portes des yeux, c’est pour percer, comme le dit Nerval, les « portes d’ivoire ou de corne qui nous séparent du monde invisible ». Derrière ces portes, affirme le poète, « le moi, sous une autre forme, continue l’œuvre de l’existence [6] ».
Les portes d’ivoire ou de corne, appelées également les Portes du Sommeil, sont une référence explicite au chant XIX de l’Odyssée : Pénélope, qui attend Ulysse depuis près de vingt ans, raconte, tout en s’interrogeant sur le sens de cette vision, qu’elle vient de faire un rêve pouvant signifier le retour de son mari. L’image des portes est reprise par Virgile dans son Éneide : après avoir décrit la descente d’Énée, conduit par la Sibylle de Cumes, aux enfers, Virgile rapporte par la bouche d’Anchise, le père du héros, que les rêves seront envoyés par les âmes des morts : ceux qui racontent la vérité sortiront par une porte de corne, tandis que les rêves trompeurs emprunteront une porte d’ivoire.
Le dispositif qui consiste à « fermer les portes des yeux » tout en empruntant, pour reprendre les mots de Cixous, « les couloirs magiques de la nuit [7] », apparaît paradoxal dans la mesure où c’est pour mieux voir du côté de l’invisible que l’écrivaine nous invite à renoncer à voir, renoncer à regarder : de l’autre côté en effet se loge, dit-elle, « le monde de la vision, de l’illumination [8] », qui fait écho à la « clarté nouvelle [qui] illumine » et aux « visions [9] » évoquées jadis par Nerval. En donnant accès à l’autre monde, le rêve selon Cixous permet ainsi de voir autrement, de pratiquer une autre forme du voir, de penser une autre forme de visible.
Ce dispositif se rapproche singulièrement de celui de la radio. Le fait de ne pas voir est en effet le propre de celle-ci ; elle crée ainsi, faut-il le rappeler, une situation acousmatique, c’est-à-dire une situation où « l’on entend le son sans voir la cause dont il provient [10] ». En tant qu’univers sonore sans visualité, la radio repose exclusivement sur les ressources de l’oralité et du son, c’est-à-dire sur les vibrations de celui-ci, les tessitures et les singularités des voix, la musique, le silence, etc. Ainsi, la radio amplifie les diverses sensations auditives, ou plutôt rend l’auditeur plus attentif à celles-ci.
La parenté entre le dispositif de la radio et l’expérience du rêve tel que le pense Hélène Cixous repose donc sur cette première étape : avoir les yeux clos, pour que s’accroissent d’autres sensibilités, pour que s’éveillent d’autres sens, d’autres manières de voir et de percevoir. Par ailleurs, l’allusion catachrétique aux portes dans ce contexte (« les portes des yeux ») rappelle le lien qu’établit Virgile entre le monde du sommeil et l’expérience du royaume des morts : rêver pour Hélène Cixous revient nécessairement à rencontrer les ombres. C’est ainsi une autre expérience de la mort qui se trouve éprouvée ; faisant du songe une allégorie à l’instar de Virgile qui allégorisait les créatures gardant l’entrée du royaume des morts (les Deuils, les Soucis, la triste Vieillesse, etc.), l’écrivaine révèle que « chez le Rêve, la mort devient ce qu’elle est : une séparation seulement presque interminable, interrompue par des retrouvailles brèves et extatiques, dans une rame de métro ou dans un train [11]. »
Je voudrais examiner ce rapport entre rêve et radio à partir de deux créations radiophoniques d’Hélène Cixous, écrites à plus de trente ans d’intervalle pour l’Atelier de création radiophonique, à savoir Portrait de Dora, diffusé en mai 1973, qui constitue une réécriture du célèbre cas Dora de Freud ; et Ceci est un exercice de rêve, diffusé en novembre 2005. Ces deux pièces apparaissent en effet emblématiques de ce lien singulier qui existe chez Hélène entre travail de rêve et écriture radiophonique.
1. Portrait de Dora[12] : une révolte féministe. Rêver, résister
1.1. La réécriture d’un cas freudien par la fiction
La pièce radiophonique Portrait de Dora, réalisée par Jean-Jacques Vierne, a été diffusée en deux parties dans le cadre de l’Atelier de création radiophonique les 22 et 29 mai 1973. Il s’agit d’une réécriture du « cas Dora » de Freud, publié officiellement en 1905 sous le titre Fragment d’une analyse d’hystérie [13], et il est intéressant de noter que le cas devait avoir pour titre à l’origine « Rêve et Hystérie ». La cure a eu lieu à la fin de l’année 1899, au moment même où paraissait à Vienne L’Interprétation des rêves (Die Traumdeutung). Il s’agit du cas clinique le plus célèbre de Freud et qui demeure l’éclaircissement par excellence, dans le champ analytique, de la névrose hystérique.
Résumons-le en quelques lignes : en octobre 1900, une jeune femme âgée de 18 ans, Ida Bauer (à qui Freud a donné le pseudonyme de Dora), est conduite par son père chez Freud. Ayant trouvé une note de suicide sur son bureau, le père s’inquiétait de ce que sa fille allait tenter de se donner la mort. Selon le père, ce dont Dora souffrait et les raisons pour lesquelles il voulait la faire soigner par Freud sont liés à deux événements qui ont eu lieu durant son adolescence. Le premier incident s’est produit à l’âge de treize ans et demi et impliquait Monsieur K., le mari de l’amante de son père, qui s’était trouvé seul avec elle dans son magasin et avait essayé de l’embrasser, provoquant la répugnance de la jeune fille. Le deuxième incident a eu lieu lors d’une visite, à l’âge de quinze ans et demi, chez le couple K. La « scène du lac », comme l’a baptisée Freud, a eu lieu à la maison de campagne où monsieur K. a fait des avances à la jeune fille. Cette fois-ci Dora ne s’est pas tue ; au contraire elle a fait un scandale de l’événement en racontant ce qui s’était passé à sa mère et en quittant inopinément l’endroit. Tout le monde s’est arrangé pour accuser Dora d’avoir fantasmé cette scène de séduction et cette ingérence pédophile. Dans le chapitre « L’état de la maladie » qui est l’occasion pour Freud de rappeler le sens que peut prendre pour lui la « fable d’Œdipe [14] », Freud expose ses hypothèses selon lesquelles les symptômes de Dora (toux, aphonie, épisode dépressif) seraient liés à un conflit psychique tournant autour de l’amour pour son père, auprès de qui elle aurait été évincée par l’amante de ce dernier, Madame K. ; conflit qui lui ferait refuser simultanément les avances de Monsieur K. Au cours de la cure, Dora fait deux rêves importants, auxquels Freud consacre deux chapitres entiers (« Le premier rêve », « Le second rêve ») : le rêve de l’incendie et celui de la promenade dans une ville étrangère, qui joueront un rôle essentiel dans la conduite de l’analyse. Cherchant à établir l’étiologie de la névrose hystérique tout en vérifiant sa théorie du rêve et celle du complexe d’Œdipe, Freud produit paradoxalement un récit qui laisse peu d’espace à la parole de Dora : par exemple, les moments où elle raconte ses rêves sont pratiquement les seuls passages au discours direct. En outre, peu d’espace est donné à l’incertitude, à la suspension du jugement, au doute de manière plus générale. La fin de la cure, on le sait, survient lorsque Dora quitte Freud précipitamment, abandonnant l’analyse après trois mois – « comme une gouvernante donne son congé quinze jours à l’avance [15] », selon la formule de Freud lui-même – mais s’abandonnant aussi elle-même d’une certaine façon, puisque, de fait, elle interrompt le travail analytique commencé avec lui. Sans que Freud le dise explicitement, la cure aura été un échec pour lui.
Au début des années 1970, lorsqu’Hélène Cixous est invitée à écrire une pièce pour l’Atelier de création radiophonique, la société française connaît sa deuxième vague de lutte féministe dont le Mouvement de Libération des Femmes (MLF), s’inscrivant dans le sillage du Women’s Lib aux États-Unis, est l’un des principaux acteurs. Née en Algérie, l’écrivaine Hélène Cixous, qui a déjà fait paraître cinq ouvrages de fiction en 1973, dont l’un, Dedans (1969), lui a valu le Prix Médicis, participe au mouvement et cherche à traduire dans son œuvre ce désir d’émancipation et de liberté. Elle s’intéresse par ailleurs à la psychanalyse et à ses potentialités créatrices, mais elle ne peut pas ne pas voir en même temps la normativité de ce champ théorique et sa tendance, dès les moments fondateurs, à reconduire des schémas de pensée patriarcaux et androcentrés. Cixous, comme bon nombre de féministes avant elle, cherche notamment à interroger les prémisses freudiennes sur l’hystérie afin de dévoiler sa prétention à l’objectivité scientifique au nom de laquelle l’on excluait toute une génération de femmes du discours émancipateur de la modernité, autrement dit au nom de laquelle toute expression de révolte ou de protestation de la part d’une femme était pathologisée comme hystérique. C’est dans ce contexte qu’elle écrit la pièce radiophonique Portrait de Dora, dont certains passages figurent dans son roman polyphonique Portrait du soleil, qui paraît la même année, dont Dora est l’un des personnages [16]. En réouvrant le cas Dora dans le cadre d’une fiction radiophonique et d’un roman, Cixous cherche non seulement à remettre Dora au centre de la cure, mais aussi à redonner place aux voix intérieures qui l’ont traversée et aux désirs qui ont été étouffés pendant le travail analytique effectué avec Freud. Trois ans plus tard, en février 1976, la pièce sera montée par Simone Benmussa au Petit Théâtre d’Orsay (Compagnie Renaud-Barrault) puis publiée aux Éditions des femmes [17]. Portrait de Dora est l’une des pièces de théâtre les plus connues d’Hélène Cixous, mais peu de gens savent que le texte a d’abord été une création radiophonique, c’est-à-dire une création destinée d’abord et avant tout à des voix. La pièce radiophonique de 1973 et la version mise en scène en 1976 sont assez proches ; néanmoins la version de 1976 est plus complexe dans la mesure où sont venues s’ajouter des séquences filmées par Marguerite Duras, incluant notamment la participation dansée de Carolyn Carlson, et où un principe de séparation du plateau en différents espaces a permis de représenter simultanément les différentes temporalités de l’histoire de Dora, ces temporalités étant indiquées dans les didascalies.
La pièce radiophonique s’ouvre avec la voix de Dora donnant, en guise de prologue, des « instructions pour faire le portrait de Dora ». Elle semble s’adresser à son analyste (« Vous m’appellerez Dora »), mais les pistes sont brouillées, l’interlocuteur pourrait tout aussi bien être Monsieur K. Elle annonce ensuite la présence de trois « joueurs » : se met donc en place un jeu comprenant « divers lieux, divers scènes », qui n’est pas sans rappeler le sordide « manège [18] » orchestré par les deux couples adultes. Après cette brève entrée en matière, on entend la voix de Freud prononcer la phrase suivante :
Ces événements s’annoncent, comme une ombre, dans les rêves, ils deviennent souvent si distincts qu’on croit les saisir d’une façon palpable, mais, malgré cela, ils échappent à un éclaircissement définitif, et si l’on procède sans habileté ni prudence particulière, on ne peut arriver à décider si une pareille scène a réellement eu lieu [19].
Or il s’agit ici des vrais mots de Freud : en effet, la phrase vient d’une note prélevée dans un autre texte célèbre de lui, tiré de Cinq psychanalyses, concernant non pas Dora mais un autre patient surnommé « l’Homme aux rats » qui était, lui, atteint d’une grave névrose obsessionnelle [20]. Dans ce passage, Freud tente de cerner les rapports entre événement, souvenirs et fantasme. Le fait d’introduire cet intertexte, fût-ce une note de bas de page, n’est pas innocent de la part de Cixous puisqu’à travers ces mots, Freud reconnaît ‒ ce qui est plutôt rare chez lui ‒ que certains événements évoqués au cours de la cure peuvent parfois « échappe[r] à un éclaircissement définitif ». Hélène Cixous fait donc dire à Freud, dès l’entrée de sa pièce, que les questions entourant Dora et sa maladie ne seront peut-être pas entièrement résolues. Freud reprend ensuite son discours [21] et évoque à ce moment-là la notion de transfert. En réalité, Cixous met ici dans la bouche de Freud un passage de la Postface à Fragment d’une analyse d’hystérie où le psychanalyste explique le concept-clé de transfert qu’il a élaboré justement durant la cure de Dora par le biais de la métaphore de l’édition d’un livre : les transferts sont, explique Freud, « des rééditions, des reproductions des motions et fantaisies appelées à être éveillées tandis que l’analyse avance s’accompagnant d’un remplacement – caractéristique de toute cette catégorie – d’une personne antérieure par la personne de l’analyste […] [22] ». Lorsqu’ils reproduisent à l’identique le prototype de lien, les transferts sont, insiste Freud, « de simples réimpressions, des rééditions non modifiées » ; d’autres, fabriqués avec plus d’art, constituent selon lui des « éditions revues et corrigées, et non plus de simples réimpressions [23] ». Encore une fois, ce n’est pas fortuit que ces mots de Freud, qu’il a lui-même écrits, soient prononcés ici : Cixous semble en effet pointer, dès les premières minutes de la fiction radiophonique, l’échec de Freud, à savoir l’analyse du transfert et du contre-transfert (pour aller vite). Il est reconnu en effet depuis assez longtems que l’échec de la cure de Dora s’explique par le fait que Freud, en raison de son contre-transfert, est revenu trop constamment sur l’amour que Monsieur K. pouvait inspirer à Dora, ce qui l’a empêché de voir la motion homosexuelle qui attirait Dora vers Madame K. et ce qui s’y jouait.
S’amorce alors un dialogue entre Freud et Dora : « Si vous osez m’embrasser, s’écrie la jeune fille, je vous donnerai une gifle ! » La scène du lac, au cours de laquelle Monsieur K. a tenté d’embrasser Dora qui le gifle et s’enfuit, semble ainsi se rejouer entre Dora et Freud. Évidemment, c’est Hélène Cixous qui imagine cette scène de séduction explicite entre Dora et son analyste, mais cette façon d’intégrer un élément du passé dans le temps de l’énonciation permet d’introduire un nouveau rapport de temporalité entre ce qui constitue le « présent », c’est-à-dire le moment de la cure, et le « passé ».
1.2. Une pièce composite permettant l’amplification d’une voix
La structure dramatique de la pièce ne relève pas des formes théâtrales habituelles (tragédie, drame, etc.). Fragmentée en plusieurs segments plus ou moins identifiables, elle est construite autour du dialogue entre Freud et Dora qui forme une sorte de récit-cadre et déploie, de manière intriquée et sans ordre chronologique apparent, les quatre grands moments de la cure que sont : le récit de la scène du lac (qui est une scène de séduction), le premier rêve, le second rêve et l’acting-out final de Dora interrompant l’analyse. Sa particularité, autrement dit, est de mêler les temps du passé et du présent, et donc de ne pas faire de hiérarchie entre les souvenirs et ce qui se rejoue dans la cure. Le « présent » correspond au dispositif analytique, c’est-à-dire au moment où Freud et Dora sont réunis ; il n’est d’ailleurs peut-être pas inutile de rappeler que le dispositif analytique, à l’instar de la radio, relève précisément d’une situation acousmatique telle que nous l’avons définie plus haut puisque l’analysant ne voit pas l’analyste qui pourtant lui parle – et surtout l’écoute. Ainsi, l’on pourrait voir dans Portrait de Dora une mise en abyme de la radio qui, en retour, se trouve dotée de vertus analytiques insoupçonnées du simple fait que le son est coupé de sa source. C’est cela aussi qui permet que les époques et les temps puissent se mêler. À cet égard, la pièce est construite, dans sa quasi-totalité, selon un agencement singulier où les événements du passé sont intégrés à l’énonciation plutôt que racontés comme des souvenirs : ainsi, par exemple, les discussions que Dora a eues avec Madame K. lorsqu’elle allait rendre visite au couple d’amis de ses parents, discussions que Dora rapporte à Freud dans le cadre de la cure, sont parlées par les personnages eux-mêmes, comme en témoigne ce passage, reproduit par ailleurs dans la version théâtrale de 1976 :
MADAME K
Vous savez que vous pouvez tout me dire et tout me demander. Il n’existe rien que je doive vous cacher.
Néanmoins, pour marquer la différence de temporalité entre la situation d’énonciation et les réminiscences de la jeune patiente, la voix du personnage est en retrait, dans une sorte d’arrière-plan sonore par rapport aux deux voix principales que sont celles de Dora et de Freud.
La deuxième particularité de la pièce est de donner accès aux voix intérieures de Dora, y compris lorsqu’elles semblent contradictoires, ce que le récit donné à lire par Freud à l’origine n’avait pas su faire. On entend en effet les pensées de la jeune femme, ses peurs, ses hésitations, l’expression de ses désirs, même quand ils semblent aller dans des directions opposées. Par exemple, si l’attachement pour le père ou encore l’attirance pour Monsieur K. peuvent se lire dans certaines répliques de Dora, le désir homosexuel pour Madame K., qui avait été laissé de côté chez Freud du fait de sa surdité à la « significativité du courant homosexuel [24] », émerge clairement dans la pièce de Cixous, comme on peut le lire dans cette scène d’affection quasi amoureuse entre Dora et Madame K :
DORA
Laissez-moi vous embrasser ! […]
DORA
Je suis plantée là ! Devant vous. J’attends. Si seulement ! si seulement vous vouliez me dire !
MADAME K
Mais je n’ai rien à dire
DORA
Tout ce que vous savez : Tout ce que je ne sais pas. Laissez-moi vous donner cet amour.
MADAME K
Oh ! Impossible, impossible, mon petit fou.
DORA
J’ai mal, j’ai toujours mal, mettez vos mains sur ma tête, tenez-moi.
MADAME K
Mon Dieu. Qu’est-ce que je vais faire de toi ?
DORA
Regardez-moi. Je voudrais entrer dans vos yeux. Je voudrais que vous fermiez les yeux.
C’est donc toute l’ambiguïté et la complexité de la figure de Dora que Cixous fait ressortir dans ce portrait.
Le jeu sur les différents plans sonores permet en outre d’accentuer les différentes versions de l’histoire. Ainsi, à l’arrière-plan, on entend parfois la voix du père de Dora se confiant à Freud et exposant ses hypothèses à propos du mal dont souffre sa fille, ou encore Monsieur K. s’adressant au père de Dora au téléphone pour nier les faits (« Je suis prêt à me rendre auprès de vous, pour éclaircir tous ces malentendus. Dora n’est qu’une enfant pour moi […] »). L’auditeur a donc directement accès aux pensées et aux émotions des différents personnages, sans le moyen du discours rapporté. On entend même les réflexions de Freud qui médite sur le cas, s’interroge, évalue les différents éléments de sa recherche qu’il mène telle une enquête. La pièce multiplie en quelque sorte les points de vue. Des connexions inattendues se produisent par l’agencement des scènes. Une dimension onirique s’installe, faisant se télescoper voire coïncider certains éléments du récit. La hiérarchie entre les souvenirs, les rêves et les pensées traversant l’esprit de la jeune femme semble abolie. On aboutit ainsi à une explosion du récit, rendue possible par le dispositif radiophonique des voix. Cette construction produit un « type de vision hétérogène [25] ». Prenant délibérément parti pour une forme expérimentale non-narrative et fragmentaire, Hélène Cixous fait éclater la représentation réaliste de la fable victorienne ou du drame bourgeois à l’intérieur duquel Dora est plongée bien malgré elle.
Hélène Cixous prend évidemment une certaine liberté vis-à-vis de l’histoire, et vis-à-vis de la figure même de Dora. Outre les deux rêves qui ont retenu l’attention de Freud dans la cure, elle lui prête notamment d’autres rêves, dont celui-ci qui constitue une véritable vision, proche des visions-illuminations dont l’auteure dit elle-même être envahie la nuit :
Il y a une porte dans Vienne par où tout le monde peut passer sauf moi. Souvent je rêve que j’arrive devant cette porte, elle s’ouvre, je pourrais entrer. Des jeunes hommes et des jeunes femmes s’y déversent, je pourrais me glisser parmi le flot, mais je ne le fais pas, cependant je ne puis m’éloigner à jamais de cette porte, je passe devant, je m’attarde mais je ne le fais pas, je n’y parviens pas, je suis pleine de mémoire et de désespoir, ce qui est étrange, c’est que je pourrais passer mais je suis retenue, je crains, je suis au-delà de toute crainte, mais je n’entre pas, si je n’entre pas je meurs, si j’entrais, si je voulais voir Monsieur K. mais si papa me voyait, mais je ne veux pas le voir, mais si papa me voyait le voir il me tuerait, je pourrais le voir une fois. Ce serait la dernière. Ensuite [26]
Ce rêve ou récit fantasmé possède une véritable qualité poétique. Le langage de Dora semble refléter la difficile position où elle se trouve, non seulement à l’intérieur du « quatuor amoureux », mais aussi dans cette ville mystérieuse qui fait l’objet de son rêve. Dans ce rêve, elle est la seule à ne pas pouvoir passer par cette « porte » qui la fascine, comme si l’accès à un ailleurs lui était empêché ou interdit. La syntaxe est incertaine, hachée, coupée, faite de parataxes qui miment la violence intérieure de Dora mais aussi son incertitude et son hésitation, comme en témoigne l’arrêt brutal de son discours. Ici, la langue même performe, met en acte toute la complexité, l’ambiguïté voire l’ambivalence du désir de Dora qui n’arrive pas à entrer dans cet ailleurs qu’elle désire tout en souffrant d’être incapable de le faire, qui ne sait pas si elle veut ou non voir Monsieur K. et qui pèse en même temps l’avis de son père. La porte apparaît comme le symbole même de cet impossible passage, de cette difficile traversée que constitue le passage de l’enfance à l’âge adulte. Plus encore, la porte représente ce lieu impossible que constitue la place de Dora : trahie et trompée par tous, en marge de tous ceux qu’elle aime et qu’elle continue d’aimer malgré ce qu’ils lui font subir.
Le bruitage de la pièce est assez sommaire : on entend parfois le bruit d’un train, des sons que l’on pourrait entendre dans une gare, le grésillement de la ligne téléphonique lorsque Monsieur K. appelle le père de Dora. Dans la deuxième partie de la pièce revient de manière répétitive un bruit semblable au mouvement de la trotteuse d’une horloge, qui représente probablement le temps de la cure, dont Dora trouve qu’elle s’éternise : « Cette cure dure trop longtemps. Encore combien de temps ?» Les silences de la cure sont ainsi fortement perceptibles : non seulement les silences réels ponctuant les séances et qui sont marqués par les voix de l’analysante – dont on sait que l’aphonie était l’un de ses symptômes – et de l’analyste, mais aussi ceux concernant l’histoire de Dora que l’analyse n’a pas su mettre au jour. Lorsque Dora décide finalement d’abandonner l’analyse, la pièce se termine sur un cri déchirant qui rompt avec la tonalité sobre du reste de la composition. L’auditeur reste en effet plongé plusieurs secondes dans la profondeur de ce cri proféré par la jeune fille qui exprime à la fois la douleur d’abandonner le travail analytique et celle d’être incomprise et abandonnée par ceux qu’elle aime.
Ainsi, l’environnement sonore minimaliste de cette création radiophonique met d’autant plus en évidence la pluralisation des points de vue, la superposition volontaire des souvenirs et des rêves et la non-hiérarchie entre ce qui relève de la fiction et de la vérité qui sont à l’œuvre dans ce portrait. La forme éclatée de la pièce rend compte, par ailleurs, de la difficulté pour Dora de se trouver une place ou même un refuge parmi les adultes. Mais l’auditeur ne peut rester insensible à ce cri de révolte qui passe par la résistance à l’autorité analytique représentée par Freud. Cixous offre dans sa pièce une vision alternative du cas Dora en montrant toutes les contradictions qui la traversent, manière en quelque sorte pour Dora d’acquérir une « voix amplifiée » [27] et de parvenir enfin à se faire entendre.
2. Ceci est un exercice de rêve : une radio à la rencontre des fantômes du passé
Réalisé par Lionel Quantin, Ceci est un exercice de rêve a été diffusé le 20 novembre 2005 dans le cadre de l’Atelier de création radiophonique. Accompagnée d’une musique originale de Jean-Jacques Lemêtre, cette pièce radiophonique composée par Hélène Cixous a une facture très originale. Il s’agit d’un collage de récits de rêve de quatre auteurs, à savoir William Shakespeare, Marcel Proust, Jacques Derrida et Hélène Cixous elle-même, entrecoupés de dialogues inspirés de ces textes et d’intermèdes musicaux allant d’une mélodie jouée au psaltérion à un air de fête foraine en passant par quelques accords entonnés par un chœur a cappella. La pièce propose une véritable constellation de voix, autant féminines que masculines, puisqu’il n’y a pas moins de onze locuteurs [28]. Ces voix parlent en français, en allemand, en anglais et en arabe. Récits de rêve et souvenirs des différents récitants de la pièce sont tissés ensemble.
La pièce est construite en cinq parties, chacune étant introduite par le bruit d’une sonnerie de téléphone ou d’une sonnette dont on comprend rapidement qu’elle est celle de la porte de l’appartement d’Hélène Cixous à Paris. Ce bruit constitue une sorte de scansion avant le moment onirique. Une dizaine de récits de rêve composent cette singulière création radiophonique. Il y a d’abord un rêve tiré de Sodome et Gomorrhe de Proust : il s’agit du moment où le narrateur de la Recherche rêve de sa grand-mère morte. Vient ensuite un rêve attribué par Shakespeare au personnage de Georges, duc de Clarence, dans sa tragédie historique Richard III ‒ pour rappel, le duc de Clarence est le frère rival de Richard, duc de Gloucester, tous deux souhaitant accéder au trône d’Angleterre. Le rêve qui suit est de Derrida, qu’il raconte dans son essai à caractère autobiographique Mémoires d’aveugle, où revient, précisons-le, le motif des yeux clos. Se succcèdent ensuite six récits de rêve tirés du recueil d’Hélène Cixous Rêve je te dis [29]. Tout l’ensemble est entrecoupé de bribes de rêves et de souvenirs d’Ève Cixous, la mère de l’écrivaine, qui constitue un personnage à part entière de la pièce radiophonique ; on entend à plusieurs reprises les deux femmes discuter, l’écrivaine interrogeant sa mère sur son enfance en Allemagne et sa vie de jeune épouse en Algérie.
On sait depuis la parution en 2003 de Rêve je te dis qu’Hélène Cixous note et archive ses rêves. Elle les note la nuit, dans le noir, précise-t-elle dans les Avertissements, avec un feutre « V-Sign pen » de la marque Pilot : « Docile je ne dis mot le rêve dicte j’obéis les yeux fermés [30]. » L’idée de dictée et de commande mentionnée en préambule apparaît de nouveau, de même que le leitmotiv des yeux fermés. Le titre du recueil a cette particularité qu’il fait entendre à la fois une invitation à rêver adressée au lecteur – le mot « rêve » serait dans ce cas un verbe à l’impératif – et une interpellation ou une apostrophe directe au rêve – dans ce deuxième cas, le mot rêve serait un substantif. Systématiquement datés, les quelques cent rêves compilés dans le recueil ont été notés sur une période de sept années, entre 1990 et 1997, et suivent parallèlement l’écriture des fictions de cette décennie, comme OR. les lettres de mon père [31], Osnabrück [32] ou encore Le jour où je n’étais pas là [33], qui marquent le tournant algérien dans l’œuvre de l’écrivaine. D’emblée, Cixous affirme qu’il s’agit d’un « livre de rêves sans interprétation [34] » ; autrement dit, il n’est pas question pour elle d’interpréter les rêves : « Je me suis tenue loin de l’analyse et de la littérature. Ces choses sont des récits primitifs. Des larves. J’aurais pu, les couvant, les porter à papillons. Alors ils n’eussent plus été des rêves [35]. »
Ce choix de mettre en voix des rêves dans le cadre d’une création radiophonique, que ce soit ceux de Cixous, de Proust ou de Derrida, est surprenant. On peut se demander en effet si un rêve est partageable de la même manière qu’une simple fiction. Qu’est-ce qui est transmissible dans un récit de rêve ? Quel est le rôle de la radio ? Le passage par la voix radiophonique en approfondit-il l’énigme ? Jean-François Lyotard soulignait cet aspect difficilement exprimable du rêve :
Chacun a l’expérience du rêve et sait de quoi l’on parle lorsqu’il s’agit de rêve. Mais que peut-il, que peut-on en dire, que peut-on en faire ? Voilà la question ; et voici le paradoxe : l’expérience du rêve est universelle, mais c’est l’expérience d’une singularité incommunicable, où les conditions de l’objectivité ne peuvent s’instaurer sans détruire aussitôt leur « objet » [36].
Que devient cet incommunicable dans une pièce radiophonique ? Dans Ceci est un exercice de rêve, c’est le tissage des différents rêves issus de la littérature (Proust, Shakespeare) mais aussi des autres rêves, avec les souvenirs d’Ève Cixous, avec la bande-son et avec les différents bruitages, qui fait littérature, qui fait écriture radiophonique.
2.1. La dimension spectrale du rêve
L’ensemble de la pièce radiophonique met en évidence deux aspects du rêve qui nous intéresseront dans les pages qui suivent, à savoir la communication avec les morts et la fin momentanée d’un exil pouvant se traduire par le retour sur les lieux que l’on a quittés. C’est donc avant tout la dimension spectrale du rêve que la radiophonie vient souligner à travers le singulier attelage construit par Hélène Cixous et Jean-Jacques Lemêtre. Cette dimension spectrale, l’écrivaine la nomme « la Revenance [37] ». Hélène Cixous est friande en effet des néologismes créés par dérivation lexicale avec le suffixe -ance – le mot « algériance [38] », qui revient comme un leitmotiv dans l’œuvre depuis 1997, en est l’exemple le plus récurrent –, et le mot revenance ici fait aussi entendre en sourdine la voyance rimbaldienne. Dans Rêve je te dis, Cixous nous dit pourquoi elle apprécie tant les rêves : c’est parce qu’ils rendent possibles, selon elle, les joies bouleversantes des retrouvailles avec les morts. On lit ainsi dans les Avertissements du recueil le passage repris en ouverture de la pièce radiophonique de France Culture, qui évoque si bien ces moments d’extase :
C’est par ici, par les couloirs magiques de la nuit que reviennent vivants les morts bien-aimés, c’est ici et sans l’impôt de sang versé à la douane. Ici la mort devient ce qu’elle est : une séparation seulement presque interminable, interrompue par des retrouvailles rares et brèves mais extatiques. Sans les rêves la mort serait mortelle – ou immortelle ? Mais elle est fendue, déjouée, refaite. De ses terres s’échappent les fantômes qui consolent les mortels que nous sommes [39].
Il est intéressant de noter que la citation a été légèrement modifiée dans la pièce radiophonique : il est question en effet « d’une séparation presque interminable, interrompue par des retrouvailles brèves et extatiques dans une rame de métro ou dans un train » ; la partition musicale de Lemêtre nous fait d’ailleurs entendre des bruits de métro et de train, comme pour nous plonger dans un univers banal, quotidien, et ainsi rendre encore plus concrète l’idée des retrouvailles fortuites, mais si précieuses, avec les morts.
Parmi ces morts croisés au détour d’un rêve, il y a bien sûr le père d’Hélène Cixous, mort lorsqu’elle n’avait que onze ans, qui est devenu un personnage central de son œuvre : plus qu’un thème ou qu’un motif, le deuil du père traverse quasiment tous les textes de l’écrivaine depuis le début de son écriture, où semble à l’œuvre une élaboration de la perte. La fantôme paternel est une figure familière chez Cixous. Dans Ceci est un exercice de rêve, c’est l’actrice Nicole Garcia qui lit le rêve intitulé « Papa » :
J’étais dans un coin de la grande salle d’attente. Là-bas, invisible papa recevait, il faisait des radios, sans arrêt. […] Mon père n’arrêtait pas de travailler. Jusqu’au moment où enfin il surgit du cabinet au fond à droite, en blouse. Je l’appelai, je lui parlai doucement mais fermement. Tu ne peux pas t’arrêter un peu ? Au moins entre midi et deux heures. Non, non, il ne pouvait pas, il y avait tellement à faire, je lui parlai gentiment, c’est que les choses étaient faites depuis si longtemps tu ne peux pas dis-je t’arrêter une heure ? Il faut vivre un peu. J’insistai. Je lui dis : c’est que je suis venue trop tard, et je n’ai pas pu t’apprendre à t’arrêter un instant ? […] Il m’écoutait en souriant. Un sourire doux et bon et sérieux. Arrête pour une fois, dis-je. Et viens, emmène-moi comme tu l’avais fait une fois tu te rappelles, quand j’étais petite, tu m’avais emmenée, c’était l’unique promenade où j’avais été seule avec lui, je la voyais là-bas dans les lointains dans la brume, comme un conte, comme un mythe, tu m’avais emmenée à, j’ai voulu dire le nom mais le nom était perdu, je le cherchais debout devant mon père en blouse blanche […] je ne trouvais pas, je m’efforçais, ce nom ce nom, c’est la clé […] Comme lorsque nous avions été à – soudain le nom revint comme un coup de couteau déchirer la brume, brutal, réel, vrai, ayant eu lieu. Je criai : au Cap Falcon. Je l’avais !! Je l’ai. Sous le coup les deux scènes se rejoignirent – celle de jadis où j’étais si petite et qui n’avait eu lieu qu’une fois et celle d’ici. Au Cap Falcon ! Et j’éclatai en sanglots, je pleurai tout je pleurai la vie qui n’avait pas été vécue, et mon père qui n’arrivait pas à s’arrêter entre midi et deux heures. Maintenant, viendras-tu ? Maintenant que tu es mort, vas-tu continuer encore à faire des radios toute la journée, comme si tu avais peur de ne pas finir la tâche avant de mourir ?
Samedi 15. 5. 96.
OR [40]
J’ai reproduit ici le rêve tel qu’il est transcrit dans Rêve je te dis car il est mis en voix avec très peu de modifications. Le titre noté sous la date indique qu’au moment où l’écrivaine a fait ce rêve, elle écrivait en même temps le livre OR. les lettres de mon père, dans lequel on retrouve ce même rêve, mais beaucoup plus développé, plus écrit, et intégré au reste de la fiction [41].
Dans la deuxième partie de la pièce radiophonique, le fantôme qui surgit est celui de la grand-mère de Proust. Celle-ci arrive par le biais d’un rêve tiré de la fin du premier chapitre de Sodome et Gomorrhe, « Les Intermittences du cœur », lu ici par Daniel Mesguich. Ce rêve raconte comment, lors d’un séjour à Balbec où il avait l’habitude d’aller, enfant, avec sa grand-mère, le narrateur de la Recherche rêve qu’il a oublié d’écrire à sa grand-mère ; il a le sentiment d’avoir perdu l’adresse de sa grand-mère, et se reproche de ne plus la trouver : « comment ai-je pu oublier l’adresse ? » Cela fait naître en lui le remords de l’avoir oubliée. Il ressent un désespoir profond car il réalise qu’elle est « perdue pour toujours ». Le rêve prend les traits d’une catabase : le passage s’ouvre en effet sur une longue réflexion à propos du « monde du sommeil » dont le narrateur dit qu’il est comme le reflet de « la douloureuse synthèse de la survivance et du néant » ; vient ensuite l’évocation des « flots noirs de notre propre sang comme sur un Léthé intérieur aux sextuples replis » ; et alors, poursuit-il, « de grandes figures solennelles nous apparaissent, nous abordent et nous quittent, nous laissant en larmes ». Pour douloureuses qu’elles soient, ces apparitions en rêve permettent néanmoins de raviver la mémoire. Ainsi, c’est grâce au rêve que la grand-mère du narrateur est sauvée de l’oubli. Après une autre évocation du « fleuve aux ténébreux méandres », le songe se termine sur une série de mots énigmatiques : « cerfs cerfs Francis Jammes fourchette ». Le narrateur se réveille et ne trouve pas de sens à ces mots. Il ne s’efforce pas pour autant d’en trouver un, car il comprend que le récit de rêve ne doit pas être interprété avec les outils de l’état de veille. Il ne s’agit pas d’interpréter le rêve, mais de lui donner un statut d’écriture.
Ainsi, la pièce radiophonique d’Hélène Cixous met en avant le rêve en tant qu’il devient écriture, qu’il devient littérature. En outre, la juxtaposition des rêves de Cixous et de Proust montre que la portée des textes dépasse le seul deuil privé (la mort du père ou la mort de la grand-mère). Dans son œuvre de manière générale, Cixous privilégie en effet la littérature dans son rapport aux morts, en réinvestissant notamment le motif de la descente aux Enfers, mais aussi d’autres motifs en lien avec « l’autre monde ». Dans Ceci est un exercice de rêve, la dimension fantomale et spectrale du rêve est encore plus accentuée du fait du dispositif radiophonique et son recours aux voix. Le rapport aux morts dans cette création radiophonique apparaît ainsi essentiel et évident.
La quatrième partie de la pièce fait entendre un rêve sur Oran, désignée « ville perdue » par l’écrivaine ; celle-ci en effet y est née en 1937 et y a habité les cinq premières années de sa vie avec sa famille, qui s’est ensuite installée à Alger. Ce rêve figure dans le recueil Rêve je te dis où il s’intitule « Un tel désir d’aller à Oran [42] ». Lu par Daniel Mesguich dans la création radiophonique, il s’y touve légèrement modifié et abrégé :
Je pris donc le train en me réjouissant à l’idée de revoir pour la première fois, de loin, même une minute, les couleurs de ma ville natale. Pour y aller il fallait passer dans la gare par les couloirs élevés, suspendus au-dessus des quais, et au milieu du couloir, redescendre par l’escalier. Nous arrivâmes sur le quai, chargées de lourdes valises. Nous prîmes le train. J’étais dans le compartiment avec Y., cet ancien étudiant thésard, un grand type assez beau au visage fermé. […] L’important c’était Oran que je désirais tellement. C’est dans le train que je découvris que entre l’aller et le retour se passait une heure et demie : ce serait un aller-retour. Ainsi, j’aurais donc le temps de plonger une heure dans ma ville natale ? Une grande émotion me saisit. Je me vis entrer dans le cœur de la ville, vers la Place d’Armes, je me vis parmi la matière colorée, parmi les quartiers épais [43].
La particularité de ce passage dans la création radiophonique est qu’il fait s’entremêler le rêve de l’écrivaine avec quelques souvenirs et bribes de rêves d’Ève Cixous, sa mère, à qui elle pose également des questions : « Tu me racontes ton dernier rêve ? […] Retrouves-tu Papa dans tes rêves ? » Au fil des réponses de la mère, qui parle alternativement français et allemand, une autre « ville perdue » est mentionnée : Osnabrück. Ville de naissance d’Ève Cixous qu’elle quitta au début des années 1930, Osnabrück représente le passé de la famille maternelle de l’écrivaine, de confession juive ashkénaze. L’allusion à l’Allemagne rappelle ainsi les souvenirs des tragédies historiques et en particulier le traumatisme de la Shoah puisqu’une grande partie de la famille Jonas (la famille maternelle d’Ève Cixous) fut anéantie par le nazisme. Ainsi, les villes perdues évoquent autant l’exil que le drame de l’extermination.
À cet égard, la troisième partie de la pièce radiophonique revêt, par l’agencement particulier des rêves qu’elle propose, une dimension politique forte. Après la lecture successive par Pierre Cixous et Daniel Mesguich du rêve du « duel de[s] aveugles aux prises l’un avec l’autre » de Derrida [44] qui soulève la question de la rivalité entre père et fils mais aussi celle de l’héritage, suivent deux rêves d’Hélène Cixous. Le premier, porté par la voix de Nicole Garcia, raconte une véritable scène de guerre : « Justement cette nuit voilà ce qui s’est passé. C’était une nuit tragique de toute façon, plongés que nous étions dans un pays nazi. Le monde violent, cruel [45]. » La narratrice voit les parties du corps d’un homme blessé et affamé. Un autre homme arrive, il s’agit peut-être du prétendant de sa fille, Anne :
Soudain un cri affreux. Affreux. Dans la nuit. Un cri d’angoisse et de douleur inouïe. La hache ! La hache ! [échos] Je vois dans la nuit, l’homme allongé avec une hache plantée dans la poitrine et qui crie, qui crie qui crie ! La hache ! Je vais mourir ! Ils lui ont planté une hache ! Sans doute les nazis. Que faire ? […] De toutes parts rôde le danger [46].
La lecture s’interrompt. Après quelques mots prononcés par Ève Cixous, on entend les notes d’une musique légère telle une mélodie de cirque. Puis tout à coup ce sont des bruits d’avion, un signal électrique et enfin des bruits que l’on pourrait entendre lors d’un bombardement. Or dans le rêve suivant, lu de nouveau par Nicole Garcia, il est justement question d’un bombardement. Dans Rêve je te dis, il est intitulé « Bombardées [47] ». J’en donne ici une version écourtée :
Et aussitôt éclata au-dessus de la ville le grondement d’un tonnerre d’une largeur et d’une durée inouïes. Les camions du ciel, pensais-je. Le bruit roulait, roula, enfla, occupa l’air entier. Alors, du bruit sortit un avion. […] Bombardées dis-je. Un bombardement dis-je. […] C’est une répétition de la guerre. […] Nous fûmes emportées dans le lourd hurlement de l’avion. C’était arrivé. La chose [48].
Ce fragment de rêve, qui apparaît également dans Le jour où je n’étais pas là, rappelle la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale. La phrase « C’est une répétition de la guerre » est reprise par un autre lecteur, Daniel Mesguich ; on entend alors plusieurs voix dire en écho, de manière théâtrale, la phrase qui a donné son titre à la pièce radiophonique : « Ceci est un exercice. » Le passage se clôt sur un battement de tambour puis, après un bref silence, le bruit du ressac qui vient apaiser la situation. L’articulation des deux rêves, qui n’étaient pas liés à l’origine, s’est faite grâce aux bruitages radiophoniques, autrement dit par liaison sonore. C’est donc le dispositif radiophonique qui a permis de mettre en rapport ces rêves où la mémoire de tout un continent est ravivée.
2.2. Vers une démultiplication des sens
Le dernier rêve que je voudrais évoquer est un rêve de transport amoureux. Il est lu, dans la deuxième partie de la pièce, successivement par deux voix différentes, Nicole Garcia puis Jacques Derrida. Le philosophe a en effet commenté ce rêve lors de la conférence qu’il a prononcée à l’ouverture du colloque organisé autour de l’œuvre de Cixous à la BnF en 2003 et ce moment fut enregistré ; on retrouve ce même passage dans l’ouvrage qui en a été tiré, qui s’intitule Genèses, généalogies, genres et le génie [49]. Voici le rêve, qui est légèrement modifié par rapport à la version du recueil Rêve je te dis :
Dans cette foire immense comme une ville d’un jour, tout nous sépare et tout nous réunit. Le miracle, ou la chance gagnée, c’est que nous arrivons à nous retrouver et à jeter les mots de feu malgré tout. C’est ainsi que le soir tard, après les journées folles de monde, j’ai pu te rejoindre dans ta chambre, malgré la présence dans les lieux d’Al. et les siens. […] Aussi tard le soir, je m’élance à travers les chambres luxueuses immenses et vides de cet hôtel infini, et courant par les salons déserts, ailée, je traverse les espaces jusqu’à ta chambre. Ce qui nous sépare c’est seulement le jour les obligations le monde les obstacles. C’est ainsi que dans l’immense foule de l’exposition, emportée par la fièvre de l’amour je me retrouve auprès de toi dans un wagon de métro bondé que je n’aurais pas dû prendre, mais je n’ai pas pu te quitter. La rame traverse à grande vitesse des distances énormes […] À l’arrêt, soudain, ta voix serrée à moi, comme si c’était la mienne, crie sans un son, dans mon être je t’adore je t’adore je t’adore. Dans le bruit des machines et du monde les mots sont hurlés doucement, un peu inquiets, c’est le cadeau de Dieu et tandis que les portes automatiques me poussent dehors je crie moi aussi parce que je ne peux prononcer autre chose. Alors pleine de ce feu et de hâte, me voilà qui rebrousse chemin vers ma chambre où je dois me préparer pour l’inauguration afin de te retrouver publiquement un peu plus tard. […] le temps passe – arriverai-je à temps dans ma chambre pour me changer […] Enfin voilà l’étage, la chambre. Mais les événements ont transformé le paysage. La chambre est à nu, pas de plafond, elle est dans une cuvette. Tout autour sur les hauteurs des passants et voyeurs. Je suis vue, et de haut. Comment me changer ? Alors tant pis. Faisant comme si j’étais chez moi je commence à me déshabiller. J’enlève mon slip. Je garde un petit tee-shir noir – assez long – je vais vite m’habiller et avec élégance. Rien ne m’aura été épargné. Mais quand même la nuit j’ai pu te rejoindre. Et tes mots ardents sont dans ma vie, je t’adore je t’adore jeta jet’ [50]
À travers la voix de Nicole Garcia, le rêve se lit comme une véritable déclaration amoureuse. Une musique instrumentale l’accompagne en fond ; le rythme s’accélère au moment de la course dans le métro, mimant ainsi la fièvre de la passion. Commenté en partie ensuite par Jacques Derrida, le rêve résonne autrement. La prononciation très articulée du philosophe lui confère une autre qualité onirique, plus réfléchie et moins intérieure. Porté par ces deux voix, par ces différents timbres, le rêve se trouve en quelque sorte désapproprié de celle qui l’a rêvée. L’ « incommunicable du rêve » souligné par Lyotard passe ainsi par les vibrations des deux voix, féminine et masculine. Il apparaît donc possible de dire que la radio, c’est-à-dire le passage par les voix, d’une part déprivatise le rêve et d’autre part le pluralise en lui donnant une résonance proprement littéraire. Cette séquence se termine de manière très originale puisque les derniers mots du rêve prononcés par Derrida (« Je t’adore, je t’ador, jet’ ») sont repris en sample et fusionnés à un rythme de rap, à quoi vient s’ajouter une voix opératique. Ce mélange, qui associe la voix d’un des plus grands philosophes français du XXe siècle à une musique rap, est étonnant. Ici le rêve se fait le support d’une expérimentation interartistique donnant lieu à la création d’un objet hybride et tout à fait inédit. En définitive, cette dimension expérimentale apparaît centrale dans la pièce radiophonique de Cixous qui se donne, ne l’oublions pas, comme un « exercice de rêve » : il s’agit donc d’une expérimentation, d’une création en train de se faire.
La pièce radiophonique se clôt sur la réitération du pouvoir mémoriel du rêve à travers la voix d’Hélène Cixous elle-même : « Si je ne rêvais pas, je tomberais en poussière. Si je ne te rêvais pas, tu tomberais en poussière. » Le rêve vient en effet sauver de l’oubli le rêvé autant que la rêveuse. Les derniers mots de l’auteure proposent une réflexion sur l’inséparabilité de l’être avec l’autre, mais font surgir en même temps, par différents jeux de signifiant, une multiplicité de sens :
C’est ici que les aveugles luttent en s’embrassant. Tu es moi, tu es mon frère. Ne tuez pas mon frère […] Sommes-nous dehors ? Sommes-nous dedans ? […] Chut, rêve, tais-toi maintenant. Je t’ai eu. T-U, tu. Tu es un tu. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que « tu » veux dire. Tu, t-u. Surtout ne te réveille pas. Reste là, très cher rêve [51].
Les aveugles désignent ceux qui ont les yeux fermés, c’est-à-dire ceux qui, parce qu’ils ne voient pas, parviennent à entendre l’homophonie propre au langage (tu es/ tuez ; tu/ tu), homophonie que le dispositif radiophonique ne peut qu’accentuer. Ainsi, la fin de la pièce fait encore une fois la démontrastion des nombreux effets de démultiplication qui sont rendus possibles par la radio.
*
Coda
« […] Je ne me demande jamais “qui suis-je ?”, je me demande “qui sont-je ? ” – phrase intraduisible. Qui peut dire qui je sont, combien d’êtres je sont, quel je est le plus propre de mes je ? […] [52] » C’est ce qu’Hélène Cixous écrivait dans la préface d’une anthologie en anglais à elle consacrée il y a plus d’une vingtaine d’années. Bien sûr, l’homophonie de l’expression “qui sont-je ? ” ne lui a pas échappé : « notre oreille française entend, quand je prononce ma question, la phrase “qui songe ? ” c’est-à-dire qui rêve. Qui sont-je quand je songe ? Qui rêve quand je rêve ? [53] » On le voit, pluralité de l’être et rêve chez Cixous sont toujours liés. Car cette non-unité du je, cette énonciation plurielle, ce sont d’abord les rêves qui nous l’enseignent. Ce que les rêves nous disent, c’est que nous sommes des « être[s] composé[s] »[54], nous avons une vie au moins double, un monde toujours multiple.
Notes
[1] Hélène Cixous, Le Détrônement de la mort. Journal du Chapitre Los, Paris, Galilée, 2014, « Lignes fictives », p. 25.
[2] Hélène Cixous, « Ceci est un exercice de rêve », Atelier de création radiophonique, série « Le “je” radiophonique », France Culture, 20 novembre 2005, résumé en ligne sur le site de France Culture.
[3] Hélène Cixous, « Entretien autour de Stendhal », propos recueillis par Catherine Mariette, Orages. Littérature et culture 1760-1830, Florence Lotterie et Pierre Frantz (éd.), n° 12, mars 2013, p. 292.
[4] Ibid.
[5] Hélène Cixous, « Ceci est un exercice de rêve », op. cit.
[6] Gérard de Nerval, Aurélia, préface de Gérard Macé, édition établie et annotée par Jean-Marie Illouz, Paris, Garnier, « Folio Classique», 2005, p. 123 (souligné par l’auteur).
[7] Hélène Cixous, « Ceci est un exercice de rêve », op. cit.
[8] Hélène Cixous, « Entretien autour de Stendhal », op. cit., p. 292.
[9] Gérard de Nerval, Aurélia, op. cit., p. 123.
[10] Michel Chion, « Glossaire acoulogique », article « Acousmatique », Lampe-tempête [revue en ligne], n° 2, 2007 (souligé par l’auteur).
[11] Hélène Cixous, « Ceci est un exercice de rêve », op. cit. (je souligne).
[12] Hélène Cixous, Portrait de Dora. D’après « Le cas Dora » de Freud, en deux parties, Atelier de création radiophonique, réalisation Jean-Jacques Vierne, 22 mai 1973. Avec les voix de Douchka, Jean-Marc Bory, Ginette Franck, Lucien Frégis, Catherine Laborde, Jacques Mauclair et Monique Mélinand.
[13] Sigmund Freud, Dora. Fragment d’une analyse d’hystérie, trad. Françoise Kahn et François Robert, Paris, PUF, « Quadrige », 2006.
[14] Ibid., p. 54.
[15] Ibid., p. 103-104.
[16] Hélène Cixous, Portrait du soleil, Paris, Denoël, « Les Lettres Nouvelles », 1973.
[17] Hélène Cixous, Portrait de Dora, Paris, Des femmes, 1976.
[18] Hélène Cixous, Entretien télévisuel à l’occasion de la mise en scène au Théâtre d’Orsay, Émission Péplum, 6 mars 1976, Archives Ina, disponible en ligne.
[19] Repris à l’identique dans Hélène Cixous, Portrait de Dora, Paris, Des femmes, 1976, p. 9.
[20] Sigmund Freud, « Remarques sur un cas de névrose obsessionnelle. L’Homme aux rats » (1909), Cinq psychanalyses, trad. Marie Bonaparte et R. Loewenstein, Paris, PUF, 1954, p. 233, note.
[21] Ce passage ne sera pas repris dans la version théâtrale de 1976.
[22] Sigmund Freud, « Postface », Dora, op. cit, p.113.
[23] Ibid.
[24] Voir la note de la Postface : « Plus je m’éloigne dans le temps du terme de cette analyse, plus il devient vraisemblable à mes yeux que ma faute technique a consisté à omettre ce qui suit : Je n’ai pas su deviner à temps ni communiquer à la malade que la motion d’amour homosexuelle (gynécophile) pour Mme K. était le plus fort des courants inconscients de sa vie d’âme » (Sigmund Freud, Dora, op. cit., p. 117, note 1).
[25] Jeannelle Laillou Savona, « Portrait de Dora d’Hélène Cixous. À la recherche d’un théâtre féministe », dans Hélène Cixous. Chemins d’une écriture, Françoise van Rossum-Guyon et Myriam Diaz-Diocaretz (dir.), Amsterdam, Rodopi, 1990, p. 163 (je souligne).
[26] Repris dans Portrait de Dora, op. cit., p. 14.
[27] V. Mairéad Hanrahan, « Cixous’s Portrait of Dora : The Play of Whose Voice ? », The Modern Language Review, vol. 93, n°1, 1998, p. 58.
[28] Avec les voix d’Ève Cixous, Hélène Cixous, Pierre Cixous, Anne Berger, Saranya, Jacques Derrida, Nicole Garcia, Daniel Mesguich, Luce Mouchel, Nicolas Royle et Jean-Jacques Lemêtre.
[29] Hélène Cixous, Rêve je te dis, Paris, Galilée, « Lignes fictives », 2003.
[30] Ibid., p. 11 (les italiques sont de l’auteure).
[31] Hélène Cixous, OR. les lettres de mon père, Paris, Des femmes, 1997.
[32] Hélène Cixous, Osnabrück, Paris, Des femmes, 1999.
[33] Hélène Cixous, Le jour où je n’étais pas là, Paris, Galilée, « Lignes fictives », 2000.
[34] Hélène Cixous, Rêve je te dis , op. cit., p. 17 (les italiques sont de l’auteure).
[35] Ibid., p. 19 (les italiques sont de l’auteure).
[36] Jean-François Lyotard, « Rêve », Encyclopædia Universalis, vol. 14, 1974 (je souligne).
[37] Hélène Cixous, Rêve je te dis , op. cit., p. 16.
[38] Hélène Cixous, « Mon algériance », Les Inrockuptibles, n° 115, 20 août-2 septembre 1997, p. 7.
[39] Ibid., p. 16-17 (les italiques sont de l’auteure).
[40] Ibid., p. 78-80.
[41] Hélène Cixous, OR, op. cit., p. 56-60.
[42] Hélène Cixous, Rêve je te dis, op. cit., p. 58-59.
[43] Hélène Cixous, « Ceci est un exercice de rêve », op. cit.
[44] Jacques Derrida, Mémoires d’aveugle. L’autoportrait et autres ruines, Paris, Réunion des Musées nationaux, 1991, p. 23.
[45] Hélène Cixous, « Ceci est un exercice de rêve », op. cit. Voir Rêve je te dis, op. cit., p. 72-74.
[46] Ibid.
[47] Hélène Cixous, Rêve je te dis, op. cit., p. 98-99.
[48] Hélène Cixous, « Ceci est un exercice de rêve », op. cit.
[49] Jacques Derrida, Genèses, généalogies, genres et le génie. Les secrets de l’archive, Paris, Galilée, 2003.
[50] Hélène Cixous, « Ceci est un exercice de rêve », op. cit.
[51] Hélène Cixous, « Ceci est un exercice de rêve », op. cit.
[52] Hélène Cixous, “Preface”, The Portable Cixous, Susan Sellers (éd.), Londres /New York, Routledge, 1994, p. xviii (ma traduction).
[53] Ibid. ( je souligne).
[54] Hélène Cixous, « Entretien autour de Stendhal », op. cit., p. 292.
Auteur
Sarah-Anaïs Crevier Goulet est professeure certifiée de lettres modernes et docteure en Littérature française, membre associée de l’UMR 7172 THALIM. Sa recherche s’inscrit au croisement des études littéraires, des études de genre et de la psychanalyse. Sa thèse, qui portait sur l’œuvre d’Hélène Cixous, est parue en 2015 aux Éditions Honoré Champion sous le titre Entre le texte et le corps : deuil et différence sexuelle chez Hélène Cixous. Elle a publié divers articles en revue et co-dirigé plusieurs ouvrages collectifs (avec M. Balcazar, Pensées du corps. La matérialité et l’organique vus par les sciences humaines, PSN, 2011 ; avec A. Frantz et M. Calle-Gruber, Fictions des genres, EUD, 2013 ; avec M. Calle-Gruber, Écritures migrantes du genre (II). Langues, arts, inter-sectionnalité, PSN, 2017 ; avec M. Calle-Gruber, A. Oberhuber et M. Penalver Vicea, Les folles littéraires, des folies lucides. Les états borderline du genre et ses créations, Nota Bene, 2019).
Copyright
Tous droits réservés.