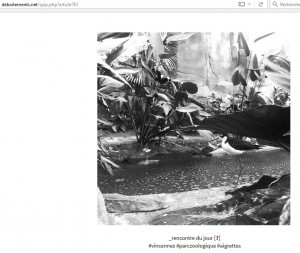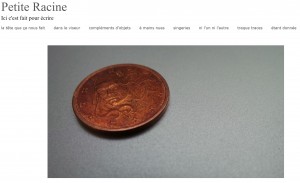L’instant j1var0
La littérature nativement numérique, écrite sur les blogs, sites et réseaux sociaux, accorde une part privilégiée à l’instant. Par là, ce pan de la création contemporaine à la fois rejoint l’ensemble de la littérature du XXIe siècle, et crée sa spécificité. Temps adapté à l’expression du fragment, l’instant du satori, rejoint ailleurs le kaïros, ce moment propice ou occasion, où se révèle sa réelle complexité temporelle. Rencontre d’éléments disparates, l’instant créateur ouvre le Web à une écriture renouvelée du haïku et de l’essai
The digital native literature, written on blogs, sites and social networks, gives a privileged part to the instant. In this way, this part of contemporary creation simultaneously joins all the literature of the 21st century, and also creates its specificity. Time adapted to the expression of the fragment, the instant of the satori, joins the kaïros, this propitious moment or opportunity, reveals its real temporal complexity. Encountering disparate elements, the creative instant opens the Web to a renewed writing of haiku and essay.
1. L’instant contemporain
La culture numérique, profuse dans son extraordinaire diversité, naît paradoxalement d’une pratique jivaro : tout contenu, texte, image, son, parce qu’il peut se réduire à une suite de 0 et de 1, va entrer dans un réseau où partage et transfert constituent les deux actions principales dont il sera l’objet. De là deux spécificités techniques de ces contenus, également formulables en termes d’exigences implicites chez les usagers : disponibilité et accessibilité. Dans l’instant qui suit ma requête sur un moteur de recherche, voilà qu’afflue une masse de données, qu’il s’agisse de bibliothèques musicales, ou de la BnF, dont la totalité des ouvrages, somme inimaginable de connaissances, se niche dans quelques misérables Téraoctets. La réduction des productions humaines en données par le numérique, au prix d’une désémantisation [1], a pour conséquence de consacrer l’instant comme la temporalité « naturelle » de l’accès à ces données compressées.
Quand l’informatique, depuis qu’Apple décida de hisser un voile opaque entre l’utilisateur et l’intérieur de la machine, aux programmes secrets, ressortissait au XXe siècle, qui fut celui de son avènement, à la lenteur et à la complexité, constatons, avec Milad Doueihi, que le numérique du siècle suivant autorise, au cœur même de nos expériences quotidiennes, « des accès souples et multiples » [2]. Plus qu’une pratique documentaire, la consultation semble devenue un rapport intime aux données comme au réel.
Notre temps, écrit ainsi Raffaele Simone, est interrompu sans arrêt par le besoin compulsif de contrôler les médias que nous portons sur nous, de consulter notre portable, de photographier, de chercher des sites sur des cartes et des informations. Toutes ces pratiques bouleversent l’expérience du temps continu et sans cassure, car elles transforment le temps en séquences d’interruptions et de moments fragmentés. [3]
Nos pratiques numériques franchissent constamment seuils et frontières : du réel au virtuel, et retour. Ouvrir un onglet, une fenêtre, sélectionner du doigt un message reçu, cliquer sur l’icône d’un navigateur, activer l’un de ces « signes passeurs » : autant de gestes marqueurs de notre contemporanéité, autant de promesses d’une interaction immédiate avec le dispositif technologique. N’envisager le Web qu’en termes de big data, constituer des stocks de données pour les proposer à quelque moulinette encodée, fût-ce à destination de nos sciences humaines, ne conduit-il pas parfois à perdre de vue la qualité de l’expérience ici en jeu ? Le dossier Web Satori, consacré aux productions littéraires nativement numériques, souhaite, lui, se saisir de cet instant de l’apparition du phénoménal numérique, en examinant ses versants multiples, à commencer par ceux de la réception-consultation et de la création-publication. C’est bien plutôt d’une dynamique d’hybridation, d’ailleurs, qu’il s’agira, derrière cette symétrie trompeuse, l’écrilecteur tendant à brouiller, on le sait, les catégorisations habituelles.
En questionnant la littérature telle qu’elle s’écrit et se lit dans et par le numérique par le prisme de l’instant, nous voudrions aussi éroder les représentations hâtives d’une « révolution » numérique, dont la rupture serait le seul mode d’être. Si les innovations caractérisent les textes étudiés ici, elles ne prennent sens que dans une historicité qu’il nous appartient de rappeler. Loin d’une hypothétique table rase, paradigme anachronique d’ailleurs, présentée avec trop d’insistance par bien des lectures médiatiques de « l’ère numérique », la littérature qui s’écrit sur sites, blogs et réseaux sociaux, revisite bien des formes et des gestes que notre modernité avait repérés comme constitutifs du littéraire. Si elle vient les interpréter de nouveau, optant pour la variation et le retravail, c’est également en raison de son dialogue constant avec l’ensemble de la littérature contemporaine. Qui souhaiterait s’en prendre à la ghettoïsation de la littérature numérique, encore considérée par certains comme une sous-pratique de geeks lettrés ou d’ingénieurs sur le retour, n’aurait qu’à noter la commune origine des écritures actuelles, qu’elles s’inscrivent sur papier ou dans le Web. Le réseau accueille en effet une production constamment mobile, différente à chacun de mes consultations, et ouverte sur un rhizome infini de ressources. D’un tel espace décentré, le sujet contemporain est l’hôte par excellence, comme il l’est des écritures contemporaines en général : « Moi je ne sais pas. Il y aurait un centre ? » s’interroge ainsi Spencer, le personnage tout mouvement, dont Arno Bertina fait le narrateur de son gros roman – presque 500 pages – Je suis une aventure [4], ouvert ici presque au hasard parmi tant d’autres. Un tel refus d’assignation identitaire du sujet contemporain convie à n’en pas douter à des expériences parallèles voire sécantes, en ligne et en librairie, sur le papier et sur la Toile. La littérature numérique ne saurait donc se voiler l’hapax : c’est avec un monde en bascule qu’elle interagit, tout comme le font les propositions les plus aventureuses des éditeurs traditionnels. C’est même bien parce qu’il lui incombe, à elle aussi, et avec des moyens technologiques qui l’y prédisposent probablement, de tenter de se saisir de l’instabilité contemporaine et des mutations en cours, sociales, politiques et culturelles, qu’elle s’impose comme pratique et partage. Puisque penser notre environnement dans les seuls termes de la continuité héritée du positivisme du XIXe siècle ne paraît plus guère possible, la discontinuité et la délinéarisation du récit, et par conséquent des identités narratives afférentes, que produit chaque jour la littérature Web, paraît tout particulièrement apte à enregistrer et moduler les ondes de choc de nos vies, volontiers fragmentées en posts et tweets.
Aussi l’instant peut-il à bon droit se prétendre le « chronotype » [5] de la littérature numérique.
2. L’instant & le fragment
Le Web archive du discret. Sites et blogs littéraires n’échappent pas à la règle, qui déportent le modèle classique de l’œuvre vers un paradigme neuf, où la liste et l’anthologie tendent à supplanter la continuité causaliste du récit. Dès lors, ma lecture n’en pourra être que préhensive, extraction répétée de fragments, comme autant de bornes dans mon parcours exploratoire. Quand face à de telles accumulations de contenus, constitutives de sites-bases de données, l’internaute bénévole se sent quelque peu désemparé, force lui est d’inscrire son geste de lecteur en rupture avec une telle tendance cumulative. Ce faisant, il redonne au fragment initial – billet, post – son statut premier, que l’inscription dans une collection aux contours flous érodait. C’est d’ailleurs dans notre contexte de surabondance et d’infobésité numérique, où le flux charrie constamment un nombre incalculable d’informations, que l’instant s’affirme comme résistance. Face au mouvement général de coagulation des données, destiné à organiser la traçabilité de ces informations comme de nos activités en ligne, sont apparus en effet des gestes censés trouer la Toile conçue comme nasse. Bien des auteurs et artistes numériques, à l’image d’Alexandra Saemmer, par exemple, inscrivent ostensiblement leur travail dans une obsolescence qui constitue l’une des qualités propres de l’œuvre. Puisque supports, logiciels, navigateurs, évoluent et menacent la pérennité des programmes, autant adopter cette instabilité pour doter l’œuvre d’une intensité neuve. De nombreuses applications récentes viennent confirmer l’esthétique de l’instant comme l’une des modalités centrales de la communication numérique : que l’on songe à Snapchat, ou à Instagram Stories.
L’intime semble trouver là ses espaces de publication privilégiés, prolongements naturels d’une écriture de soi en ligne revisitant, par le blog principalement jusque-là, la discontinuité définitoire du journal personnel. Aux biographèmes barthésiens, déjà imaginés d’ailleurs comme éléments d’une navigation – « quelques détails, […] quelques goûts, […] quelques inflexions, disons : des “biographèmes”, dont la distinction et la mobilité pourraient voyager hors de tout destin et venir toucher, à la façon des atomes épicuriens, quelque corps futur, promis à la même dispersion » [6] – correspondent ce que nous pourrions nommer des blographèmes, éclats de soi qu’il appartient au lecteur de parcourir, voire de relier. Le poète luxembourgeois Lambert Schlechter livre ainsi, à longueur de posts, une « liasse de dix mille fragments » appelée à constituer son œuvre autobiographique en ligne.
Sans doute l’écriture du blog suscite-t-elle un rapport propre à son contenu comme à ses lecteurs. Pour qu’un tel journal à ciel ouvert fidélise ses lecteurs, la mise à jour doit en être très régulière, et mise en valeur comme attention accordée, parfois avec une frénésie certaine, à la capture de l’instant présent, voire à une scénographie de ce dernier. La présentation antéchronologique des posts, caractéristiques du blog, conduirait ainsi, selon Fanny Georges, à une « survalorisation de l’instant présent » dont les causes résideraient dans la nécessité pour l’utilisateur de ces plateformes de « nourrir continuellement la structure identitaire qui le manifeste pour exister dans sa communauté », car, poursuit-elle, « le Web 2.0 compromet le développement d’un Soi consistant et autonome pour le livrer à la précarité de l’urgence immédiate [7]. » Le constat peut s’élargir à l’ensemble des réseaux sociaux, et finalement à tous les modes de publication en ligne. C’est donc également une forme d’hystérisation de soi qui contribue à ériger l’instant en temporalité privilégiée de l’écriture personnelle sur le Web vécue sur le mode de l’urgence.
3. L’instant & l’occasion
Doc. 1 ‒ Jean-Yves Fick, « Ce qui demeure », D’ici là, no7, Pierre Ménard (dir.), Publie.net, 2011.
Sur la labilité du temps, de l’ombre qui couvre peu à peu la lumière, sur la labilité du flux qui affole le Web à chaque seconde, Jean-Yves Fick inscrit un poème. Bref, qui dit justement la saisie impossible de l’instant conçu ici très classiquement comme intervalle, mais qui vient, par son geste même, non pas vainement tenter de retenir d’aucune façon ce qui toujours fera défaut, mais évider bien plutôt le texte de cette nécessité même. « Ce qui demeure », selon Fick qui intitule ainsi sa contribution à la revue de création en ligne D’ici là [8], sera « ce qu’il a vu de l’instant », soit « ce qui ne peut se dire du moment un point suspendu ». L’instant Web contient et libère à la fois une poétique de l’empêchement qui se sait incapable de tout bon débarras, et s’écrit précisément dans ce creux d’un indicible et d’un infigurable. La profusion même, qui nourrit un site comme celui de Jean-Yves Fick, témoigne de cette relance incessante du poème face à l’instant.
Christophe Sanchez, qui publie simultanément des clichés d’aube sur Instagram, et le même cliché accompagné d’un poème, sur son blog, propose également une telle écriture de l’instant numérique, tout particulièrement sensible – photo-sensible – aux moments d’entre-deux. La rubrique « Morning à la fenêtre » y reprend le motif crépusculaire, si populaire sur FlickR ou Instagram, dans un cadre proche du journal personnel, pour apercevoir « l’instant dans l’eau obscure d’un tourment [9] », et par-là capter « tout ce qui est “entre” et peut échapper à la présence du présent » – un éphémère qui « capte du temps dans les flux imperceptibles et les intervalles des choses, des êtres et de l’existant [10] ».
Si le seuil et l’intervalle mobilisent tant, c’est comme expérience paradoxale d’un écart – entre chien et loup – plein. L’instant que texte et image, puisque ce compagnonnage domine, s’emploient à dire, résonne en effet d’une pluralité de temporalités qui l’irise. Davantage qu’un point fugace insaisissable sur la ligne du temps, l’instant s’offre comme entrelacs d’expériences. Remontons… à Stendhal, qui face à l’exceptionnelle richesse d’instants revécus par sa mémoire dans leur éclat d’épiphanies, expérimente, dans sa Vie de Henry Brulard, la nécessité d’une saisie polysémiotique. Face à la gageure d’une transcription, dans la successivité de la phrase, de la synchronie définitoire de l’instant, il fut contraint de recourir au dessin, à l’image comme dispositif synoptique : « le glissement d’une sémiotique verbale à une sémiotique de l’image », commente Jean-Marie Seillan, « consacre l’incapacité, au moins relative, de l’écriture littéraire à saisir et à restituer la pluralité des sensations qui coexistent dans l’instant heureux [11] ».
L’instant, haussé au rang de révélation épiphanique, se fait ici occasion, « instant qui est pour nous une chance », écrit Jankélévitch dans Le Je-ne-sais-quoi et le presque-rien. Or, l’occasion, propice, est une « coïncidence ponctuelle » de plusieurs temporalités, celle du sujet et celle de l’événement qui surgit, l’intersection de lignes temporelles, l’instant de synchronisation miraculeuse de plusieurs rythmes, comme une polyrythmie heureuse :
L’occasion est une chance, et une chance inédite, inouïe, inespérée, par la réunion exceptionnelle de facteurs ou de conditions qui demeurent en général disjoints. L’occasion est l’alternative surmontée […], la conjonction critique succède à la disjonction chronique, le cumul au sporadisme ! […] C’est donc le “simul” de la simultanéité qui est le miracle [12].
Par l’alliance du texte et de l’image, les poèmes en ligne de Jean-Yves Fick cherchent l’occasion, proche du Kaïros de l’instant grec. Si la photographie jouit déjà, en elle-même, d’une complexité temporelle, « nouement » qui « se saisit en une seule fois de plusieurs temporalités [13] », comment le texte peut-il jouer sa propre carte ? Probablement par la domestication du verbal :
- amuï au profit de syntagmes nominaux, libres de flotter sans attache temporelle fixe, d’autant qu’ils se juxtaposent et proposent le plus souvent un parcours paratactique,
- ou délivré de telles amarres, par le choix massif d’un présent de l’indicatif d’aspect sécant, élu pour ses emplois dits « omnitemporels », qui font de ce tiroir verbal l’équivalent grammatical du flou photographique, capable de rendre simultanés pour l’œil les mouvements pourtant successifs d’un objet.
Négociant sans cesse avec les flux, tramé d’une diversité de temporalités et de rythmes, l’instant Web, en quête de formes adéquates, associe donc volontiers l’iconique au scriptural. Quand les poèmes de Fick font le choix de la parataxe, faut-il s’étonner de ce que la mosaïque se soit imposée comme le mode de publication privilégié de l’image sérielle sur Internet ? Parataxe iconique et parataxe textuelle jouent en effet des frictions entre partie et tout et transforment, à la limite, le poème même, en l’une de ces anthologies caractéristiques de la culture numérique. Significativement, Jean-Yves Fick accole d’ailleurs poème et mosaïque d’images, pour clore sa contribution à la revue D’ici là.
Doc. 2 – Ibid.
Ces deux formes convergent dans la tentative d’écrire l’instant, non pas tant extrait du flux numérique ou vital, que reversé dans cette labilité. L’œuvre qui témoigne de cette tension fructueuse et qui perçoit en synchronie la diachronie fuyante, qui stabilise fragilement une telle fluidité, est mosaïquée. L’occasion aura ménagé ce dépassement dialectique de l’opposition originelle entre un instant-punctum, isolé comme saillie existentielle, et le flux numérique.
« L’occasion », poursuit Jankélévitch, « est un cas qui vient à notre rencontre [14] ». De fait, le paradigme de la rencontre semble fonder une poétique de l’instant Web, mieux peut-être que n’y parvient celui de la rupture, souvent mobilisé. De là l’omniprésence des haïkus numériques dans la blogosphère littéraire. C’est bien parce que cette forme poétique brève relève d’une « écriture absolue de l’instant [15] », propice au satori qu’elle s’impose comme scène privilégiée de la rencontre. Christophe Grossi intitule ainsi « Rencontre du jour » le contact noué furtivement avec une aigrette, dont le cliché et le texte porteront trace et témoignage [16].
Doc. 3 ‒ Philippe Grossi, http://deboitements.net/spip.php?article761
Si le haïku incarne et se définit comme « art de la rencontre », il jouit en effet sur le Web de la coexistence de systèmes sémiotiques différents, dont la coprésence réalise et autorise cette rencontre même. Jean-Pierre Balpe inscrit ainsi systématiquement, dans un blog explicitement consacré aux haïkus, le texte à l’intérieur de la photo [17].
Doc. 4 ‒ Jean-Pierre Balpe, http://meshaikus.canalblog.com/.
L’instant Web, par le haïku, rejoint le punctum barthésien, qui montre ce « détail [qui] emporte ma toute lecture. […] Par la marque de quelque chose, la photo n’est plus quelconque. Ce quelque chose a fait tilt, il a provoqué en moi un petit ébranlement, un satori, le passage d’un vide (peu importe que le référent en soit dérisoire [18]) ». La photographie comme instantané offre sa saisie du réel au haïku numérique, comme une note – notula – prise au vol, « comme un gangster sort son colt », écrivait encore Barthes : le « tir photographique » de Cartier-Bresson, qui glosait par-là son fameux « instant décisif », résonne du même écho : « Bang » ! écrivait Balpe.
« C’est ça » résumait le punctum pour Barthes ; « ça-a-été », la photographie : posons qu’un « c’est là » devient nécessaire aujourd’hui pour spécifier l’apport du numérique, dans ce rapport iconotextuel voué au partage en ligne. L’« hypercontextualisation » du cliché numérique – du selfie notamment – comme « rapport de l’acteur à la situation » [19], sert une écriture numérique de l’instant consacrée à la collecte d’objets trouvés, au gré d’errances souvent urbaines qui rappellent les pratiques surréalistes puis situationnistes, mais s’affichent également comme des équivalents IRL de la sérendipité au cœur de la navigation sur Internet. Le geste photographique et poétique de Cécile Portier, par exemple, prélèvera une vulgaire pièce de monnaie.
Doc. 5 ‒ Cécile Portier, http://petiteracine.net/wordpress/2014/06/gagne-ma-langue/
Renouant avec la poétique du hasard objectif et de l’objet trouvé, l’écranvain propose ici comme une porosité des espaces, numérique et réel, où la même errance conduit à la rencontre du trivial. « Semée », autre dispositif de la série « Compléments d’objets » sur le site de Cécile Portier, illustre également une telle métalepse, puisque c’est cette fois une semelle oubliée là sur laquelle tombe l’auteure, comme au gré de mes parcours en ligne je peux croiser incidemment telle ou telle page Web depuis longtemps délaissée par son propriétaire.
Doc. 6 ‒ Cécile Portier, http://petiteracine.net/wordpress/2011/06/semee/
Perec aujourd’hui, parallèlement à son herbier urbain, nourri des traces – tracts, tickets… – de l’existence contemporaine, réaliserait peut-être un herbier numérique qui, dans le cloud ou sur un disque dur externe, archiverait des captures d’écran de ses navigations sur Internet… Telle pratique serait fidèle à l’esprit de l’auteur et à son goût du jeu. C’est même là, encore, un point de rencontre, que cette ludicité attachée à la sérendipité, comme le montre Servanne Monjour [20], et intrinsèquement, à l’instant, friand de surprises et d’impromptus quand la durée, elle, ne peut d’empêcher de planifier, en tablant sur quelque constance des individus et du monde. Aussi l’instant Web manifeste-t-il au mieux, dans ces productions littéraires nativement numériques, une intention d’invention.
4. L’instant & l’énonciation créatrice
La simplification technique du processus éditorial, rendue possible par les performances actuelles du réseau, des plateformes et des logiciels dédiés, autorise un mode de publication quasi instantané. Thierry Crouzet évoque ainsi la touche « Send », aux pouvoirs presque magiques :
Un Send n’est pas réversible, le Net mémorise, interdit l’oubli, tant chaque chose est aspirée, archivée au-delà de toute possibilité d’effacement, à moins d’un cataclysme. Pas de repenti, ou si peu, foncer en avant vers le texte suivant. Assumer son imperfection, jouir de l’éjection de bits vers les papilles sursensibilisées des récepteurs étrangers [21].
Le lecteur internaute accède à des productions qui conservent quelque chose de leur élan premier : découvrant un texte qui vient d’être rédigé, tweet ou post, j’en perçois non seulement le contenu mais également la force de projection, forme de dripping numérique, sur l’écran que je contemple. C’est bien le geste même de l’écranvain qui perdure et constitue partie du rayonnement de l’œuvre publiée en ligne.
Symétriquement, l’auteur tend à raccourcir, parfois jusqu’à l’infime instant, le délai attribué à la validation sociale du contenu édité : « Internet se définirait ainsi comme le lieu d’une prétention à l’immédiateté du feedback dans les processus littéraires », admettra-t-on aisément, avec Étienne Candel et Gustavo Gomez-Mejia [22]. Plus largement, la culture de l’engagement de l’internaute ressortit à l’immédiateté et à l’instantanéité. La viralité des mèmes, par exemple, exploite ce pan tacite de la pratique du partage d’un contenu par les internautes. Là encore, contrairement aux apparences, l’instant ne conteste pas tant le flux qu’il ne se découvre des aires communes où se réalise une coprésence polyrythmique. Le même, partagé parfois des millions de fois, y perd-il de son aura originelle ? Pas forcément, semble-t-il, puisque le modèle benjaminien de la reproductibilité technique ne se superpose que partiellement à ces pratiques, qui relèveraient davantage d’une (ré)itérabilité numérique de l’instant. L’instant originel – une vidéo, par exemple – est en effet censé conserver, même diffusé aussi largement, sa puissance disruptive première : c’est même parce qu’il la conserve qu’il m’incite, à mon tour, à entrer dans la chaîne du partage.
On le voit, les caractéristiques techniques qui définissent le support et donc ses pratiques, ne sauraient épargner l’énonciation même de l’œuvre. Présentant l’ouvrage de Dominique Hasselmann, 140 Tunnels – en 140 signes chacun – proposé en ligne par Publie.net, François Bon affirme nettement une telle interaction :
Il faut s’y faire. Twitter est désormais un outil adulte de création. Non par culte du bref, mais par ce rapport de publication immédiate, circulante, qui permet d’être au plus près du réel et en même temps de le construire comme fiction [23].
Le texte littéraire met alors ses pas dans ceux de la photographie, dont l’histoire peut, de ce point de vue, se résumer à la réduction progressive du temps de pose jusqu’à « une pointe presque invisible –, le suspens de l’instantané, qui est à la fois le plus bref et le plus absolu [24] ». C’est également l’horizon de la performance, dépendante d’un hic et nunc, ouverte au geste autant voire plus qu’au résultat-œuvre, qui se propose ici à l’œuvre littéraire numérique saisie à travers le prisme de l’instant. Chaque clic sur un lien hypertexte, d’ailleurs, souligne « l’énergie suggestive du langage, de l’image, de l’éclairage, de la mise en espace et de l’animation », pour Alexandra Saemmer [25].
L’hypertexte participe donc d’une poétique et d’une économie pragmatique du ravissement, le clic m’engouffrant brutalement dans un ailleurs inconnu. De même, le surgissement en ligne de l’œuvre littéraire hyperliée, ou tout simplement nativement numérique, parfois encore mal dépolie, entachée de scories qui pourront éventuellement disparaître lors d’une ultérieure relecture-mise à jour, lui confère l’intensité conservée du geste créateur. L’instant créateur, comme le soulignait déjà Bachelard, ouvre à la dimension du commencement [26].
Or, le commencement, toujours relancé, a déjà son genre : l’essai, dont la poétique se laisse caractériser par « cet élan permanent de l’entrée, pulsion de discours renouvelée à chaque phrase [27] ». Le site « en recomposition permanente [28] » et le blog perçu comme « enchevêtrements, marqueterie, hoquetante psalmodie [29] » entassant fragment sur fragment, renouent avec cette évolutivité inhérente à l’essai, en cela distinct du traité aux visées plus péremptoires. C’est même à une vitalité neuve qu’il aspire, reprenant à chaque occasion le fil de son discours, non seulement pour le moduler et le prolonger, mais bien pour y réinscrire un élan énonciatif capable de revigorer l’ensemble. Dès lors, multipliant les incipit, le site ré-arme et ré-ancre à chaque instant la performativité d’une parole d’écrivain. Il fait même de l’instant l’occasion d’une telle relance de la pensée. Si l’essai comme le site renoncent à l’affirmation de vérités intimidantes d’être présentées comme définitives et indépassables, c’est que tous deux s’ancrent de fait dans un terreau mouvant par définition, celui du présent de leur énonciation. « La philosophie prétend aux vérités éternelles, si l’on en croit Platon », rappellent Glaudes et Louette, « l’essai fait du circonstanciel l’objet de sa méditation [30]». Nommons e-ssai le terrain de jeu de cet « instant qui décide et qui ébranle » tant l’auteur que le lecteur, progressant par vagues successives, gages d’une nouveauté entretenue comme un feu précieux : « Il faut du nouveau », écrivait encore Bachelard, « pour que la pensée intervienne, il faut du nouveau pour que la conscience s’affirme et que la vie progresse. Or, dans son principe, la nouveauté est évidemment toujours instantanée [31]. »
Au terme de ce parcours, qui lui-même se contente d’ouvrir le dossier Web Satori, l’instant, considéré comme le régime de temporalité privilégié d’une écriture numérique, s’est déployé tant vers sa réception en aval, qu’en amont vers des formes et des genres anciens, revisités par l’activité de ces écrivains du Web, ou écranvains. C’est qu’un des strates les plus profondes des pratiques littéraires concernées se nourrit du rêve fou de dire, malgré tout, malgré la modernité et Mallarmé notamment, le monde par le langage. L’immédiateté, le fantasme de la synchronie perception/publication/réception, permettrait de rétribuer autrement le défaut des langues. L’efficace technique incarné par des outils performants, smartphone, tablette, ordinateur, l’éclatement sémiotique des contenus – son, image, texte – tentent ainsi de négocier avec l’embarras propre à notre littérature dans son rapport au monde. Les tenants d’un Web de l’information soulignent d’ailleurs à l’envi la puissance du réseau et saluent l’instant comme cet éclair performatif réduisant presque à néant bruit et retard dans la transmission des messages. Mais si les écranvains, on en aura vu quelques exemples ici, exploitent à leurs fins propres les capacités des plateformes, c’est bien pour mener, toujours, une interrogation sur le rapport de la langue au monde, voire pour évider cet instant trop plein, saturé d’informations, en le faisant dialoguer notamment avec l’image photographique. Les poèmes de Jean-Yves Fick déterritorialisent volontiers le référent de la photo, par la mise en espace de blancs, venus trouer le texte mais aussi susciter des circulations d’air entre l’écrit et l’image. Les « Grains d’instants » de Christophe Grossi se jouent ainsi, de façon exemplaire, d’un rapport de l’écriture à l’immédiateté supposée de l’image déposée sur Instagram, en proposant décalages et « déboîtements » – le titre de son blog littéraire – indispensables au surgissement d’une écriture décentrée [32].
Doc. 7 ‒ Christophe Grossi, http://deboitements.net/spip.php?rubrique50
Autant de formes de résistance vive à l’évidence, voire à la fascination de l’instant comme possibilité, ici reconnue vaine, de fixer le sens.
Notes
[1] Je renvoie ici à l’ouvrage de Serge Bouchardon, La Valeur heuristique de la littérature numérique, Paris, Hermann, « Cultures numériques », 2014, p. 12.
[2] M. Doueihi, Pour un humanisme numérique, Paris, Seuil, 2011, p. 18.
[3] R. Simone, Pris dans la Toile. L’esprit au temps du Web, Paris, Gallimard, 2012, p. 24.
[4] A. Bertina, Je suis une aventure, Paris, Verticales, 2012, p. 370.
[5] J’ai plaisir à emprunter cette notion à Yves Vadé, qui l’avait forgée dans son article « Pour introduire les chronotypes », in L’Invention du XIXe siècle, le XIXe siècle par lui-même, Paris, Klincksieck, 1999, p. 195-205.
[6] R. Barthes, Œuvres complètes, t. 3, Paris, Seuil, 2002, p. 706.
[7] F. Georges, « Représentation de soi et identité numérique. Une approche sémiotique et quantitative de l’emprise culturelle du Web 2.0 », Réseaux, no154, 2009, p. 191 et 168.
[8] D’ici là, no7, Pierre Ménard (dir.), Publie.net, 2011.
[9] http ://www.fut-il.net/2015/12/morning-la-fenetre-s04.html
[10] Christine Buci-Glucksman, Esthétique de l’éphémère, Paris, Galilée, 2003, p. 25.
[11] J.-M. Seillan, « L’instant stendhalien et les limites de l’écriture littéraire », Modernités, no11, « L’instant romanesque », Talence, Presses Universitaires de Bordeaux, 1998, p. 31.
[12] V. Jankélévitch, Le Je-ne-sais-quoi et le presque rien, t. 1, « La manière et l’occasion », Paris, Seuil, Points, 1980, p. 142.
[13] Jean-Christophe Bailly, L’Instant et son ombre, Paris, Seuil, 2008, p. 54.
[14] Op. cit., p. 16.
[15] Roland Barthes, La Préparation du roman I et II, Paris, Seuil / Imec, 2003, p. 85.
[16] deboitements.net/spip.php?article761
[17] http://meshaikus.canalblog.com
[18] Roland Barthes, La Chambre claire, in O.C. t. 5, Paris, Seuil, 2002, p. 828.
[19] André Gunthert, L’Image partagée. La photographie numérique, Paris, Textuel, 2015, p. 156 et 154.
[20] S. Monjour, La Littérature à l’ère photographique, Thèse de doctorat, Rennes 2 – Montréal, 2015, p. 103.
[21] http ://tcrouzet.com/2013/11/24/la-send-generation-pecha-kucha-remix/. Voir également Thierry Crouzet, La Mécanique du texte, Publie.net, 2015.
[22] Voir leur article « Écrire l’auteur : la pratique éditoriale comme construction socioculturelle de la littérarité des textes sur le Web », in L’Auteur en réseau, les réseaux de l’auteur, Orianne Deseilligny & Sylvie Ducas (dir.), Nanterre, Presses Universitaires Paris Ouest, 2013, p. 61.
[23] https ://www.publie.net/livre/140-tunnels/
[24] J.-C. Bailly, op. cit., p. 112.
[25] A. Saemmer, Matières textuelles sur support numérique, Presses universitaires de Saint-Étienne, 2007, p. 16.
[26] Voir son Intuition de l’instant, Paris, Le Livre de Poche, 1994, p. 18 notamment.
[27] Marielle Macé, Le Temps de l’essai. Histoire d’un genre en France au XXe siècle, Paris, Belin, 2006, p. 164.
[28] http ://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article3749 .
[29] http ://lambertschlechter.blogspot.fr/search?updated-max=2015-09-25T12 :48 :00%2B02 :00&max-results=15&start=32&by-date=false; 19 septembre 2015.
[30] P. Glaudes & J.-F. Louette, L’Essai, Paris, Hachette, « Contours littéraires », 1999 ; 2ème édition, Paris, Armand Colin, 2011, p. 134.
[31] G. Bachelard, op. cit., p. 22 et 37.
[32] Voir http ://deboitements.net/spip.php?rubrique50 .
Auteur
Gilles Bonnet est Professeur de littérature à l’Université Jean Moulin-Lyon 3, où il dirige le centre de recherches MARGE. Ses travaux portent sur la littérature française moderne et contemporaine, et tout particulièrement sur les rapports entre littérature et Internet. Un essai, intitulé Pour une poétique numérique, paraître fin 2017 aux éditions Hermann. Il a édité les actes du colloque « Internet est un cheval de Troie : la littérature, du Web au livre », sur le site Fabula (lien).
Copyright
Tous droits réservés.